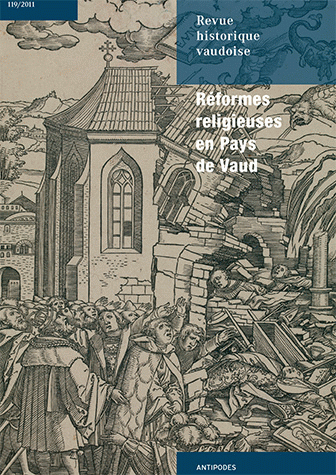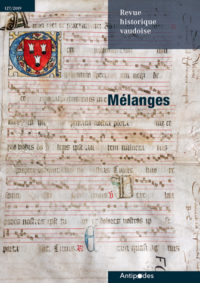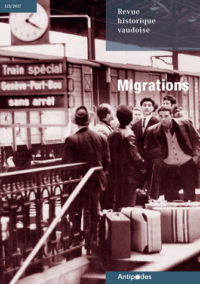Description
À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du réformateur Pierre Viret, la Revue historique vaudoise s’est intéressée à l’histoire religieuse du Pays de Vaud entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle. Des spécialistes, historiens médiévistes et modernistes, présentent à cette occasion leurs travaux récents ou actuels et proposent de nouvelles pistes de recherche, soit autant d’encouragement à poursuivre les études dans un domaine de l’histoire vaudoise à redécouvrir.
Sans viser à rendre compte de manière exhaustive du long « temps des réformes », les contributions traitent de la période qui commence avec l’épiscopat de Georges de Saluces (1440-1461) jusqu’à la grave crise que connaît le Pays de Vaud en 1558-1559, qui conduit au bannissement de Pierre Viret par le souverain bernois. Le cadre géographique retenu est, avant 1536, celui de l’Église de Lausanne, mère du diocèse, et, après 1536, celui du Pays de Vaud bernois.
Alors que l’historiographie ancienne s’est surtout focalisée sur la Réforme en tant que rupture théologique et institutionnelle, ce dossier thématique met en perspective cette dernière avec des courants réformateurs de la fin du Moyen Âge et avec des phénomènes de résistances au début de l’époque moderne. En privilégiant un traitement sur près d’un siècle, il révèle la diversité de l’objet « réformes » envisagé non seulement sur le plan doctrinal mais aussi dans ses aspects économiques, sociaux et culturels.
Table des matières
ÉDITORIAL
DOSSIER: RÉFORMES RELIGIEUSES EN PAYS DE VAUD: RUPTURES, CONTINUITÉS ET RÉSISTANCES (M. XVe-M. XVIe SIÈCLE)
-
Les Actes du Synode de Lausanne (1538): un rapport sur les résistances à la Réforme dans le Pays de Vaud (introduction, édition et traduction, Michael Bruening, Karine Crousaz)
ÉCLAIRAGES DOCUMENTAIRES THÉMATIQUES
MÉLANGES
COMPTES RENDUS
-
Callisto Caldelari, Bibliografia Ticinese dell’Ottocento. Fogli, vol. 1, 1800-1860; vol. 2, 1861-1899, avec la collaboration de Matteo Casoni et Letizia Fontana, Bellinzone: Istituto bibliografico ticinese, 2010, 1269 p. (Fabrizio Mena)
-
Alain Clavien, Grandeurs et misères de la presse politique. Le match Gazette de Lausanne – Journal de Genève, Lausanne: Antipodes, 2010, 325 p. (Carine Corajoud)
-
Laurent Flutsch, Gilbert Kaenel, Frédéric Rossi (dir.), Archéologie en terre vaudoise, Gollion: Infolio, 2009, 215 p. (Michel Fuchs)
-
Norbert Furrer, Vade-mecum monétaire vaudois. XVIe-XVIIIe siècles. Systèmes et parités monétaires, cours d’espèces, prix, revenus et dépenses dans le Pays de Vaud sous le régime bernois. Préface de Gilbert Coutaz, Lausanne: Antipodes, 2010, 136 p. (Lucienne Hubler)
-
Cédric Humair, 1848. Naissance de la Suisse moderne, Lausanne, Antipodes et SHSR, collection Histoire.ch, 2009, 167 p. (Olivier Pavillon)
-
Dave Lüthi (dir.), Le client de l’architecte. Du notable à la société immobilière: les mutations du maître de l’ouvrage en Suisse au XIXe siècle, Lausanne: Études de Lettres 4, 2010, 252 p., ill. (Paul Bissegger)
-
Philipp Müller, La Suisse en crise (1929-1936). Les politiques monétaire, financière, économique et sociale de la Confédération helvétique, Lausanne: Antipodes, 2010, 818 p. (Christophe Farquet)
-
Eva Pibri, Guillaume Poisson (éds), Le diplomate en question (XVe-XVIIIe siècles), Lausanne: Études de lettres 3, 2010, 276 p. (Claude Berguerand)
HOMMAGES
CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
Presse
Dans la Revue d’histoire ecclésiastique
À l’occasion du cinquième centenaire de la naissance de Pierre Viret, la Revue historique vaudoise a consacré l’essentiel de son tome 119 à un dossier dont la responsabilité scientifique a été confiée à Karine Crousaz et Yann Dahhaoui. Il dépasse le champ strict labouré par Viret pour envisager des aspects de l’ensemble des réformes religieuses en Pays de Vaud depuis le milieu du XVe siècle jusqu’au milieu du siècle suivant. La vie religieuse de cette période a été marquée par de multiples mouvements. Les réformes promues par l’Église médiévale à travers les synodes diocésains et les visites pastorales sont présentées durant l’épiscopat de Georges Saluces (1440-1461) spécialement bien documenté (Georg Modestin). De 1450 à 1534, l’Église de Lausanne célébrait tous les sept ans peu avant Pâques un Grand Pardon qui offrait aux fidèles de larges indulgences. Ce qui peut être retrouvé de cette histoire est retracé à travers une documentation assez rare (Jean-Daniel Morerod). Les contributions suivantes en viennent directement à la période de la Réforme. Il est question des conditions dans lesquelles la dispute de Lausanne de 1536, voulue par Berne, a été l’outil permettant l’introduction de la Réforme (Fabrice Flückiger). Un recensement du clergé vaudois au moment de la Réforme permet de retrouver 660 clercs. Ceux qui ont préféré l’exil à l’adhésion à la nouvelle confession se situent entre un tiers et une petite moitié (Christine Lyon). À travers une version allemande, il a été possible de reconstituer les actes du Synode de Lausanne de 1538, réunion qui jette une lumière crue sur les résistances à la Réforme dans la région. Le texte allemand est reproduit avec une version française moderne (Michael Bruening & K. C.). La lutte pour l’introduction de la Réforme est faite d’une part de la tactique développée par les Seigneurs de Berne avec des résultats limités dans les campagnes proches de la frontière confessionnelle (James Blakeley), tandis que ceux qui « papistent » ont aussi diverses politiques de résistance (Sylvie Moret Petrini). La crise de 1558 qui aboutit à l’expulsion de Viret et au départ de nombreux pasteurs est à la fois théologique aux yeux de Viret et des siens et politique pour le Conseil de Berne (Charles E. Valier). Avec la lumière des restaurations récentes des lieux de culte, il devient possible de mieux cerner les moyens utilisés pour la destruction des images pieuses (Brigitte Pradervand). La vague iconoclaste n’a pas empêché par la suite les artistes de produire des statues monumentales pour les deux confessions (Olivier Christin). Le travail de dispersion et de destruction des archives ecclésiastiques a été ambigu avec des effets réels de disparation, mais avec des conséquences moins catastrophiques que l’on pourrait craindre (Gilbert Coutaz). Par ses apports inédits, le dossier (pp.9-225) montre bien qu’il reste encore des sources à exploiter pour mieux comprendre le passé du canton de Vaud. La revue propose en outre quelques articles, des comptes rendus et d’autres chroniques habituelles.
Jean-François Gilmont, Revue d’histoire ecclésiastique, no.1/2012, pp.176-171