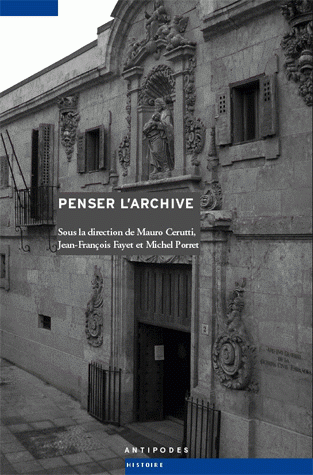Penser l’archive. Histoires d’archives – archives d’histoire
Cerutti, Mauro, Fayet, Jean-François, Porret, Michel,
2006, 331 pages, 25 €, ISBN:2-940146-57-8
Pour l’historien, un fonds d’archives signale la sédimentation politique et sociale qu’il observe dans le document.
Description
Pour l’historien, un fonds d’archives signale la sédimentation politique et sociale qu’il observe dans le document.
Table des matières
-
Penser l’archive (Mauro Cerutti, Jean-François Fayet, Michel Porret)
-
Techniques de l’écrit et contrôle social à l’époque moderne: les pratiques d’enregistrement des institutions genevoises, XVIe siècle (Christian Grosse, Université de Genève)
-
Un fonds d’archives privé pour des documents publics: le « fondo Torriani » (Isabella SpinelliUniversité de Genève)
-
Les Archives de la diplomatie: pour une histoire culturelle des relations franco-genevoises durant l’Ancien Régime (Fabrice Brandli, Université de Genève)
-
Histoire politique et politique de l’archive. La Lombardie autrichienne et le corps helvétique (Élisabeth Salvi, Université de Lausanne
-
Sur les traces des déserteurs au XVIIIe siècle. Les archives et les normes (Marco Cicchini, Université de Genève)
-
Pour une étude du contrôle social à Lausanne au XVIIIe siècle: les sources consistoriales en question (Nicole Staremberg Goy, Université de Lausanne)
-
L’affaire Desvignes. Des plaidoyers si longs qu’ils vous feraient travailler la Semaine sainte (Patricia Reymond, Université de Lausanne)
-
Les vaincus des archives. Réflexions sur le lien entre État-nation et mémoire collective à partir du cas brésilien, 1839-1844 (Jean Philippe Challandes (Chercheur avancé FNS/Instituto de Ciências Sociais -Universidade de Lisboa)
-
« 6 mai 1868. J’essaie d’écrire. » Aventures et énigmes autour du journal intime d’un jeune handicapé (Mariama Kaba, Université de Lausanne)
-
Archives et gestion hospitalière. Le cas de l’Hôpital cantonal de Lausanne, 1850-1960 (Pierre-Yves Donzé, Université de Neuchâtel)
-
Les brevets. Une source pour l’histoire de l’innovation dans l’industrie mécanique de l’Arc jurassien suisse (Thomas Perret, Université de Neuchâtel)
-
Les Archives historiques Roche: Quelle mémoire d’entreprise? (Klaus Ammann, Université de Bâle/Documents diplomatiques suisses et Christian Engler, Université de Lausanne/Département fédéral des affaires étrangères)
-
Perspective théorique, construction de l’archive et pouvoir du discours. La Société des Nations et la reconstruction de l’Europe centrale (Michel Fior, Université de Neuchâtel)
-
Un exemple de fonds privé inexploré: les archives de l’Entente internationale anticommuniste (EIA) (Michel Caillat, Université de Genève)
-
Le rôle de l’intelligentsia kurde dans la production des « archives nationales »: 1925-1946 (Jordi Tejel, Université de Fribourg)
-
L’Espagne face à son passé récent: quelques enseignements tirés des archives espagnoles (Sébastien Farré, Université de Genève)
-
Les banques suisses, les archives et la Seconde Guerre mondiale (Marc Perrenoud, Documents diplomatiques suisses)
-
La photographie comme source historique? De l’utilisation de la photographie dans l’historiographie du national-socialisme et du génocide juif (Yan Schubert, Université de Genève)
-
Enjeux sociaux de deux « archives de la terreur » à Berlin et Ludwigsburg (Luc van Dongen, Université de Genève)
-
La Suisse et la République de Salò: questions d’archives et nouvelles problématiques historiques (Dario Gerardi, Université de Lausanne/Documents diplomatiques suisses)
-
La Fondation « Archivum Helveto-Polonicum ». Le mariage réussi des besoins et de la passion (Wojciech Piotr Kocurek, Université de Fribourg)
-
Les dossiers de jugement des légionnaires suisses. Source inédite pour une histoire de la torture pendant la guerre d’Algérie (Damien Carron, Université de Fribourg)
-
Archives ecclésiastiques de Kinshasa et réécriture de l’histoire congolais (Jean-Bruno Mukanya Kaninda-Muana, Université de Genève)
Presse
Penser l’archive, c’est aussi lire et problématiser des fonds qui ne transmettent nul message spontané et transparent. C. Grosse met salutairement en garde contre la projection mécanique sur les archives d’Une historiographie plaçant l’identification statistique et le contrôle social au cur des États modernes. Pour lui, les documents d’état civil genevois demeuraient avant tout d’ordre religieux, inscrivant l’individu dans une société chrétienne, sources de restitution collective actualisant l’histoire éternellement répétée du salut. Nicole Staremberg Goy montre que, si l’on peut utiliser les archives des consistoires suisses comme source pour percevoir les écarts aux normes, encore faut-il décrypter les récits qui définissent les délits punis par ces tribunaux ecclésiastiques, en repérant les stratégies discursives des individus mais aussi des secrétaires qui transcrivent leur déposition. Travaillant sur la reconstruction de l’Europe centrale après 1918, Michel Fior étudie avec finesse les liens entre les historiographies successives des relations internationales et les fonds documentaires utilisés. Ainsi, un historien « réaliste »), comme Edward Carr, axé sur la problématique de la puissance et de l’État-nation et considérant la Société des nations comme une utopie, rechercha ses informations dans la documentation des appareils étatiques. D’autres chercheurs guidés par la pensée libérale selon laquelle les États ne recherchent pas le pouvoir, mais maximisent les gains et les coûts de leurs relations extérieures par l’information et la coopération intéressée, puisèrent davantage dans les fonds des organisations internationales.
Sophie Coeuré, Annales, Histoire, Sciences sociales, no 1 2007.
Produits apparentés
-
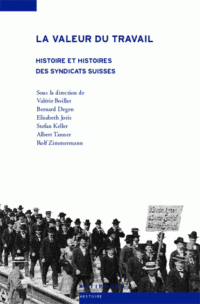 31,00 CHF
31,00 CHFLa valeur du travail. Histoire et histoires des syndicats suisses
Boillat, Valérie, Degen, Bernard, Joris, Elisabeth, Keller, Stefan, Tanner, Albert, Zimmermann, Rolf
(Format Imprimé)Les auteur·e·s de ce livre - des historiennes et des historiens engagé·e·s, venant de toute la Suisse - illustrent par des textes brefs plusieurs aspects de ce mouvement. Ils parlent de situations exemplaires, d'événements spectaculaires, de personnalités marquantes. Un texte qui court tout au long du livre (rédigé par l'historien Bernard Degen) relate en détail l'histoire des syndicats en Suisse. Les illustrations racontent la même histoire, parfois une autre, par d'autres moyens, et d'une manière que l'on voit rarement.
-
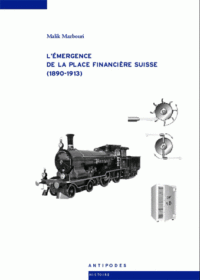 40,00 CHF
40,00 CHFL’émergence de la place financière suisse (1890-1913). Itinéraire d’un grand banquier
Mazbouri, Malik
(Format Imprimé)Entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale, le paysage bancaire helvétique connaît une métamorphose profonde. Deux gestes politiques majeurs sont à l'origine de ce phénomène: le rachat, à partir de 1898, des principales compagnies de chemins de fer privés par la Confédération, et l'ouverture, en 1907, de la Banque nationale suisse. Un type d'institution jusque-là freiné dans ses pleines possibilités d'expansion recueille les meilleurs fruits du mouvement qui s'engage: celui de la grande banque commerciale moderne.
-
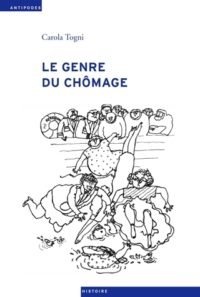 37,00 CHF
37,00 CHFLe genre du chômage
Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse (1924-
Togni, Carola
(Format Imprimé)Sur-représentées parmi les personnes en quête d’un emploi, les femmes sont pourtant moins nombreuses à effectuer une demande d’indemnisation auprès de l’assurance chômage. Cet ouvrage apporte des explications à cet apparent paradoxe et tend à montrer que l’assurance chômage ne se limite pas à refléter les inégalités entre les femmes et les hommes dans la famille ou sur le marché de l’emploi, mais qu’elle participe à les construire. Ce livre offre une contribution importante à l’analyse de l’histoire de l’État social dans une perspective de genre.
-
 31,00 CHF
31,00 CHFLa province n’est plus la province.
Les relations culturelles franco-suisses à l'épreuve de la Secon
Clavien, Alain, Gullotti, Hervé, Marti, Pierre
(Format Imprimé)La Seconde Guerre mondiale est un moment singulier dans l'histoire des relations culturelles entre la Suisse et la France. Au lendemain de la défaite, en effet, Paris occupé perd de son prestige et de son irrésistible pouvoir d'attraction; l'édition, la presse, les revues, les hiérarchies intellectuelles, tout est bouleversé par la défaite et l'Occupation. Les milieux culturels de la Suisse épargnée ne connaissent pas une telle déstructuration. Certes, la censure veille et les embarras ne manquent pas, mais jamais au point de véritablement gripper le fonctionnement du champ culturel helvétique. Les artistes et intellectuels français d'avant guerre n'avaient pour lui que condescendance, les voilà qui se pressent au portillon des quotidiens romands pour s'y faire publier et gagner quelque argent.