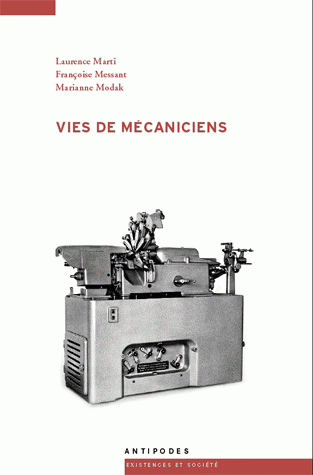Vies de mécaniciens
Marti, Laurence, Messant, Françoise, Modak, Marianne,
2005, 164 pages, 18 €, ISBN:2-940146-60-8
Le 7 juin 2002, la direction de Tornos SA à Moutier, entreprise spécialisée dans la fabrication de tours automatiques, annonce la suppression de 367 emplois sur les 1000 que compte l’entreprise. Pour cause de restructuration. Ce jour-là, sans être au courant de cet événement, nous prenions un premier rendez-vous auprès de mécaniciens de l’entreprise afin de réaliser une étude sur la vie des ouvriers, dans une région historiquement vouée à la fabrication de machines-outils. Le ton fut ainsi très vite donné .
Description
Le 7 juin 2002, la direction de Tornos SA à Moutier, entreprise spécialisée dans la fabrication de tours automatiques, annonce la suppression de 367 emplois sur les 1000 que compte l’entreprise. Pour cause de restructuration .
Ce jour-là, sans être au courant de cet événement, nous prenions un premier rendez-vous auprès de mécaniciens de l’entreprise afin de réaliser une étude sur la vie des ouvriers, dans une région historiquement vouée à la fabrication de machines-outils. Le ton fut ainsi très vite donné .
Partant d’un exemple très concret, les auteures présentent une analyse renouvelée de la vie des ouvriers d’aujourd’hui. L’accent est mis sur les défis qui se posent à eux dans des contextes professionnels et privés en profonde transformation, et sur les difficiles ajustements qu’ils supposent entre vie privée et vie professionnelle.
Table des matières
Avant-propos
Introduction
- La machine-outil à Moutier: une longue histoire
- Les questions
I. L’HERITAGE
La profession
- Une voie toute tracée
- L’importance de la qualification
- La culture d’entreprise
- Le prestige et la passion du métier
Les activités de loisirs et associatives
- Les traces d’une culture ouvrière
- Une coupure avec l’univers du travail
- Le syndicat et la pratique religieuse: des activités minoritaires ou marginales
La famille
- La conception de la famille
- La division sexuelle du travail
Espace et temps de référence
II. VERS DE NOUVEAUX HORIZONS?
L’affaiblissement de l’engagement professionel
- Un nouveau métier
- Culture participative et flexibilité
- Un nouveau rapport à l’entreprise, à l’emploi, à la région?
- L’avenir professionnel des enfants
Les modifications dans l’engagement communautaire
- L’exemple syndical
- Les loisirs
Une redéfinition de la famille
- L’assouplissement de la division sexuelle du travail
- La désinstitutionnalisation du mariage
Vers des engagements conditionnels et négociés?
CONCLUSION
- Un univers de référence en voie de redéfinition
- Un univers relativement privilégié
- Une période faste…mais dans un cadre régional bien délimité
- Quelques inconnues et inquiétudes
Presse
Laurence Marti s’intéresse au mode de vie des ouvriers
Dans un ouvrage Vies de mécaniciens, la sociologue examine le cas de l’entreprise Tornos SA à moutier. Reflet d’une économie en mutation.
Elles sont trois auteurs: Laurence Marti, Françoise Messant, Marianne Modak. Leur ouvrage Vies de mécaniciens a vu le jour, grâce a un mécène. Entre 2002 et 2004, les enquêteurs ont rencontré une vingtaine de salariés de Tornos SA. Spécialisée dans la machine-outil, cette société a été frappée de plein fouet par les mutations économiques. Le début de leur étude a d’ailleurs coïncidé avec une énorme vague de licenciements: 367 emplois étaient supprimés sur les 1000 que comptaient la société. Partant du constat que le monde ouvrier, s’il a fait l’objet de nombreuses thèses dans les années septante était devenu un sujet délaissé: les enquêteuses ont décortiqué la vie de ces ouvriers spécialisés dans leur intégralité en tenant compte de leur environnement familial, leurs loisirs… Une bonne partie des conclusions de cet ouvrage peuvent s’appliquer à notre région de La Côte, note Laurence Marti. Et de souligner notamment que par rapport aux années septante, la place prise par les loisirs est de plus en plus importante. Autre axe: l’attachement de ces salariés à leur région et leur crainte d’être obligés de « s’exiler » en cas de licenciement. Aujourd’hui, la satisfaction au travail n’est plus associée à la stabilité de l’emploi. Leur carrière professionnelle peut se trouver brutalement interrompue, non seulement à l’échelle de l’entreprise, mais aussi à celle de la région. Cette dernière ne fonctionnant plus nécessairement comme le, réservoir d’emplois qu’elle a été, notent les auteurs. Cet ouvrage, fort documenté, met en lumière les difficultés pour ces ouvriers spécialisés d’affronter des problèmes nouveaux auxquels ils avaient été jusqu’à présent préservés. Une analyse qui reflète l’évolution du monde économique actuel.
Marie-Christine Fert, La Côte, 26 juillet 2005.
A Moutier, vie, mort et mémoire du métier de mécanicien
Jura bernois: Comment « la Tornos » et les autres firmes de machines-outils ont-elles façonné la mentalité des Prévôtois? Trois sociologues tentent de répondre par un livre à la question
C’est tout à la fois la transformation d’un métier, d’une région et d’une époque. Pendant plus d’un siècle, le destin de la ville de Moutier a été intimement lié à la machine-outil. Source de fierté, mais aussi de places de travail en cascade, l’industrie des machines fera vivre, dans la seconde moitié du siècle dernier, la très grande majorité des ouvriers du Jura bernois, conjointement à la métallurgie et à l’horlogerie.
Rédigé par trois sociologues, un livre relate la grandeur et la décadence de cette branche, en partant d’une vague de licenciements que connut l’entreprise Tornos SA en 2002. Loin de constituer un simple tableau désincarné, l’ouvrage se fonde sur de nombreux témoignages de mécaniciens. Il donne à voir les bouleversements profonds qui se cachent derrière le phénomène économique des « restructurations ».
Destinée à produire des composants pour d’autres machines, la branche de la machine-outil n’a été que peu étudiée jusqu’ici, représentant un domaine médiatiquement peu « sexy », bien moins prestigieux que l’horlogerie. Longtemps, elle a pourtant représenté un réel mode de vie, un univers en soi. Face à sa machine, l’homme est un artisan, presque un artiste. « A l’époque, chez Tornos, il n’y avait peut-être qu’une personne qui savait maîtriser une machine pour faire une pièce bien définie, qu’il fallait faire au millième », dit l’un d’eux.
Trois entreprises se partagent le marché: Tornos, Bechler et Peterman. Fondées sur un modèle paternaliste, elles suscitent de la part des mécaniciens une loyauté à la mesure de leur orgueil. On ne fait pas que travailler dans l’une de ces usines: à travers les cités ouvrières, les activités associatives ou sportives, on rejoint une grande famille. La stabilité professionnelle, la transmission d’un savoir-faire, mais aussi le manque d’alternative font que la question ne se pose pas: on est mécanicien de père en fils. « Mes parents habitent toujours dans les maisons Tornos. C’étaient des purs et, durs, comme on dit, explique un homme. Mon père est venu ici quand ils ont construit le quartier. Donc ça fait cinquante-quatre ans qu’ils sont là. »
Les auteures n’idéalisent pas cette période. « Conditions de travail parfois difficiles, répétitivité, monotonie,l’absence de choix, omnipotence de la hiérarchie et du patron, contrôle de l’accès aux postes, notamment hiérarchiques, par les réseaux familiaux ou autres, exclusion de ceux qui n’en faisaient pas partie… » Tout cela, notent les sociologues, ne trouve plus guère de justification. Le choc, cependant, va être d’autant plus rude pour ceux qui voient l’une après l’autre s’écrouler leurs certitudes.
Jusqu’à ce que survienne l’impensable: la fusion des trois entreprises, le rachat par des investisseurs étrangers, l’entrée en Bourse. Au-delà des licenciements et des adaptations techniques dont les ouvriers jurassiens avaient déjà l’habitude, notent les chercheuses dans leur avant-propos, ce qui est désormais nouveau ce sont « des préoccupations liées à la rentabilité financière, à la satisfaction des actionnaires, à l’évolution des marchés boursiers, à une adaptation de la production à une demande flexible. »
Devant cette évolution qui peut amener les entreprises à licencier même si leurs résultats semblent bons, certains ouvriers s’interrogent sur la pertinence que revêt encore la notion helvétique de paix du travail. Surtout, la perte d’identification à l’entreprise entraîne un désengagement professionnel, ainsi que la redéfinition en profondeur des rôles au sein du couple et de la famille. Au final, ces vies de mécaniciens, soulignent les auteures du livre, reflètent des transformations à l’uvre un peu partout, dont on n’a pas fini de mesurer les conséquences.
Luis Lema, Le Temps, 30 juillet 2005
MACHINE-OUTIL Un livre retrace la vie des ouvriers des grandes firmes de la région
Sociologues au chevet de mécaniciens
A l’ombre du prestigieux secteur de l’horlogerie, les firmes de machine-outil ont fait vivre la majorité des ouvriers de la région, autour des années 1970. Vies de mécaniciens se penche sur le quotidien de ces travailleurs.
Comprendre, à partir d’entretiens approfondis avec des ouvriers, l’héritage que le monde de la machine-outil a transmis à la région, c’est le défi que se sont lancé trois sociologues lausannoises. Après trois ans de recherches, les Editions Antipodes publient le fruit de leur travail: 160 pages qui abordent des thèmes recouvrant la vie professionnelle et privée des mécaniciens, le tout agrémenté d’extraits d’entretiens. « Alors que les mutations dans le secteur de l’industrie sont perçues de l’extérieur soit de manière très positive, soit très négativement, nous avons essayé de voir ce que les gens qui les vivent de l’intérieur en disent », raconte Françoise Messant, coauteure de l’ouvrage.
Rude entrée en matière
En juin 2002, les auteures se souviennent d’une anecdote venue donner le ton à leur recherche: « Alors que nous prenions un premier rendez-vous avec les mécaniciens de l’entreprise Tornos, afin de réaliser notre étude sur la vie ouvrière dans une région historiquement vouée à la fabrication de machines-outils, la direction de cette entreprise a annoncé la suppression de 367 emplois sur les 1000 que comptait l’entreprise. » Pour certains fidèles, cette vague de licenciements a été la quatorzième à laquelle ils ont fait face, mais comme ils le disent eux-mêmes dans les pages de Vies de mécaniciens, il est impossible de s’habituer complètement à ce genre d’événement.
Perte de confiance
C’est que le secteur est passé par tous les états d’âme, ces dernières décennies. De la division du travail et de la rationalisation des années 60, Tornos, Bechler et Petermann ont durant les années 70 récupéré les naufragés de la crise horlogère. Après l’émerveillement du travail en îlots et la diversification des postes, on assiste aujourd’hui à un certain désenchantement: comment faire confiance à une entreprise qui privilégie la productivité à l’ancienneté et continue de licencier lorsqu’elle semble bien se porter?
De l’habitat aux loisirs
La vie des mécaniciens ne s’arrête pas aux portes de l’usine, et ils ont vécu de front l’amélioration de leurs conditions de vie grâce aux loisirs et à l’augmentation du pouvoir d’achat qui a marqué le pays dès l’après-guerre. L’ouvrage de Laurence Marti, Françoise Messant et Marianne Modak fait la part belle à ce pan de l’histoire des ouvriers de la machine-outil. Considérer le fait de rouler à vélomoteur comme un luxe et se retrouver quelques années plus tard en possession de deux voitures, voici un exemple trié sur le volet parmi les nombreux témoignages recueillis.
A la tête d’un laboratoire mettant en évidence les liens entre travail et famille, les auteures ont tout naturellement abordé ce thème. Elles relèvent que « bien que les tâches soient souvent séparées de manière traditionnelle, il faut souligner que dans ce secteur, le travail des femmes offre depuis longtemps une sécurité et ne sert pas seulement à partir en vacances ».
Changement de mentalité
Et lorsque les auteures demandent à un polymécanicien s’il conseillerait à ses enfants de faire de la mécanique, il répond: « Je dis oui quand même, malgré tout, si on sait bien faire de la mécanique, on sait faire beaucoup d’autres choses, c’est tellement vaste, donc on apprend une base et puis on voit… » Preuve que si aujourd’hui, il n’est plus exigé de suivre les traces de ses parents, la vision d’un héritage à transmettre est encore présente dans les mentalités.
Rébecca Reymond, Le Journal du Jura, 11 août 2005
Étude : Un ouvrage a été publié qui montre l’évolution du monde ouvrier dans le Jura bernois.
Moutier berceau de la machine-outil
Laurence Marti, à la tête d’un bureau de recherche indépendant à Aubonne, Françoise Messant, professeure de sociologie du-travail à l’UNIL, et Marianne Modak, professeure à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne, viennent de publier un ouvrage consacré aux mécaniciens de Tornos à Moutier.
Les mécaniciens. Aussi surprenant que cela puisse paraître, très peu de chercheurs se sont penchés à leur chevet. L’étude menée à Moutier par trois sociologues est donc particulièrement originale. Le passé, la vie actuelle et même le futur de ces spécialistes de la machine-outil sont décortiqués.
C’est l’histoire d’une profession, mais également de toute une région qui ressort de cet ouvrage. Une région, à la frontière du Jura et du canton de Berne, émaillée de nombreuses crises économiques. En juin 2002, le jour même où les trois chercheuses prennent contact avec Tomos, entreprise spécialisée dans la fabrication des tours automatiques, la direction annonce la suppression de 367 emplois sur 1000. « J’ai d’ailleurs été surprise de constater que la vie de ces ouvriers était faite de vagues de licenciement », déclare Françoise Messant, professeure à l’Université de Lausanne. Certains vivaient carrément leur quatorzième vague de licenciements.
Des crises dont les origines ont bien changé ces dernières années: « A l’extrême, il est désormais possible de licencier, même si l’entreprise se porte bien et que le travail est là. Cette évolution récente, les ouvriers ont beaucoup plus de difficultés à y faire face, tant elle les met devant des références et des questionnements nouveaux qui touchent au fondement même de leur rapport à l’entreprise et au travail », écrivent les auteures.
Parmi les changements, Françoise Messant souligne aussi la disparition de la figure du patron, remplacée par l’anonymat du capital. Un mécanicien se plaint, lui, de l’évolution technique du travail: « Les machines qu’on fabrique, on les monte maintenant comme du Lego. Il n’y a plus de savoir-faire, il n’y a plus de finesse, il n’y a plus de toucher… »
Un métier d’avenir
Toutefois cette étude n’est pas la chronique des événements de 2002. Les sociologues sont allées plus loin. Elles, ont analysé les conditions de vie des mécaniciens et les enjeux qui traversent leurs espaces professionnels et privés. Une surprise: malgré les bouleversements et les crises, beaucoup de jeunes de la région rêvent toujours de rejoindre Tornos. « Mais c’est une niche professionnelle pour les garçons, pas pour les filles », relève Françoise Messant. » Pour elles, il y a, beaucoup moins de débouchés. La professeure d’Université mentionne aussi que pour beaucoup de familles, envoyer leurs enfants au gymnase, c’est les perdre. Au travail et à la famille s’ajoute encore le sport.
Les propos d’un des mécaniciens interrogés illustrent cette combinaison: pour lui. Le sport pratiqué par ses enfants est un moyen de leur inculquer des valeurs qui leur seront utiles dans la vie professionnelle (s’accrocher, souffrir, vivre en groupe).
Une telle étude menée ailleurs aurait-elle débouché sur les mêmes résultats? « Non » Françoise Messant souligne que pour les ouvriers de Tornos, la région joue un rôle très important: « Elle veut conserver ses fils, les liens de solidarités sont aussi très forts. Mais à Bobst, il existe peut-être aussi une telle communauté ». A la tête de la cité prévôtoise, Maxime Zuber confirme les propos de la sociologue lausannoise: « Tornos rime avec Moutier. Avec 650 travailleurs, il est toujours le plus gros employeur de la ville. « La ville vit à son rythme, c’est le poumon industriel ». Toutefois, le maire nourrit un regret: très peu de personnes ont quitté leur contrée d’origine pour venir travailler dans la région de Moutier.
Vincent Bourquin, 24Heures, 13 septembre 2005
Mécaniciens à la « Tornos »
Saga ouvrière : Pendant trois ans, des sociologues ont suivi de l’intérieur la vie d’ouvriers employés dans une entreprise mythique: Tornos, à Moutier. L’étude a démarré en juin 2002, au moment exact où plus de 600 travailleurs étaient brutalement licenciés. Soudain, les rapports changent.
Le dur mariage des entreprises
La concentration des entreprises intervenue à Moutier au début des années 70 a conduit les mécaniciens de Tornos à la découverte progressive de l’univers de la grande entreprise. Même si sa taille n’a rien à voir avec les grands ensembles industriels des pays environnants, une concentration de près de 1000 employés, chiffre qu’atteindra l’entreprise à la fin des années 90, reste extrêmement rare à l’échelle jurassienne.
Cette concentration conduit à l’intégration forcée et difficile de cultures d’entreprises qui se voulaient jusque-là très différentes. Un ouvrier: « Quand il y a eu l’affaire Tornos-Pétermann, la première liaison qu’il y a eu, entre Tornos et Pétermann, je dois dire qu’on n’a pas été si mal acceptés pas les ouvriers de Tornos. Il y a des Pétermann qui ont dû monter chez Tornos pour travailler là-haut, parce qu’ils leur manquait des ouvriers à certains endroits, sur certaines machines, et ils se sont rendu compte…Parce que nous on disait: Tornos, c’est le goulag… » Ceux qui sont montés, les Pétermann qui sont montés chez Tornos, ils n’ont plus voulu redescendre, on s’est dit que c’était déjà pas si mal que ça. Puis après du point de vue organisation, Tornos avait une organisation, Pétermann en avait une autre, mais là on ne sentait pas trop de différences. Mais après est venu Bechler…Moi j’avais un chef de Bechler, me disait toujours: « Ah ! Chez Tornos, ils ne sont pas organisés et patati et patata. » Ou bien quand je disais: « Mais tu sais ce que tu devrais faire ça? », il répondait: « Ouais, mais toi t’es un Pétermann », comme pour dire, toi tu n’as rien à dire. C’est entre Tornos et Bechler que ça se passait, Pétermann, ça n’existait plus. « ( )
« C’était toujours un peu ces histoires-là qu’on avait, parce qu’il y en avait qui n’acceptaient pas. On les appelait les blouses rouges, ceux de chez Becher, parce que chez Bechler ils avaient tous la blouse rouge. Les chefs, c’étaient les blouses rouges, on les reconnaissait tout de suite. Alors ça n’allait pas, quand ils ont dû enlever ces blouses Et puis voilà, j’ai toujours vécu cette bagarre Tornos-Bechler, moi je l’ai ressentie plus entre les deux. Pas la haine, mais des fois de la tension très très forte, entre Tornos et Bechler, c’est vrai. Ah! c’était une rivalité, c’est fou, pour des Bechler, les Tornos c’est « des ce que je pense » et puis les torons disaient la même chose des Bechler. »
Les mêmes problèmes réapparaîtront quelques années plus tard, dans les années 2000, avec l’intégration à Tornos de l’entreprise Schäublin SA. Ceux que leurs directions avaient « éduqués » à la concurrence se retrouvent d’un jour à l’autre à devoir collaborer, remettant en question les systèmes de loyauté, autant que les modes d’organisation et les techniques jusque-là jalousement protégés.( )
L’espoir déçu
Mais surtout, pour tous, la mobilisation pour le changement représentait la possibilité de sortir du marasme dans lequel l’entreprise avait vécu au début des années 90. c’était un peu l’espoir d’un redémarrage, l’impression que tout le monde avait à y gagner, l’arrivée de sang neuf: « Dans ces huit ans, on a eu des périodes d’euphorie, on a relevé gentiment la barre, tout à coup, depuis 96 on a quand même eu de nouveaux développements très intéressants, dans le cadre de la Déco 2000, etc., donc je dirais qu’on a repris surtout espoir, on a vu qu’on avait quand même quelque chose, qu’on avait quand même du savoir-faire, qu’on arrivait à refaire des produits qui donnaient satisfaction. »
En l’espace de quelques années, une nouvelle culture d’entreprise réussit à s’imposer sans rompre, en apparence du moins, avec toutes les anciennes valeurs. Elle repose sur le souci de redorer l’image de Tornos, celle du métier et de la région tout entière, elle suscite l’espoir d’un retour possible aux années 60, qui sont de plus en plus associées à une forme d’âge d’or à l’échelle locale. L’arrivée à la direction d’Anton Menth, personnalité dotée d’un certain charisme, peut également laisser croire au retour attendu d’un « vrai » patron, ce qu’ils disent et estiment indispensable. Et c’est sans doute à mettre à l’actif du management que d’avoir réussi à créer un tel élan auquel tous ont fini par s’associer : pour vous donner une idée, Tornos a créé des tee-shirts avec son nom inscrit dessus, on les a tous achetés. » Lorsque l’entreprise entre en Bourse, en 2001, les cadres, mais aussi les ouvriers, sont nombreux à acheter des actions, pour le bien de l’entreprise, et en toute confiance, sans nécessairement être conscients des risques. « C’est vrai qu’il y en a quand même beaucoup qui ont mis entre 6000 et 10 000 francs. Ils se sont dit, plutôt que de les avoir sur un carnet, je les mets là, ça va me rapporter tant de pour-cent de plus. »(…)
La contrepartie imprévue de cet engagement, les licenciements intervenus en 2002, casse cet élan de manière brutale. Non pas tellement que ce principe soit nouveau, comme on a dit plus haut les crises sont une constante de la région et beaucoup y font référence un peu comme à une fatalité: « la mécanique, c’est bien connu c’est en dents-de-scie », mais la déception est à la mesure des espoirs qui avaient été mis dans les années précédentes. C’est un peu le retour sur terre, après quelques années de réussite. « Pendant deux ans ça va comme sur des roulettes puis de nouveau c’est la catastrophe, ça c’est dur à vivre… » « On a envie de pleurer, parce que c’est triste maintenant ce qui se passe, tomber si bas. Bon, on a peut-être trop cru à cette flambée… »( )
Un nouveau rapport à l’entreprise ?
Face à cette nouvelle donne (l’importance prise par les aspects financiers, les nouveaux critères de licenciements, etc.), ce sont le fatalisme et la résignation qui dominent au moment de l’enquête. Ainsi cet ouvrier licencié considère-t-il qu’il a « eu bien de la chance de pouvoir rester jusqu’à maintenant, et puis maintenant, une fois, c’est arrivé qu’on doive aussi y penser et puis il faut voir ce qui peut se présenter. »Certains admettent aussi qu’ils essaient de mettre le risque un peu de côté, on est obligé, parce que sinon on se dit chaque fois peut-être que demain…On ne vit plus, on est obligé de faire avec. » Une forme de déni qui évite toute remise en question. D’autres se résignent à envisager des carrières qui ne seront plus linéaires, intégrant le principe de la flexibilité: « ces prochaines années, je pense qu’il faudra être très flexible, beaucoup plus que nos parents ne l’ont été. C’était vraiment très structuré, très défini d’avance, maintenant je pense qu’en fonction des aléas de l’économie, il faudra un petit peu voir venir comme ça. » À leurs yeux, l’avenir dépend désormais de « l’économie », considérée comme un système très abstrait, peu maîtrisable, très éloigné de ces acteurs sociaux concrets que pouvaient être autrefois les patrons, les chefs ou les entreprises. Un système face auquel, là encore avec un certain fatalisme, ils estiment n’avoir plus qu’à s’adapter.( )
Peu de révolte donc, mais une forme de désinvestissement, de prise de distance face à tout projet à long terme initié par l’entreprise. « Il y a une espèce de… Comment est-ce qu’on peut appeler ça? On n’y croit plus, je ne sais pas comment dire ça. » Perceptible aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés, apparaît une diminution de rattachement, de la loyauté à l’entreprise liée à la dépersonnalisation des relations, comme aux espoirs déçus: comment est-ce qu’on peut parler aujourd’hui de loyauté? « C’est de faire son travail déjà au plus près de sa conscience. » Le lien à l’entreprise est évoqué en termes plus utilitaires, pour une durée plus limitée, avec un investissement mesuré. Les propos de ce jeune mécanicien sont certainement l’une des expressions les plus claires et les plus extrêmes que nous ayons eues de ce changement: « Tornos, ce n’est pas comme pour d’autres la moitié de ma vie, c’est une entreprise, un contrat, ça s’arrête là. Tant qu’on les arrange c’est OK, ensuite, plus rien. Le licenciement, c’est une page qui se tourne puis voilà. On fait avec. On fait son travail le mieux possible et puis on verra. »
Encadré : Chronologie d’un désastre ordinaire
1995 Après une période de marasme au début des années 90, l’usine Tornos, à Moutier, croit avoir découvert la panacée. Avec l’irruption de la machine-outil révolutionnaire Deco 2000, elle entre en pleine euphorie économique. Confiante, elle double son effectif et passe progressivement de 600 à près de 1300 employés.
1999 Un groupe anglais devient investisseur principal. L’entreprise rénove ses bâtiments, sûre d’avoir le vent en poupe. Avec le Soleurois Anton Menth, elle dispose d’un patron charismatique, perçu comme un messie par ses employés.
2001 L’entreprise entre en Bourse en mars. Encouragés par le climat, les ouvriers achètent des actions. Mais le vent tourne vite, le marché est trop instable. La tragédie du 11 septembre a de lourdes conséquences. En huit mois, l’action Tornos passe de 100 à 5 francs. Les commandes tombent.
2002 En treize mois et trois vagues de licenciements, dont une dernière de 367 ouvriers en juin, l’usine frôle la faillite. Le patron doit s’en aller à l’assemblée générale. Plus de 600 personnes sont renvoyées. Notamment les quinquagénaires, ceux qui avaient fait de cette entreprise un modèle de qualité.
2005 Avec ses 650 employés Tornos reste le plus gros employeur de la région prévôtoise. L’usine poursuit son redressement et a bouclé son premier semestre sur un bénéfice de 8,6 millions de francs.
Marc David, L’Illustré, 28 septembre 2005
Au moment où les trois sociologues débarquent à Moutiers (canton de Berne, Suisse) pour y réaliser l’enquête qui fait l’objet de ce livre, un important plan social est en cours dans la société Tornos, entreprise de machine-outil réputée. Un film, inédit en France à notre connaissance (Société anonyme), analyse les tenants et aboutissants de ces licenciements massifs. Le lectreur regrettera que les auteurs n’aient pas plus intégré dans leur travail la mobilisation qui en a résulté, mais il est vrai que tel n’est pas l’objet de leur projet. Leur enquête porte sur le changement social qui affecte un groupe social particulier, travailleurs de l’industrie mécanique, deuxième industrie après l’horlogerie de la Confédération helvétique.
L’idée directrice de Vies de mécaniciens, fondée sur les grandes enquêtes conduites pas des chercheurs britanniques au début des années 1960 (en particulier Goldthorpe et al.), est d’appréhender la vie de ces mécaniciens dans sa globalité et non simplement à partir du travail. En clair, les dimensions hors travail-famille, loisirs, résidence-sont inclues dans les préoccupations. Cela vaut aux lecteurs un exposé à la Auguste Comte, statique en première partie, dynamique ensuite. La statique, c’est précisément l’appréhension des dimensions stables dans l’existence de ce corpus d’une vingtaine d’hommes de Tornos. Le métier de mécanicien s’inscrit dans la tradition familiale d’une profession hautement qualifiée. Le prestige et l’attrait du métier imprègnent l’ensemble des dimensions d’une existence largement régie par des appartenances communautaires (en particulier dans les loisirs, mais aussi à travers la religion ou le syndicalisme). La vie familiale affiche tous les signes d’une forte division sexuelle des rôles, les hommes rapportant la paie, gérée par l’épouse, qui ne travaille pas. Ce modèle, ancien, qui a structuré ces existences ouvrières est-il en train d’évoluer? Oui, répondent les enquêtrices, mais plus par réaménagements que par révolution, voire même évolution marquée. Ces modifications sont l’enjeu de la seconde partie. À travers l’engagement professionnel, les inscriptions communautaires, la redéfinition de la famille et du hors travail, les sociologues dessinent un portrait mouvant d’une corporation et de ses familles. Au final, si la dynamique semble l’emporter sur la statique, c’est au rythme d’évolution des glaciers que ces transformations se manifestent. Si des précisions méthodologiques eussent enrichi la démonstration, il n’en reste pas moins que le lecteur dispose là d’un tableau tout à fait intéressant d’une composante de la classe ouvrière helvétique, marquée par des décennies de paix du travail.
Bulletin critique du livre en français, no 674, octobre 2005
C’est l’histoire de trois sociologues qui prenaient rendez-vous auprès de mécaniciens de l’entreprise Tornos SA, à Moutier, pour le premier d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs approfondis, principal corpus de leur recherche sur la vie de ces ouvriers dans une région où la fabrication de machines-outils est, de longue date, au cur de l’activité. La petite ville de Moutier se situe dans une vallée de la montagne suisse, à mi-chemin entre Berne et Mulhouse. Le contexte montagnard, les dimensions locale et régionale sont largement pris en compte dans cette étude alors que la spécificité helvétique, que l’on suppose prégnante, y est bien moins présente sauf, peut-être, par les caractéristiques d’une classe ouvrière moins bouleversée que de l’autre côté des frontières par les mutations du travail et de ses valeurs. Ce même 7 juin 2002, sans que les trois chercheuses le sachent, la direction annonçait la suppression de 367 des 1000 emplois de l’entreprise. « Le ton fut ainsi très vite donné », commentent-elles dès l’introduction. Un ton qui n’est en rien nouveau, lorsque l’ancienneté ne se compte plus en années de présence mais en vagues de licenciements auxquelles on a survécu. En allant la recueillir, les chercheuses avaient le souci assumé de donner la parole à ces ouvriers. Se construit dès lors un biais, repéré par les auteurs: en ne l’octroyant qu’à ceux qu’elles ont sous la main, c’est-à-dire aux hommes qui sont restés, elles n’obtiennent pas les discours de ceux qui sont partis. Rien de surprenant alors à ce que l’intérêt pour les liens locaux et l’attachement à la région se détachent parmi les préoccupations. L’étude approfondie permet de dégager des continuités, comme l’importance sans cesse réaffirmée des cafés dans la sociabilité ouvrière, des ruptures également, des assouplissements plus souvent. Les auteurs se demandent d’ailleurs si certaines constances, au demeurant atypiques comme une hérédité professionnelle que l’on aurait plus de mal à débusquer dans de grandes agglomérations, vont perdurer.
Une grande partie de la richesse de cet ouvrage vient sans doute de la complémentarité des spécialités des auteurs, leur collectif sachant allier démarches et apports de la sociologie du travail, de la sociologie de la famille, des études de genres. La vie d’un homme, nous expliquent-elles, ne se résume pas à son travail, ni celle d’une femme à sa famille et ce sont bien les immixtions réciproques qui construisent l’histoire de ces vies. Cette monographie, riche et abordant de nombreux thèmes comme souvent de tels exercices, permet de prendre la mesure de l’évolution de la vie privée et des rapports au travail, mais aussi des continuités lorsque, en dépit des lois, l’univers des mécaniciens demeure masculin: « Les apprentis qui entreprennent une formation de polymécanicien continuent en effet à être des hommes » est-il joliment écrit (p. 152). Les mutations touchent les ménages. Les épouses sont désormais qualifiées dans les secteurs des services, certes en conservant des salaires inférieurs à ceux des maris, mais les tâches ménagères se font plus communément à deux, ne serait-ce que pour dégager du temps pour des loisirs pris en commun, parce que le lien conjugal est désormais fragile et qu’il faut, de cette manière aussi, en prendre soin. Pour une activité privée devenue mixte, cet espace occupé par le couple est peut-être la principale nouveauté de la vie ouvrière, tout comme la fonction de ces loisirs qui n’ont plus à compenser un labeur exténuant, aliénant. N’ayant pas, comme les cadres, à démontrer qu’ils s’investissent dans leur travail en faisant longuement acte de présence, ces mécaniciens se contentent d’être efficaces, l’entreprise y gagne leur productivité et eux une réelle disponibilité. Dans cet univers de fabrication des machines, le processus général de qualification (80 % du personnel y est qualifié) et plus encore peut-être sa perception imprègnent le rapport au travail de ces mécaniciens, leur rapport à l’ensemble du personnel. Restent bien quelques manutentionnaires et autres travailleurs sans qualification, sans qualité serait-on tenté d’écrire, mais les mécaniciens ne sont en rien ces « ouvriers d’usine » à la tâche mal payée, répétitive, sans perspective, sans intérêt. Ce sont des « sublimes » dont on nous dresse ici le portrait, mais bien loin de ceux décrits par Denis Poulot à la fin du Second Empire, des sublimes en période de crise, des sublimes qui veulent rester attachés à leur entreprise, des salariés qui préfèrent leur statut de salarié; pas vraiment, donc, des sublimes. Ce monde ouvrier, suisse et qualifié, est bien loin de celui des usines Peugeot de ces années-là, étudié par Nicolas Hatzfeld, Stéphane Beaud, Michel Pialoux. Alors, après les ouvrages de Richard Hoggart, de René Kaës et de Pierre Sansot, après les synthèses de Michel Verret, après les thèses d’histoire ouvrière de la deuxième moitié du XXe siècle-dont la dernière, celle de Pierre Judet, Horlogeries et horlogers du Faucigy (1849-1934), sur une population ouvrière bien proche de ces mécaniciens suisses-avec Désarrois ouvriers. Familles de métallurgistes dans les mutations industrielles et sociales, de Michel Pinçon (L’Harmattan, 1987) et Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord d’Olivier Schwartz (Presses universitaires de France, 1990), ces Vies de mécaniciens peuvent s’inscrire comme un classique de la sociologie de la classe ouvrière. Je me suis cependant demandé, terminant la lecture de cet ouvrage, s’il aurait été fondamentalement différent sans ce énième plan de licenciements. Je n’en suis pas persuadé, tant ce type de précarité, tant l’incertitude du lendemain, tant le malheur du chômage font aujourd’hui partie de la vie du monde ouvrier, au point, lorsqu’ils surviennent, de n’en pas changer véritablement les perceptions.
Christian Chevandier, Genèses, No 67, juin 2007