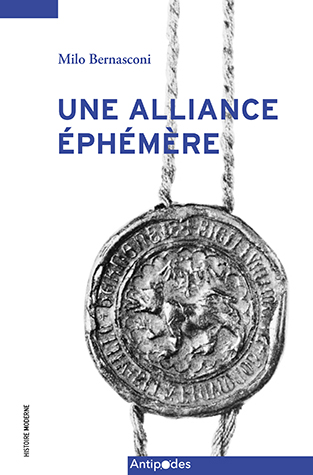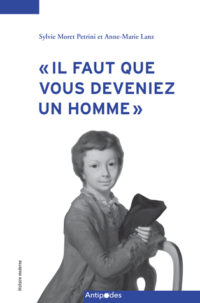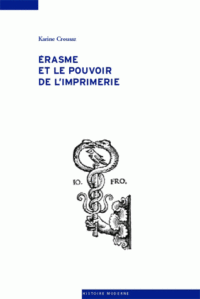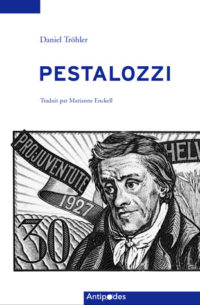Une alliance éphémère
Les relations de pouvoir entre les villes de Berne et de Lausanne: de la combourgeoisie à la sujétion (1525-1538)
Bernasconi, Milo,
ISBN:978-2-88901-245-9, 2024, 288 pages, 24€
En 1525, la ville de Lausanne signe un traité d’alliance avec la bien plus puissante ville de Berne. En 1536 cependant, les Bernois décident de conquérir le Pays de Vaud, les Lausannois ne sont non plus alliés mais sujets. Cet ouvrage propose une analyse novatrice des relations politiques entre les deux villes en se concentrant sur la correspondance échangé, et largement inédite, entre les deux villes.
Description
Le 7 décembre 1525, la ville de Lausanne signe un traité de combourgeoisie avec les villes de Berne et de Fribourg en espérant pouvoir atteindre une indépendance longtemps convoitée. Mais, onze ans plus tard, les Bernois envahissent le Pays de Vaud, en devenant les souverains des terres vaudoises. Malgré son alliance avec Berne, Lausanne devient elle aussi une sujette bernoise en 1538. Face à un laps de temps aussi court, la question concernant une préméditation bernoise est légitime. Est-ce que les Bernois prévoyaient déjà, en 1525, de conquérir Lausanne ? Pour répondre à une telle question, la correspondance de la période 1525-1538 entre les deux villes peut nous aider à dresser un contexte plus complet de celui qui a été donné jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à une analyse axée, pour la première fois, uniquement sur les lettres échangées entre les deux villes, il sera possible de considérer les relations sous plusieurs points de vue. Une analyse linguistique soutiendra l’analyse historique, cette dernière incluant les relations religieuses, militaires et judiciaires entre Berne et Lausanne. Pour chaque thématique, il sera important de considérer les attitudes des deux villes, comment les Bernois exercent leur puissance diplomatique et comment, le cas échéant, les Lausannois tentent de défendre leur position et leur envie d’indépendance. Cela nous permettra de mieux comprendre cette période fondamentale de l’histoire lausannoise et de l’influence de cette période sur les siècles successifs.
Table des matières
Préface de Karine Crousaz
Avant-propos
Problématique
État de la recherche et présentation du corpus de sources
Le Pays de Vaud et la ville de Lausanne à la veille du traité de combourgeoisie de 1525
La structure politique des deux villes et des auteurs des lettres
Analyse rhétorique du corpus de lettres
La lettre d’État à État au XVIe siècle
Les ouvertures et les conclusions des lettres bernoises avant et après 1536
L’évolution rhétorique du contenu des lettres bernoises
Entre combourgeoisie et conquête (1525-1536) : le protectorat bernois
L’ennemi commun des villes de Berne et de Lausanne : Sébastien de Montfalcon
Les relations entre Berne et Lausanne en fonction du comportement de Fribourg (1533-1534)
L’assistance militaire Lausannoise au service de Berne
Quelques exemples de comportements lausannois dénoncés par Berne
La souveraineté bernoise sur le territoire nouvellement conquis (1536-1538) : un perpétuel débat
L’assujettissement de Lausanne (1536-1538)
Les résistances à la Réformation imposée par Berne
La « bonne justice » bernoise se heurte à la coutume lausannoise
Conclusion
Liste des abréviations
Bibliographie
Annexes
1) Correspondance entre les villes de Berne et de Lausanne (de 1525 à 1559)
2) Le Conseil de Berne à l’Évêque et au Chapitre de Lausanne, le 20 octobre 1529
3) Le Conseil de Berne à l’Évêque de Lausanne, le 19 décembre 1531
4) Le Conseil de Berne aux chanoines du Chapitre de Lausanne, le 6 avril 1536
5) Chronologie
Presse
Lausanne sous protectorat
En 1525, la Ville de Lausanne signa des traités de combourgeoisie avec Berne et Fribourg pour s’émanciper des pouvoirs épiscopal et ducal. Afin d’étudier les relations politiques entre Lausanne et Berne de 1525 à 1538, Milo Bernasconi a utilisé la correspondance échangée entre leurs Conseils. De fait, son corpus se compose presque entièrement de missives des autorités bernoises. Car, malgré ses efforts, l’auteur n’a pu trouver que quelques écrits lausannois. Il a donc «reconstitué» le contenu des lettres lausannoises d’après les bernoises. Parmi les points évoqués, le soutien militaire, réciproque mais inégalitaire. Encore catholique, Lausanne prit ainsi part à la soumission de l’Oberland, aux guerres de Kappel, à la défense de Genève et à la campagne de 1536. La diffusion de la Réforme voulue par Berne, protestante dès 1528, requit de la population lausannoise de faire bon accueil à Farel.
[…]
Lucienne Hubler, Passé simple, N° 99, 2025.
Chronique du livre parue dans la Revue Historique Vaudoise
Deux parties du livre se font écho et peuvent se lire dans le sens inverse de la pagination. Pour la première fois, l’auteur réunifie par la publication l’intégralité des courriers conservés des autorités bernoises et lausannoises qu’elles ont échangés entre le 25 février 1526 et le 1er juillet 1559 (pp. 169-262). À partir de cette assise documentaire, il contextualise et commente l’évolution des rapports entre Berne et Lausanne, ayant pour cadre le traité de combourgeoisie de 1525 et la conquête du Pays de Vaud de 1536 (pp. 11-168).
L’analyse statistique du corpus reflète ses atouts et ses déséquilibres. Au nombre de 106, toutes les lettres sont rédigées en français, la langue latine dominante jusqu’alors dans les écrits officiels et administratifs se borne à la datation des missives. Parmi elles, 56 sont inédites ; seules cinq lettres sont émises par les édiles lausannois. L’avoyer et le Petit Conseil signent 79 lettres, 12 le sont par l’avoyer et le Grand et le Petit Conseils. La présence du paraphe du Grand Conseil bernois ne va pas de pair avec l’importance de chaque écrit. Les destinataires lausannois sont exceptionnellement nommés, à peine 13 fois dans les 101 lettres transmises depuis Berne. L’objet de l’assistance militaire prime dans 34 % des communications. Enfin, le nombre de 15 courriers impressionne entre avril 1536 et le début 1538, confronté à la période de 1538 à 1559, qui n’en atteste que 38.
La correspondance ne traduit pas nécessairement les arrière-pensées des interlocuteurs selon les moments. Elle offre néanmoins l’avantage de la régularité des expéditions sur d’autres natures d’information contemporaines. Sur la durée, elle permet de mesurer les pratiques et les stratégies politiques. La questionner dépasse la simple chronologie des événements.
À l’exemple de la diplomatique pour les documents en général, la correspondance obéit à des règles de composition. Elle les emprunte alors aux manuels d’épistolographie d’Érasme (1466 ? -1536) dont le fameux De conscribendis epistolis (1522) que la chancellerie bernoise paraît suivre. Qui plus est, cette dernière fut dirigée par Pierre Giron, entre 1525 et 1561, qui recourut à des traités d’écriture maison de plusieurs types d’actes, notamment des lettres.
À l’entame de son livre, l’auteur attache à sa présentation des sources, un état de la recherche pour souligner ce qu’il lui doit et l’originalité de son approche. Il le démarre avec les Guerres de Bourgogne (1474- 1476) et mentionne les productions des années 1880, 1925, 1927, 1935, 1962 et 1982. Les plus récentes sont à mettre au crédit de Michael W. Bruening (2005 et 2011), du collectif sur l’histoire de Berne, dirigé par André Holenstein (2006), de la Revue historique vaudoise (2011), « Réformes religieuses en Pays de Vaud : ruptures, continuités et résistances (m. XVe-m. XVIe siècle) » et de Karine Crousaz (2012).
[…]
Gilbert Couttaz, Revue Historique Vaudoise, 132/2024.