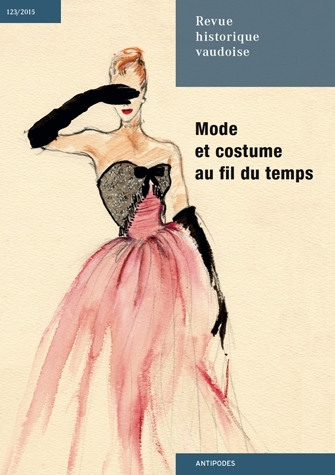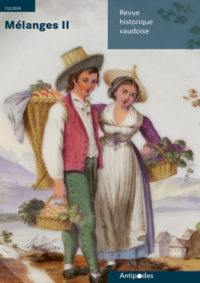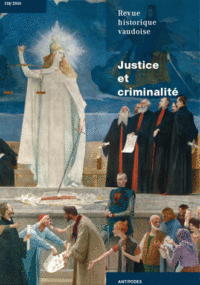Revue historique vaudoise 123/2015
Mode et costume au fil du temps
2015, 322 pages, 28 €, ISBN:978-2-88901-117-9
Bien qu’éloignée des grandes capitales de la mode, la Suisse romande possède une longue tradition liée au costume et à l’histoire de la mode. Ce dossier invite à découvrir la richesse d’un aspect souvent inconnu du patrimoine vaudois. C’est ainsi qu’au cours des 15 contributions de ce numéro luxueusement illustré, le lecteur découvrira des sujets aussi variés que l’histoire de la production des textiles, qu’ils soient de laine ou de coton; le monde des tanneurs et du cuir; la somptuosité des habits liturgiques médiévaux; l’histoire du costume folklorique; la représentation vestimentaire dans les catalogues de mode de l’entre-deux-guerres ou encore la réussite à Paris du couturier d’origine vaudoise Robert Piguet.
Description
C’est à l’histoire de la mode et du costume que s’intéresse cette 123e livraison de la Revue historique vaudoise.
Bien qu’éloignée des capitales de la haute couture, la Suisse romande possède une longue tradition liée à l’histoire de la mode et du vêtement. Les quinze contributions de ce numéro abordent des sujets aussi variés que les habits portés et fabriqués sous l’Ancien Régime, la somptuosité des habits liturgiques médiévaux ou encore l’histoire du costume folklorique entre modernité et tradition. On trouvera aussi dans ce numéro l’histoire des catalogues de la célèbre maison de vente par correspondance Charles Veillon SA.
Ce numéro consacre également de nombreuses pages à la vie et aux créations du couturier vaudois installé à Paris, Robert Piguet (1898-1953). Ce « prince de la mode » habilla en effet les célébrités parisiennes de son temps et eut comme élèves de futurs grands noms de la haute-couture tels Christian Dior, Hubert de Givenchy ou Serge Guérin.
Loin de s’attacher au seul canton de Vaud, ce numéro rappelle également la longue tradition qui lie la Suisse à la production de textiles. Ainsi, nous partirons à la découverte de la riche histoire des indiennes neuchâteloises et des broderies de Saint-Gall.
Si ce numéro invite à découvrir un aspect souvent inconnu de notre patrimoine, il se veut également un manifeste en faveur d’un renouveau de la recherche sur ce sujet. Car plus qu’une histoire de plaire ou de tissus, les vêtements et la mode constituent un fait social, culturel, sociologique et économique aux nombreuses implications.
Également dans ce numéro:
– Une histoire des chaussures en Pays de Vaud.
– Le rôle des hôteliers dans l’apparition des sports dans la région de Montreux (1880-1914).
– Les fractions de communes à Montreux: complexité administrative ou
opportunité pour le développement de la région?
Table des matières
Éditorial (David Auberson)
Dossier: Mode et costume au fil du temps
- Introduction (David Auberson)
Brocarts, laines et cotonnades
- Les vêtements liturgiques en Suisse romande du Moyen Âge à la Réforme (Sara Piccolo-Paci)
- Fabriquer le vêtement au XVIIe siècle: l’exemple d’une manufacture de laine à Yverdon (Patricia Brand)
- Les mouchoirs imprimés entre les XVIIIe et XIXe siècles: un aperçu des créations de la fabrique-neuve de Cortaillod (Lisa Laurenti)
- Les destinées de la broderie de Saint-Gall entre haute couture et copie pour la production de masse (Ursula Karbacher)
Identité et représentations
- Le costume folklorique: une question de mode? (Anne Philipona)
La mode féminine dans les catalogues de vente de la société Charles Veillon SA: les années 1920 et 1930 (Pascale Sahy)
Bijou et mode, chassé-croisé entre éternel et éphémère (Elizabeth Fischer)
Trajectoires
- Robert Piguet: le long purgatoire d’un prince de la mode (Jean-Pierre Pastori)
- La mode, c’est aussi l’affaire des Archives! Point de vue des Archives cantonales vaudoises (Gilbert Coutaz)
- Robert Piguet: leçon d’élégance d’un grand couturier suisse à Paris (Anna Corda)
Éclairages documentaires
- Vêtement technique ou accessoire uniforme, le paletot d’armure du Musée militaire vaudois (Soline Anthore)
- Revisiter des modèles du passé (Marie-Laure Chatelain)
Postface
- La mode vestimentaire, entre morale et communication (Olivier Meuwly)
Archéologie
- Une histoire des chaussures en Pays de Vaud d’après les trouvailles archéologiques (Marquita Volken)
Varia
- Un tourisme sportif? Le rôle des hôteliers dans l’apparition des sports dans la région de Montreux (1880-1914) (Fabien Favre, Philippe Vonnard)
- Les fractions de communes à Montreux: complexité administrative ou opportunité pour le développement de la région? (Nicole Meystre-Schaeren)
Comptes rendus
Hommage
Rapports d’activités
Index
Presse
La mode a toute sa place dans l’Histoire
Longtemps, le thème de la mode – considéré comme un sujet futile? – n’a pas semblé digne de l’attention des historiens. Pourtant Roland Barthes, en 1957 déjà, avait montré que la mode vestimentaire est à la fois un fait économique, culturel, anthropologique et sociologique.
C’est donc à ce sujet de la mode que le dernier numéro de la Revue historique vaudoise daté de 2015 a consacré un volume thématique. Celui-ci est en partie issu du colloque organisé en novembre 2011 par Olivier Meuwly à Yverdon-les-Bains, la ville qui par ailleurs accueille en son Château le Musée suisse de la mode.
Le volume est constitué de treize contributions fort diverses mais qui présentent entre elles une incontestable unité. On y trouvera des articles sur le vêtement liturgique en Suisse romande du Moyen-Age à la Réforme, sur le rapport entre bijou et mode (deux concepts en apparence antinomiques, l’un pérenne, l’autre éphémère), ou encore sur le vêtement comme accessoire de la cuirasse, le « paletot d’armure ». Il faut noter le fait que dix des auteurs sont des historiennes, pionnières dans ce domaine assez nouveau de l’historiographie.
Patricia Briand s’arrête sur une manufacture de laine à Yverdon, conçue par les autorités bernoises comme un lieu d’éducation pour les enfants de bourgeois se trouvant à l’assistance publique. Une visée à la fois sociale et moralisatrice. Cette entreprise ne connut qu’une existence éphémère (1695-1708), sans doute surtout à cause de la médiocre qualité des produits finis, principalement des articles de bonneterie et des bas. Pour donner à ces derniers leurs couleurs, on utilisait la garance, le safran, la camomille, l’indigo… Malgré son succès très relatif, cette entreprise rompait avec l’artisanat à domicile et annonçait l’industrie moderne.
On sait que le bas du Pays de Neuchâtel s’est spécialisé dans la fabrication des indiennes, pièces de coton imprimées qui connurent un extraordinaire engouement, passant de la noblesse et des gens fortunés aux milieux plus modestes. Ce qui illustre une fois de plus le phénomène selon lequel la mode, par esprit d’imitation, « descend » des classes aisées vers le peuple. On remarque un important progrès technique en 1780, date à laquelle le rouleau de cuivre remplace le bois pour l’impression. L’auteure, Lisa Laurenti, nous renseigne aussi sur les dessins, floraux ou de style cachemire… à la mode.
Ursula Karbacher montre, elle, les rapports étroits entre la broderie de Saint-Gall et la haute couture. La branche textile doit réinventer chaque jour, car « une fois vu signifie déjà vu, par conséquent, déjà démodé », une formule qui semble tenir lieu d’axiome de la mode.
Particulièrement intéressante, la contribution d’Anne Philipona traite du costume folklorique. Or celui-ci, qui symbolise un passé idéalisé, n’a pas existé de toute éternité! En réalité, il a été dessiné et au fond créé entre la deuxièm partie du XIXe siècle – époque de l’affirmation des identités nationales – et les années 1930. Il accompagnait les fêtes et manifestations patriotiques. Ainsi, le Village suisse de l’Exposition nationale de Genève, en 1896, fut « habité » par 353 personnes vêtues du costume dit traditionnel. On apprend aussi que ce costume (sa forme, ses couleurs) a fait l’objet de débats souvent vifs. Il est donc une (re)création – certes pas totalement ex nihilo – liée à la ferveur patriotique.
Avant de disparaître, la maison Charles Veillon SA s’est illustrée comme pionnière de la vente par correspondance. Pascale Sahy commence par dégager les rapports entre haute couture et confection, qui en est la vulgarisation à l’intention d’un large public d’acheteurs, ou plutôt d’acheteuses. Autre clé du succès de l’entreprise: le principe de la vente à crédit payable par mensualités. La deuxième partie de l’article rappelle, à l’aide d’illustrations, les canons esthétiques de la mode des années 1920 (« silhouette désencombrée, droite, longiligne, sans taille, aux hanches étroites et à la poitrine plate, presque adolescente »), puis celle des années 1930, qui correspond à « un retour à un idéal de féminité plus mûr, mais aussi plus traditionnel ». Notons au passage que c’est l’époque de la crise économique, où les femmes, les premières à perdre leur emploi, sont renvoyées à leurs tâches « traditionnelles » domestiques… Quant au port du pantalon par les femmes, il ne s’imposera pas sans luttes. Il fut d’abord admis comme vêtement de ski, circonscrit donc dans le domaine du sport et des loisirs.
Deux textes sont consacrés au couturier Robert Piguet (1898-1953), trop oublié aujourd’hui, un homme qui fit pourtant briller Paris, un créateur à l’égal des Chanel, Dior, Givenchy ou Patou. Tant Jean-Pierre Sartori qu’Anna-Lina Corda rendent un juste hommage, accompagné de nombreux dessins de mode, à ce grand styliste surnommé « le plus parisien des couturiers », pourtant issu de l’austère bourgeoisie protestante et libérale du Nord vaudois.
Oui, la mode a pleinement sa place aux Archives, comme le montre Gilbert Coutaz. Les Archives cantonales vaudoises, dont il est le directeur, contiennent d’ailleurs des fonds d’un grand intérêt, notamment ceux de Charles Veillon SA ou de Jacqueline Jonas, connue sous le pseudonyme de Line comme dessinatrice pour la publicité de vêtements dans la presse vaudoise et suisse.
Dans sa Postface, Olivier Meuwly mène une réflexion de caractère plus théorique. Il revient sur la signification sociologique et psychologique de la mode. Stefan Zweig ne voyait-il pas déjà dans les contraintes vestimentaires de la Vienne de son temps – corps cachés ou dissimulés – le symbole de l’Empire austro-hongrois finissant, de son hypocrisie et de sa phobie du sexuel?
On le mesure au terme de cette lecture éclairante de la Revue historique vaudoise: la mode est loin d’être un thème anodin et superficiel. Elle a toute sa place dans l’Histoire.
Pierre Jeanneret, Domaine Public, le 2 février 2015
Vos ancêtres les Vaudois se préoccupaient de leur mise
Des sociologues et des historiens racontent l’évolution de la mode en Suisse romande.
1935
En automne de cette année-là, à Lausanne, la jupe-culotte fait son apparition dans les catalogues de mode féminine. On en trouvera une image en teinte sépia dans la 123e livraison de la Revue historique vaudoise, fondée en 1893. Cette dernière est une analyse plus générale et diversifiée des mœurs vestimentaires des Vaudois, et de leurs voisins romands ou français, depuis le Moyen Age. Elle a été conduite par une brochette de chercheurs universitaires, qui sont remontés jusqu’à la préhistoire de la chaussure, se sont attardés sur la confection des chasubles, tuniques, étoles, et autres dalmatiques de la liturgie catholique du XIIe au XVIe siècle avant que notre contrée se ralliât à la Réforme. (Dans leur tissu sacerdotal très ouvragé se tissaient en filigrane d’or des « préférences idéologiques ».)
On rappelle qu’au XVIIe Yverdon était une capitale petite mais active de la manufacture de la laine. Que tout près, à Neuchâtel, on fabriquait des « indiennes » en ornementant des toiles de coton venues d’Orient. Un chapitre est consacré au costume folklorique des Vaudois, bientôt confiné dans les campagnes ou dans les manifestations populaires. En ville, les citadins ont appris au fil des siècles à prendre soin de leur mise, en s’inspirant des modes évoluant chez leurs suzerains savoyards, puis bernois.
Chez les patriciens, et surtout les patriciennes, on suivait de près ce qui se cousait et se portait à Paris. C’est dire si s’habiller convenablement a été chez nous une convenance importante, caractéristique de civilités locales. A l’heure où l’Unesco désigne comme patrimoines universels de l’humanité non plus seulement des sites historiques ou paysagers (tel Lavaux, depuis 2007) mais aussi des trésors immatériels, les auteurs de la RHV confèrent à raison une valeur équivalente à l’évolution de l’habit. D’autant plus qu’elle continue.
Loin des carrefours
Dans sa préface, David Auberson, historien à l’UNIL, remarque que la Suisse romande est éloignée des carrefours de la haute couture (Londres, Milan, Paris), mais qu’elle n’en possède pas moins une longue tradition liée à la mode et au vêtement. A Lausanne, la maison de vente par correspondance Charles Veillon connut dès 1947 une prospérité à l’échelle européenne. Le couturier vaudois Robert Piguet (1898-1953) s’affirma en France comme un vrai « prince de la mode », habillant des célébrités et initiant à son art des jeunots appelés Hubert de Givenchy ou Christian Dior… « A l’exemple des temps anciens, où le vêtement était un marqueur symbolique d’une identité, l’actualité récente (…) démontre que se vêtir s’associe à un message aux dimensions multiples », note Auberson en citant les débats autour du port du voile intégral dans l’espace public.
Les auteurs truffent leurs études d’anecdotes amusantes. En 1916, dans la Gazette de Lausanne, le grand dramaturge morgien René Morax (1873-1963) s’indigna en ces termes d’un costume vaudois décrété officiel: « On nous a montré une robe toute noire, jupe noire, corsage noir, fichu blanc et tablier lilas. C’est un costume de deuil, ou de femmes âgées. » Un lustre plus tard, le vêtement féminin s’orientait « vers une plus grande simplicité et une mise en valeur des formes naturelles », en dénudant leurs jambes. Un choc dans l’histoire de la pudeur vestimentaire, mais que désinhibait la mode du charleston dans les bals musettes.
Dix ans plus tard, tout change. Une dissimulation des jambes est vivement indiquée, moins par pudibonderie que par un souci d’élégance. Cette fois, les mannequins qui déambulent dans les défilés dissimulent de nouveau leurs gambettes, et s’évertuent à s’amincir le plus possible. Mais sans plus avoir recours au corset à ressorts des aïeules du siècle passé, qui était un véritable instrument de torture. On lui préfère désormais la gaine, qui « répond au vœu de l’hygiène et modèle le corps sans le comprimer ». La femme s’assouplit et se libère.
Elle ose même se parer de breloques à bon marché. « Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale, écrit Elizabeth Fischer, experte en design, que le terme de bijouterie fantaisie tel que nous le connaissons aujourd’hui va s’imposer. » Du coup, leurs fabricants ont cessé d’être méprisés comme des « faussetiers ». Plus tard, c’est-à-dire au début du XXIe siècle, viendra ce qu’elle appelle l’ère du bling, où « se joue un nouvel acte dans l’association entre mode et bijou ». Elle évoque bien sûr la vogue du tatouage et des piercings.
Gilbert Salem, 24 Heures, 9 janvier 2016