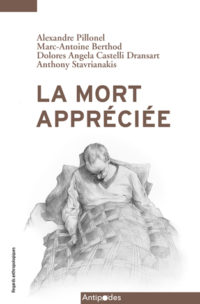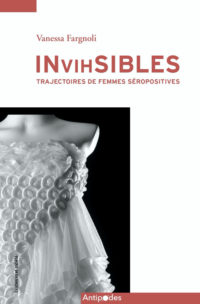L’Union démocratique du centre : un parti, son action, ses soutiens
Gottraux, Philippe, Mazzoleni, Oscar, Péchu, Cécile,
2007, 539 pages, 33 €, ISBN:978-2-940146-98-7
Le « succès » politique de l’Union démocratique du centre (UDC) conduit le politologue à s’emparer scientifiquement d’un thème qui interpelle l’espace public suisse mais aussi les commentateurs et les chercheurs au-delà des frontières: la progression de la droite dite populiste en Europe, à laquelle l’UDC est souvent associée. Ce livre entend participer à ce débat. Parler sereinement de l’UDC, peser son action dans le champ politique, analyser les soutiens que sont ses électeurs et militants, tels sont finalement les objectifs de cet ouvrage.
Description
Le « succès » politique de l’Union démocratique du centre (UDC) conduit le politologue à s’emparer scientifiquement d’un thème qui interpelle l’espace public suisse mais aussi les commentateurs et les chercheurs au-delà des frontières: la progression de la droite dite populiste en Europe, à laquelle l’UDC est souvent associée. Ce livre entend participer à ce débat. Il s’inscrit dans une sociologie des logiques plurielles (idéologiques, sociales et organisationnelles) qui caractérisent les partis politiques comme des phénomènes complexes. Il combine plusieurs angles d’attaque pour aborder une série de questions: Comment définir l’UDC, parti singulièrement controversé? Quelles sont les difficultés liées à son étude? Comment expliquer sa capacité à se situer à la fois en posture de gouvernement et d’opposition? Comment son action a-t-elle influencé et tiré parti des transformations du paysage politique suisse? Que doit la progression de l’UDC aux changements affectant le champ médiatique? Qui sont ses électeurs? Comment s’exprime sa propagande politique? Comment se décline la diversité de valeurs de ses militants?
Parler sereinement de l’UDC, peser son action dans le champ politique, analyser les soutiens que sont ses électeurs et militants, tels sont finalement les objectifs de cet ouvrage.
Presse
Dans la revue CiNéMAS
Le problème du son est-il en train de devenir « l’endroit où les choses se passent » dans le cadre de la réflexion sur le cinéma? Non seulement les travaux concernant cette question se multiplient, renouvelant considérablement le sujet, mais ils ont d’ores et déjà conduit à plusieurs propositions de redéfinition de l’histoire du cinéma. Ainsi, dans Une archéologie du cinéma sonore, Giusy Pisano (2004, p.4) revendique-t-elle une histoire « problématique, non point événementielle, mais discontinue et hétérogène, qui se propose sans cesse d’élargir les champs […] ». Édouard Arnoldy (2004) plaide, lui, Pour une histoire culturelle du cinéma. Dans Silent Film Sound, Rick Altman (2004, p.7) est encore plus catégorique: « Today we are beginning to understand the need for nothing less than an entire redefinition of film history, based on new objects and new projects. » Le son est bien évidemment l’un de ces nouveaux objets.
L’ouvrage d’Alain Boillat s’inscrit dans ce mouvement avec une double originalité; d’une part, Boillat centre ses réflexions sur les « manifestations vocales » du son, ce qui n’est pas si fréquent, même si les choses sont en train de changer (1), d’autre part, il vise non pas à renouveler l’histoire du cinéma, mais la théorie. Encore ne faut-il pas se méprendre: vouloir renouveler la théorie ne veut pas dire se désintéresser de l’histoire et réciproquement; la différence n’est qu’une question d’angle d’approche: dans les ouvrages précédemment cités, il s’agissait de renouveler la théorie de l’histoire; pour Boillat, il s’agit de mettre en évidence « les conséquences théoriques de l’analyse historique » (p.484) pour mieux comprendre le fonctionnement communicationnel du cinéma.
Le champ couvert englobe toutes les manifestations vocales au cinéma sauf la voix spectatorielle (François Albera le note dans sa préface). Personnellement, je pourrais certes regretter qu’il ne dise rien du fonctionnement de la parole dans le film de famille, mais il me semble qu’après tout, ce serait sans doute plutôt à moi de traiter ce sujet. On aurait d’ailleurs bien mauvaise grâce à reprocher ces omissions à l’auteur vu la taille déjà très impressionnante de l’ouvrage et toutes les questions qui y sont brassées. La documentation historique sur laquelle s’appuie Boillat est sans faille; la liste des références théoriques ne l’est pas moins. Le texte se caractérise par un souci rare de la nuance et de la précision dans la discussion avec les chercheurs qui ont abordé les questions qui y sont étudiées, au risque, parfois, d’entraîner certaines longueurs et de perdre un peu le lecteur. Il témoigne également d’un goût marqué de son auteur pour les typologies (Metz aurait sans doute adoré) et pour les grilles d’analyse fonctionnant sur le modèle de la liste de questions à se poser. Le résultat est la production d’une quantité incroyable d’outils qui constitue assurément l’un des apports majeurs de l’ouvrage. Quant aux réflexions théoriques elles-mêmes, elles manifestent une volonté obstinée de faire jouer les notions les unes par rapport aux autres, de les déplier, de les décliner et de les pousser dans leurs retranchements, les interrogations sur une notion conduisant à d’autres interrogations sur d’autres notions, et ainsi de suite… au point que l’on finit parfois par avoir un peu de mal à les raccrocher à l’axe de pertinence d’ensemble de l’ouvrage, un axe qui lui, en revanche, est très clair: la dialectique de l’humain et du machinique au cinéma, visitée à travers la question de la voix. La voix n’est-elle pas, en effet, de façon emblématique, ce qui introduit « de l’humain dans un moyen d’expression caractérisé par sa nature mécanique » (pp.17-18)? Cette dialectique fonde le plan de l’ouvrage: du bonimenteur à la voix-over, de la voix vive à la voix fixée, et va sous-tendre la réflexion de Boillat tout au long de ses 500 pages.
Enfin, on ne peut qu’être frappé par l’importance donnée à l’analyse des discours et aux analyses de films. Les discours sont, en effet, bien souvent, tout ce qui reste pour tenter de reconstituer les usages et les réactions des spectateurs (Soillat propose de parler d’audiospectateurs). Ils constituent, également, une source capitale pour articuler approche historique (ils sont situés dans le temps) et approche théorique (ils posent des questions). Tout L’occhio del Novecento, le bel ouvrage que Francesco Casetti a consacré au statut du cinéma dans la société, n’est-il pas fondé sur une analyse du réseau de discours que le cinéma a suscité (« a partire dalla rete dei discorsi sociali » [Casetti 2005, p.270])? Dans l’ouvrage de Soillat, c’est le chapitre V, consacré à « La voix-attraction dans l’histoire du cinéma » (pp. 263-313) qui me paraît être l’exemple le plus remarquable de ce type d’analyse. Quant aux films, l’index en recense plus de 230, des films de tout genre et de toute époque, des films que l’auteur convoque non pas comme de simples illustrations, mais au contraire en se servant de leurs analyses pour faire apparaître les problèmes théoriques. Il reste que ces analyses ont aussi leur valeur propre et conduisent à la mise en évidence de la spécificité de l’uvre étudiée. Parfois, elles débouchent sur de véritables études. Le chapitre consacré au Roman d’un tricheur (pp.165-196) qui comporte, également, l’analyse de Ceux de chez nous et de De 1429 à 1942 ou de De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain, déploie de fait toute la relation de Sacha Guitry à la parole de cinéma, montrant en particulier son inventivité en termes de dispositif et de structuration textuelle, inventivité qui en fait un précurseur de la modernité. D’autres études, portant sur des couples de films, permettent des comparaisons éminemment productives: Lola Montes et ses deux versions, avec ou sans flashback (pp.254-262); Frankenstein et sa suite, La fiancée de Frankenstein (pp.307-313); Hiroshima mon amour et son remake, H Story, par Nobuhiro Suwa (pp.449-482).
Face à une telle richesse, à un tel foisonnement, on comprendra qu’il ne saurait être question ici, pour moi, de proposer un compte rendu détaillé de l’ensemble de l’ouvrage. En théoricien, je me contenterai de pointer les caractéristiques majeures de l’approche mise en uvre et parfois de discuter quelques points, non pas tant pour en faire la critique que pour ouvrir le débat.
De façon un peu paradoxale (on pourrait dire aussi, de façon quelque peu provocante), Boillat propose d’opérer le renouvellement de la théorie en recourant à ces approches oh combien inactuelles! – pas plus que tout autre domaine, la théorie n’est exempte de phénomènes de mode: aujourd’hui il faut être philosophe, esthéticien ou historien… – que sont la sémiologie (Metz), la narratologie (Genette, Gardies) et la théorie de la communication de Jakobson (l’auteur étudie les différentes fonctions du boniment en se fondant sur ce modèle, p.117 sq.). Boillat fait la démonstration que pour peu qu’on les articule avec l’histoire, ces approches fournissent des outils opératoires pour faire surgir des questions jusque-là peu posées. Pour peu qu’on les articule avec l’histoire: la précision est capitale. Dans cette perspective, on ne s’étonnera pas de me voir noter avec satisfaction que Boillat se revendique de la sémio-pragmatique, qui place les déterminations contextuelles au point de départ de toute analyse: « La prise en compte de la réception filmique, écrit-il par exemple, s’appuiera sur la construction théorique d’un spectateur tel que le déterminent une institution, un dispositif et une représentation donnée. » De même, conformément au programme sémio-pragmatique – c’est le sens même de la dénomination: manifester qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre approche textuelle sémiologique (immanentiste) et pragmatique, mais seulement une mise en perspective -, Boillat propose de « réintroduire la composante textuelle », mais en la présentant comme « fortement déterminée par l’extérieur » (p.20).
Selon Boillat lui-même, les deux chapitres qui ouvrent l’ouvrage et qui sont consacrés à la « voix vive » sont essentiellement là pour fournir la base théorique et factuelle (notons la prolifération de dispositifs présentés) qui permettra de mieux comprendre la voix-over: « La voix-over constitue en fait le point de mire de mon étude […] » (p.30); et plus loin il précise: « je pense en effet qu’en réfléchissant dans un premier temps à la question de l’oralité, on est ensuite plus armé sur le plan théorique pour aborder le statut de la parole enregistrée du cinéma parlant » (p.37). Il n’empêche que ces chapitres constituent en eux-mêmes une contribution non négligeable à l’étude de la projection bonimentée: distinctions entre « relations verticales » (relations entre les composants visuel et sonore) et « relations horizontales » (relations entre la représentation et la machinerie qui la produit), réflexions sur boniment et « discours intérieur », proposition d’une grille d’analyse des sources vocales (types, emplacement, visibilité) et des modes de projection, typologie des formes de synchronisation de la parole du bonimenteur avec les images du film (synchronisation vocogestuelle, vococinétique, dans ou sur l’image, de mise en cadre ou de mise en chaîne)(2), etc.
Un autre des apports de l’ouvrage est le suivant: la discussion de la conception de Germain Lacasse du cinéma bonimenté comme « pratique de résistance ». Soillat note que ce n’est qu’une possibilité parmi d’autres et qu’il « convient de ne pas réduire les interactions entre le film, la voix et le public à une fonction sociopolitique définie, sous peine de ne pouvoir rendre compte des différentes modalités très diversifiées qui ont régi l’usage de la voix lors des projections bonimentées », mais il ajoute aussitôt qu’il faut reconnaître qu’en tant que pratique se situant au niveau de l’exploitation, la parole bonimentée « constitue une source potentielle de déviation du sens et des valeurs véhiculées par les films » (p.35). Mais l’apport le plus nouveau de ces chapitres est, me semble-t-il, la démonstration que, contrairement à ce qui a été souvent avancé, la présence d’un bonimenteur ne conduit pas obligatoirement à la production d’un effet de distanciation; je souligne obligatoirement car Boillat ne nie pas que cet effet puisse être produit, mais veut poser la possibilité d’un autre pôle: la parole bonimentorielle peut, en effet, favoriser l’immersion du spectateur dans le film. Et Boillat de préciser avec finesse que cela ne signifie pas la production de l’effet fiction: il y a moins « suspension de l’incrédulité qu’attitude participative à laquelle engage toute pratique vivante associée à la performance » (p.107). De telles remarques témoignent de la qualité de pensée de l’auteur. Plus généralement, avec ces deux exemples, on a une belle démonstration de la façon de faire de Boillat lorsqu’il entreprend de discuter les propositions d’autres chercheurs: respect, nuance, volonté d’éviter toute affirmation trop abrupte, souci d’examiner tous les aspects de la question.
Dernière remarque sur ces chapitres: on soulignera le culot de l’auteur lorsqu’il se sert de l’analyse d’un DVD montrant la reconstitution, en 1997, d’une séance Méliès au Musée Grévin – c’est-à-dire de l’analyse d’une « trace d’une séance elle-même trace d’une pratique passée » (p.163) – pour donner corps à sa réflexion. Il fallait oser… Toutefois, si l’analyse est en elle-même brillante, ses résultats sont, de l’aveu même de son auteur (elle ne « permet bien sûr d’illustrer qu’un nombre restreint d’options », reconnaît-il), un peu minces: de fait, outre que cette séance bonimentée témoigne « de l’intérêt rencontré par le « cinéma » parlé à la fin du XXe siècle », tout ce que peut noter Boillat sur la stratégie du bonimenteur dans cette séance est que l’accent est mis sur le représenté, alors que la mécanicité (le dispositif) et la technicité (les trucages) sont occultés (p.163).
Mais revenons à la dialectique de l’humain et de la machine. Boillat met en évidence comment, dans le cas du film bonimenté (ce qu’il appelle le cinéma parlé vs le cinéma parlant), est à l’uvre non seulement une médiation humaine (dans le film parlé, quelqu’un « (me) parle du film », p.60), mais une médiation machinique que le spectateur ne peut ignorer: celle du projecteur qui se trouve dans la salle, figure radicale de l’altérité face à l’humain. Boillat fait le tour des discours auxquels a donné lieu la question du bruit du projecteur (Prévost, Arnoux, Auric, Altman, Barnier, etc.) et corollairement celle de l’intervention de la musique et celle de la création de cabines de projection insonorisées, moins pour contribuer à une histoire des techniques que pour montrer que les spectateurs ont tout à fait conscience de la présence du machinique au cinéma et qu’il convient donc d’en prendre acte au niveau de la théorie.
Boillat choisit ensuite de centrer sa réflexion sur les années 1927-1931, une période de transition, « l’interrègne du parlant » (p.197). Il entreprend de comparer cette période avec celle des années 1895-1908, non pour nier « l’extranéité » du cinéma des premiers temps (Gaudreault), mais pour dégager « quelques grands paradigmes théoriques utiles à une réflexion sur les régimes vocaux du cinéma » (p.198). De fait, la réflexion avait déjà entrepris dans le chapitre précédent cette analyse du Roman d’un tricheur, qui lui avait permis non seulement de s’interroger sur « les liens entre boniment et voix-over » (p.167) mais aussi d’amorcer une théorisation des relations entre « exhibition vocale » (p.180), posture de « conteur » (telle que décrite par Benjamin) et narration. Au chapitre IV: « Les fondements théoriques de la voix-attraction » (pp.165-196), Boillat aborde le problème dans toute sa généralité, isolant – construisant devrait-on plutôt dire, car comme il le souligne, les objets auxquels il s’attarde sont des « objets purement théoriques qu’il s’agit d’appréhender comme des instruments analytiques » (p.202) – quatre régimes vocaux: la voix-action (les occurrences vocales internes à la diégèse, les dialogues diégétiques), la voix-explication (discursive), la voix-narration et la voix-attraction (« elle fait primer la relation directe au spectateur sous forme d’adresse », p.212).
C’est cette voix-attraction que Boillat propose « d’ériger en dénominateur commun » aux deux périodes (p.197) car, et c’est là que l’on se rend compte combien est astucieux le choix de la deuxième période analysée, les années 1927-1931 se caractérisent « par le transfert de pratiques orales vivantes vers l’enregistrement magnétique » (p.177). Mais que l’on y prenne garde, « ériger en dénominateur commun » ne signifie pas transférer purement et simplement la notion d’attraction d’une période historique à une autre; au contraire, il s’agit de fixer un axe commun pour mieux faire apparaître les différences. Boillat souligne ainsi « l’importance épistémologique de la rupture qui s’opère avec la découverte et la généralisation du principe d’inscription de la voix » (p.222). C’est que la voix enregistrée fait d’emblée partie du film: techniquement, matériellement, elle est donnée dans le même mouvement de défilement que l’image; ainsi, même lorsque cette voix fonctionne sur le mode de l’attraction, l’intégration au film est plus forte que dans le cas avec le bonimenteur: elle n’est plus une composante de l’exploitation des films (de la performance), elle n’est plus liée à un corps présent dans la salle, mais devient un élément constitutif du texte filmique. Encore convient-il de préciser que si la voix-over fait partie du texte filmique, elle constitue un « premier niveau d’intégration » dont les paramètres ne sont pas textuels, mais techniques (p.223). Là encore, la preuve est faite que la théorisation ne saurait ignorer le machinique.
Boillat n’en néglige pas pour autant l’aspect textuel, dont il montre la complexité tant au niveau structural qu’au niveau pragmatique, les deux n’étant d’ailleurs pas dissociables. Dans le très beau passage qu’il lui consacre, il note, par exemple, que le chant est d’emblée plutôt du côté de l’attraction (p.231 sq.). De plus, les différents régimes vocaux peuvent se retrouver tant du côté de la voix vive que de la voix fixée, mais avec des modalités et des degrés de manifestation divers. Ainsi « la voix-action peut tendre vers la voix-narration » (p.209), et bien que voix-attraction et voix-narration soient opposées, « il se peut que des manifestations vocales empruntent simultanément certains traits à l’un et à l’autre » (p.211); plus généralement la narration peut coexister avec tous les autres types (p.218).
Toutes ces analyses s’inscrivent dans le programme général énoncé par Boillat visant à « élaborer une conception graduelle et polyvalente de l’ancrage du son dans la représentation visuelle » (p.23). C’est là l’un des leitmotivs de l’ouvrage. Boillat ne cesse de plaider pour que l’on ne considère pas les catégories de façon rigide mais « comme autant de bornes jalonnant un spectre continu » (p.230). Pour Boillat, cette approche est susceptible de régler bien des problèmes. Ainsi, on a souvent dit qu’il n’était pas possible de rendre compte de ce qui passe dans la relation images/sons avec les trois critères que sont voix in, off et over, « or, note Boillat, une conception graduelle de ces notions abroge cet obstacle méthodologique » (p.25). J’avoue ne pas en être certain, car, comme je l’avais montré dans un texte très ancien (Odin 1978), ces notions sont entachées d’une tare originelle: elles proviennent de l’espace de la réalisation et ce n’est pas en les transformant en « notions graduelles » que l’on changera leur statut, mais en reprenant à la base le problème de la construction des sources sonores par le spectateur (l’ouvrage va d’ailleurs dans ce sens dans certaines de ses analyses). Quoi qu’il en soit, s’il est vrai que l’idée d’une approche graduelle est extrêmement séduisante, elle pose aussi bien des problèmes. Et d’abord, est-ce que tout est traitable en termes de degrés? Peut-on, par exemple, réellement parler de degrés de narrativité? Certes, il y a des récits plus complexes que d’autres, mais on est dans le mode narratif ou non, la complexité des récits est un autre problème. Certes, il y a des textes qui font une part plus grande que d’autres au récit, mais dans ce cas, c’est une autre conception du graduel qui est convoquée: le graduel par combinatoire. Mais comment, alors, évaluer la part de tel ou tel régime dans un film? Par une étude quantitative? Par une étude structurelle (repérer quel est le régime dominant dans la structure)? Mais est-ce que cela correspondra à l’effet produit sur le spectateur? De même, Boillat propose « une conception graduelle du marquage énonciatif » (p.408). Mais « graduel » me semble avoir ici encore un nouveau sens: l’existence de différents « niveaux » de marquage. L’idée est juste, mais pourquoi parler de graduel? Plus généralement, que faut-il donc entendre par « graduel »? Bien d’autres questions pourraient sans doute être encore posées. Que l’on me comprenne bien, il est indiscutable que la « conception graduelle » proposée par Boillat conduit à des analyses théoriques d’une grande finesse et qu’elle donne même certains résultats non négligeables (comme l’analyse du couple intégration vs non-intégration, qui est l’un des couples structurants de l’ouvrage), mais dès que l’on commence à vouloir théoriser la notion elle-même, les ennuis commencent…
Le dernier chapitre théorique de l’ouvrage est consacré à la question de l’énonciation: « Voix-narration et énonciation filmique » (chapitre VI, pp.315-448). On peut s’étonner de voir la question de l’énonciation liée à celle de la voix-narration. Pourquoi ce régime vocal plutôt qu’un autre? A priori la question de l’énonciation concerne tous les régimes vocaux. La réponse tient au fait qu’un des objectifs essentiels de Boillat dans ce chapitre est de « renouveler la question de l’énonciation » en dénonçant ce qu’il considère comme la position dominante sur ce point (mais je ne suis pas certain que ce soit réellement le cas): le primat donné à la dimension humaine dans l’approche de l’énonciation (c’est François Jost qui a initié le mouvement pour le cinéma). Or c’est à propos de la « voix narrative » que le lien énonciation-humain a été au préalable établi dans le cadre de la théorie littéraire (Gérard Genette, William C. Booth) qui pose « la voix de l’auteur » comme source énonciative première. Mais, remarque Boillat, « ce qui est (à la rigueur) valable pour la littérature ne l’est par contre aucunement pour le cinéma » (p.319), où l’énonciateur est toujours collectif (on notera la réserve « à la rigueur », réserve que je partage pleinement, mais il n’y a pas lieu de développer ce point ici). Pour Boillat, « même lorsqu’il se manifeste verbalement en déléguant fictivement sa fonction à une instance diégétique, le « narrateur filmique » doit son existence à la technologie phonographique, c’est-à-dire au pôle machinique » (p.326). Boillat propose donc la construction d’un modèle de l’énonciation « bifide » (p.487), avec une branche humaine et une branche machinique. De fait, il complique un peu les choses en introduisant l’idée qu’il est du « ressort d’une théorisation de l’énonciation filmique que de décrire les niveaux auxquels certains types de marquage de la matérialité sonore peuvent se manifester » (p.407). Or la matérialité ne se limite pas au machinique: par exemple, le « grain de la voix » (cher à Barthes) relève de la matérialité sonore.
La définition de l’énonciation proposée par Boillat vise à recouvrir ces différents aspects. L’énonciation est l' »ensemble des opérations humaines et techniques nécessaires à la production de la représentation » (p.383). On voit le danger de cette façon de concevoir l’énonciation. Tout peut être considéré comme nécessaire à la production de la représentation: la structure économique qui produit les films, les conditions historiques dans lesquelles le film se fait, l’état de la société tout entière, etc. Où s’arrêter? Dans la suite du texte, toutefois, Boillat établit une limite: il pose que le marquage énonciatif n’a d’existence que si le spectateur en prend conscience; ce que le théoricien doit analyser, c’est le marquage énonciatif « inféré » par l’audiospectateur: ce ne sont donc pas « toutes les opérations […] nécessaires à la production de la représentation » qui seront finalement retenues comme constituant la structure énonciative. Boillat n’en insiste pas moins sur la nécessité de prendre en compte la « multiplicité des lieux potentiels de marquage » énonciatif (p.421): de l’émission vocale à la prise de son, de la captation au montage en passant par le travail de postproduction sur le son lui-même (qui peut conduire à des transformations), de la projection (avec ses modalités techniques) à la réception par le spectateur. L’idée qu’il défend est que chacun de ces lieux a sa spécificité et que la construction de la structure énonciative opérée par le spectateur n’est donc pas unitaire mais multiple et complexe (cf. le schéma de la p.447). Je partage tout à fait l’idée selon laquelle le spectateur construit une structure énonciative complexe et peut conférer le rôle d’énonciateur à toute une série d’instances de statuts très divers. Dans ma tentative pour caractériser la lecture documentarisante (Odin 2000), j’amorçais d’ailleurs une telle analyse en suggérant que le spectateur d’un documentaire pouvait être amené à construire comme énonciateur le cameraman, le spécialiste responsable du contenu, l’institution dans laquelle le film a été fait… et même la caméra (donc du machinique). Boillat va plus loin dans son intégration du machinique et il a raison. On soulignera d’ailleurs qu’il ne nie nullement la présence d’une instance humaine énonciative; son objectif est seulement de « nuancer le postulat anthropomorphique » (p.32; toujours ce souci de faire des propositions mesurées). Il consacre même de très longs développements à cette dimension, reconnaissant par exemple que la voixover « dispose d’un potentiel énorme d’humanisation » en raison de « l’absence intrinsèque d’ancrage dans la diégèse visualisée » et « de l’impression donnée que les images « naissent » des mots » (p.424). On notera avec amusement ce petit paradoxe: l’objet majeur de l’ouvrage, la voix-over, est précisément ce qui va le moins dans le sens de la reconnaissance par le spectateur de la dimension machinique de l’énonciation. Ce n’est pas le moindre mérite de Boillat que d’avoir compris la force de stimulation que serait pour sa recherche le choix d’un objet, si l’on peut dire, « à rebrousse-poil » de ce qu’il voulait montrer (un objet résistant).
On le voit, on est là en face d’un ouvrage doublement important: d’une part, pour la théorie du son au cinéma – Boillat en a bien conscience, qui note: « Une conception générale des manifestations vocales comme celle que j’entends proposer ici est inédite dans le champ des théories du cinéma » (p.27) -, d’autre part, pour la théorie du cinéma en général: outre la masse d’outils d’analyse proposée et la multitude de pistes et de questions ouvertes, le plaidoyer de Boillat pour la prise en compte forte du machinique dans la théorie ne devrait pas rester sans effets. Certes, le machinique n’était pas jusque-là absent de la réflexion sur le cinéma, loin de là, mais il est vrai qu’on avait un peu tendance à l’oublier lorsqu’il s’agissait de poser des questions théoriques de l’ordre de celles abordées ici par Alain Boillat. Remettre cette dimension à l’honneur est d’autant mieux venu que le développement de nouveaux dispositifs (Imax, jeux vidéo, films tournés sur téléphone, Internet) la rend plus que jamais nécessaire… et il est probable qu’elle ne devrait pas se limiter au son.
Roger Odin, CiNéMAS , vol. 20, no 2-3, pp.225-237
Notes:
1. Un bon indice de ce changement est le succès du colloque international « Pratiques orales du cinéma » organisé en octobre 2007 à Montréal par Germain Lacasse.
2. A ce propos, je me permettrai un étonnement d’ancien linguiste. Énumérant (p.83) les unités susceptibles de donner lieu à synchronisation: le phonème, le mot, le syntagme, la phrase, le texte, Boillat précise: « je préfère opter pour le terme courant de mot au lieu de morphème car il renvoie à une unité plus nettement repérable dans le flux oral ». Pourtant l’on sait bien que le mot est très rarement isolé et difficilement isolable dans le flux de la parole où il fait bloc avec les morphèmes (déterminants en particulier). Les linguistes parlent parfois de « monèmes » pour désigner cette combinatoire de lexèmes (les mots) et de morphèmes.
Dans 1895
Construite sur les vestiges d’une cinéphilie qui avait essayé de penser ensemble histoire et esthétique (dans des directions très diverses, de Sadoul à Bazin), la réflexion universitaire sur le cinéma, en France, s’en est paradoxalement éloignée très vite, au moins sur ce point. Désormais, on travaille soit dans le domaine esthétique, soit dans le domaine historique, et les passages de l’un à l’autre sont généralement considérés avec suspicion. Conséquence ultime de cette évolution: les systèmes théoriques récents se sont affranchis de tout ancrage historique et ne permettent plus vraiment de penser le cinéma, mais tout juste de porter sur lui des regards esthétiques très subjectifs. Force est de reconnaître, dans ce contexte, que les travaux théoriques les plus stimulants (parce que prêtant simultanément à discussion et à application dans l’histoire du cinéma), récemment, viennent d’horizons plus lointains (Canada, Suisse, etc.) et le livre d’Alain Boillat en apporte une nouvelle preuve.
Voilà en effet un ouvrage qui, comme on le dit familièrement, « en impose »: par son volume (pourtant la réduction d’un manuscrit plus épais encore), ses ambitions et, surtout, son envergure. Car ce qui caractérise sans doute le plus ce livre, c’est sa faculté à brasser un corpus filmique, des théories multiples, des références diverses (recherches doctorales, documents de première main, souvent méconnus, « fondamentaux » en histoire et théorie du cinéma, de la littérature, de l’art, etc.) autour d’une problématique fascinante, les différents « régimes de la voix » au cinéma (comme on parle des « régimes de l’image » au moins depuis Deleuze ou Rancière). Ce livre s’inscrit ainsi dans la foulée des travaux de Michel Chion ou d’Alain Masson qui ont, voici quelques années maintenant, rendu grâce au son du cinéma, et à la voix en particulier. Le livre de Boillat suit également les voies tracées par des études conduites au Québec, autour d’André Gaudreault et de Germain Lacasse, intéressées par l’oralité, dans une perspective à la croisée de l’histoire (du cinéma) et de la narratologie. Enfin, cet ouvrage participe d’un mouvement d’ampleur de recherches consacrées à l’histoire du son et de la voix en histoire du cinéma (avec Rick Altman en éclaireur, puis Édouard Arnoldy, Martin Barnier et Giusy Pisano, notamment).
L’intérêt qu’il suscite provient de cette capacité à s’inscrire dans un champ, c’est-à-dire à en faire le bilan, à en discuter certaines hypothèses et avant d’en formuler de nouvelles. Son idée se base initialement sur la nécessité de penser simultanément la voix au cinéma d’un point de vue matériel et d’un point de vue fonctionnel: pour ce qui est de sa matérialité, la voix peut être vive et/ou enregistrée ; pour ce qui est de sa fonction, elle peut relever plutôt de la monstration ou plutôt de la narration. Le couplage de ces deux dimensions doit alors permettre de couvrir l’analyse de tous les usages de la voix à travers l’histoire du cinéma -ce qu’Alain Boillat se propose d’essayer de faire, en appliquant ses réflexions à des objets aussi disparates que les films de Méliès, Le Roman d’un tricheur, Lola Montés et Hiroshima mon amour.
On le voit: le plus grand mérite d’Alain Boillat est incontestablement d’avoir considéré l’indissociabilité de questions d’histoire, d’esthétique et de théorie. Il faut le souligner avec insistance, car un tel dessein est le plus souvent un vu pieux, une belle intention, toujours réitérée, rarement éprouvée. Or, ici, il s’agit de Il est possible de rencontrer dans un play2win casino en ligne une roulette sans zero. cela: mettre à l’épreuve des perspectives généralement disjointes et reprendre le fil de la théorie du cinéma plutôt délaissée ces dernières années (une théorie enfin en crise?)1. Voilà donc un ouvrage audacieux mais qui n’oublie pas, pour autant, d’articuler cette audace générale (repenser l’ensemble d’un champ) à des pauses théoriques très concrètes: Boillat fait montre d’une capacité peu répandue à, simultanément, théoriser et synthétiser, notamment en construisant, sur les divers objets dont il s’empare, de rigoureuses taxinomies, qui constituent d’éclairants outils pour des recherches à venir (par exemple sur les différents degrés de déliaison de la voix-over, pp. 342-343). Certes, on pourrait pointer, ici et là, quelques excès sur ce plan: l’auteur paraît se sentir contraint de faire une sorte d’état des lieux sur chaque point théorique soulevé, au risque, parfois, que cette structure en tiroir finisse par se refermer sur le lecteur, qui peut éprouver quelques difficultés à suivre le fil de la réflexion. Disons que si cette forme d’écriture se justifie sans aucun doute pour une thèse, sa pertinence paraît peut-être moins évidente dans un cadre éditorial.
Le principal mérite de cet ouvrage est donc que le cinéma, les films ne sont pas sacrifiés sur quelque autel que ce soit la théorie, l’histoire. D’ailleurs, l’analyse d’un film, Hiroshima mon amour, est à l’origine du projet doctoral d’Alain Boillat. Les films abordés par lui sont en effet très nombreux. À cet égard, on apprend dans la préface de François Albera que la thèse dont est tiré ce volume consacrait également quelques développements à René Clair et certains de ses films (on imagine plusieurs dizaines de pages, attendues avec impatience). C’est dire si ce travail accorde une place prépondérante au film dans son dispositif, entre histoire et théorie. Ce qui, hélas, est trop rare dès qu’il s’agit de faire de l’histoire ou de la théorie du cinéma ! Au regard des ambitions de l’auteur, clairement affichées, concernant les croisements de la théorie, de l’histoire et de l’esthétique, on ne peut pas pourtant dire, comme François Albera dans sa préface, qu’une perspective esthétique traverse avec la même assurance les différents chapitres de cet ouvrage. Les choix méthodologiques de l’auteur ne l’entravent pas, certes, mais elles ne favorisent pas toujours le déploiement de questions d’esthétique. D’abord parce que les films sont souvent convoqués pour exemplifier certains points théoriques et non pour être véritablement analysés dans une perspective plus simplement esthétique. Si Boillat a probablement raison de vouloir se distancier « des approches américaines du type de celle de Bordwell qui, dans une optique simplificatrice tendant à juger la théorie sur la base de sa seule productivité immédiate en termes d’analyse de film, refuse de facto le cadre des théories de l’énonciation » (p. 387), la perspective qu’il adopte est, pour tout dire, inverse et s’expose donc au grief exactement contraire. De plus, la multiplication des films convoqués contribue aussi, paradoxalement, au manque d’approfondissement des questions esthétiques. De nombreux films, de genres et d’époques épars, sont parfois juste évoqués, pas toujours analysés. Peut-on d’ailleurs en faire le reproche à l’auteur ? Certainement pas, car ce livre -marqué par la sémiologie et la narratologie, aujourd’hui en perte de vitesse dans les études cinématographiques et qu’il réhabilite avec vigueur- frappe par son unité: de ton (sans fioriture, précis, concis, direct) et sur le fond (un fil conducteur tient l’ensemble, sans accroc, sans « passage à vide »). N’empêche, l’esthétique est un peu laissée sur les bas-côtés de ce projet sans doute insatiable. La « gourmandise » est certes une des principales qualités de l’auteur, dont l’érudition est absolument stupéfiante (Boillat nous mène parfois en des terrains improbables avec une conviction certaine: de Zumthor Gaudreault, via Ricoeur ou Metz). Encore faut-il ne pas donner le sentiment de vouloir à tout prix goûter tous les mets, au risque de les avaler trop vite ou d’en laisser de beaux morceaux de côté. Certains des auteurs convoqués méritaient sans doute davantage qu’une présence juste citationnelle, sans réelle portée théorique. On pense à Walter Benjamin auquel l’auteur se réfère à propos de Sacha Guitry. On ne souscrit pas sans réserve au titre même du chapitre qui invoque sans grande nuance le dramaturge cinéaste comme un « conteur au sens de Walter Benjamin ». Trace ostensible d’une thèse dont le livre n’est pas expurgé de toutes ses séquelles, ce passage par Benjamin paraît forcé et, sans doute, inutile, dans la mesure où ce détour n’apporte pas grand-chose à l’analyse du Roman d’un tricheur -et fait bien peu de cas de la portée du texte de l’intellectuel allemand.
Paradoxalement, la dimension tentaculaire de ce livre met en relief ses manques. On songe ici à la dimension historienne de ce travail. L’auteur a bien raison de mettre en garde son lecteur, d’entrée: « le titre du présent ouvrage n’entend connoter aucune conception évolutionniste », envisageant plutôt « une analyse comparée de la voix vive et de la voix fixée lorsqu’elles sont couplées à des projections d’images animées ». L’auteur arrive, effectivement, à ses fins: éviter la chronologie linéaire. Vieux débat, de fait, qui mérite d’être sans cesse d’être repensé -même s’il ne faut pas faire par principe table rase de la chronologie en histoire (on le sait depuis Foucault). Avec la même facilité qu’il circule parmi des concepts théoriques, uvrant à des « combinatoires aléatoires » (évoquées par Albera), Boillat vaque au gré de l’histoire du cinéma afin de privilégier une méthode à vocation comparatiste. Encore une fois, peut-on lui reprocher de ne pas s’être plus sérieusement attardé en des moments singuliers et problématiques de l’histoire du cinéma ? Sans doute. À plus forte raison que Boillat paraît plutôt sensible aux moments où se posent crûment des questions d’histoire, de théorie, à l’histoire du cinéma, notamment la fin des années vingt et le début des années trente, quand plusieurs films (de L’Herbier, de Colombier, de Duvivier, de Guitry, de Florey, entre autres, le Chanteur de jazz et quelques-uns des « premiers parlants » compris) exposent cette question des chevauchements de « deux régimes de voix », la « voix-attraction » et la « voix-narration », lorsque le cinéma passe insensiblement du muet au parlant. Cette faille dans le corpus filmique et cette tentation hégémonique met en perspective les risques d’une ambition historienne démesurée. Cet arrêt méritait sans doute d’être effectué, a fortiori si l’on se souvient des ambitions de ce livre, car une halte eut sans doute permis de prendre alors la pleine mesure de l’indissociabilité de questions d’histoire et d’esthétique, et sa dimension problématique. Une remarque du même ordre peut être formulée au sujet des sources « non-film », dont le corpus pose parfois problème: si Boillat convoque beaucoup de sources premières peu utilisées et très pertinentes, il a tout autant recours à des sources secondaires, pas toujours suffisamment interrogées comme telles. Il en est ainsi, par exemple, des références au Cinéma-Bouffe d’Arlaud, qui évoque le bonimenteur (il y a d’ailleurs une coquille dans le numéro page indiqué: il s’agit de la page 79 et non 69) dans le cadre du cinéma des premiers temps, mais le fait d’un point de vue résolument téléologique (page 69, justement, tout comme Sadoul à la même époque, Arlaud voit dans le Cinéorama une pre »mière expérience de « cinéma total » selon l’expression contemporaine de Barjavel). Pour autant, cela n’invalide pas le contenu de la citation mais il est tout de même étonnant que ces sources secondaires soient si peu « critiquées », au sens historiographique que les méthodistes donnaient à ce terme. De plus, le choix de citer telle ou telle source secondaire n’est pas toujours véritablement justifié. Ainsi, Du muet au parlant, d’Alexandre Arnoux est étudié parce qu' »il n’est pas possible d’évoquer ici toutes les figures majeures de la réception critique de cette époque » (p. 267), alors qu’il paraît avoir été retenu surtout parce que ses textes travaillent, contrairement à d’autres de cette période, la dimension attractionnelle du son. Bref, la singularité de ces réflexions, bien que déterminante dans l’analyse de Boillat, se trouve dissimulée derrière une prétendue exemplarité.
Ce que l’on pointe ici, c’est en quelque sorte les limites de l’extraordinaire ambition de ce travail, qui, prenant le risque d’investir à la fois les champs théoriques, esthétiques et historiques, se trouve confronté à la difficulté de satisfaire simultanément aux réquisits de ces trois disciplines. Mais ce ne sont là que des « défauts » mineurs et pour tout dire, presque impossibles à éviter -en regard de la portée de l’ouvrage, clairement plus théorique qu’historique. Bref, si ce livre peut être discuté (ou doit être discuté, comme tout essai qui s’emploie à renouveler le discours sur un champ), c’est plus sur ce qu’il propose que sur ses usages de l’histoire. Et si l’on peut difficilement objecter des contre-arguments à l’hypothèse de Boillat, qu’il impose avec la force de l’évidence, il est néanmoins possible de remarquer que, parfois, la connaissance actuelle de l’histoire du cinéma paraît réduire quelque peu l’ampleur de ses conclusions. Deux exemples suffiront à l’esquisser: analysant la dimension sonore du muet, Boillat affirme que « le bonimenteur n’est pas assimilable à un élément « mécanique » puisque son rôle consiste précisément à contrebalancer, par une plus-value d’humanité, la technicité inhérente à la composante visuelle du dispositif » (p. 42) puis, plus loin, qu' »une autre source de perturbation réside dans les voix qui proviennent du public » (p. 135). Si ces deux affirmations, clairement disjointes dans l’ouvrage, peuvent être rapprochées c’est parce que dans les deux cas la place et/ou la perception du spectateur font problème et que ces deux hypothèses ne sont guère étayées par des sources premières. De fait, en l’état, rien ne permet d’affirmer définitivement que la composante visuelle était perçue (comme elle peut l’être aujourd’hui) dans sa nature technique, ni la composante sonore dans sa nature « humaine », ni même que les voix des spectateurs étaient ressenties, par les uns et les autres, comme une perturbation. Ce qui fait défaut ici, au niveau historique, c’est la prise en compte (bien sûr impossible dans le cadre de l’étude de Boillat) d’un large corpus de témoignages sur la réception, comme a commencé à le constituer Martin Barnier, dans le cadre d’un travail pour l’habilitation à diriger des recherches, pas encore publié. Cette recherche historique en cours montre surtout que la théorie tend peut-être un peu trop à mettre au singulier « la parole », « le spectateur ». Mais le mérite du travail de Boillat est justement de permettre, dorénavant, aux historiens d’utiliser, pour l’étude de ces pluriels à travers l’histoire, des outils conceptuels dont l’auteur montre parfaitement la validité: il ne peut s’agir de reprocher à Alain Boillat de lancer la balle aux historiens, mais plutôt de souhaiter que ceux-ci la prennent au bond.
À bien des égards, le projet d’Alain Boillat est donc salutaire car il rappelle avec vigueur la prévalence d’une problématique dans une recherche (en histoire ou en esthétique du cinéma, indistinctement). En ce sens, Boillat réaffirme ce que trop d’historiens oublient un peu vite -trop soucieux de « l’exactitude » des faits. En cela, l’auteur peut très bien reprendre à son compte la judicieuse injonction d’un historien, Lucien Febvre, qui invitait à privilégier « une histoire non point automatique, mais problématique ». Une histoire qui reste partiellement à faire et, dorénavant, avec les notions forgées par ce livre.
Édouard Arnoldy et Laurent Le Forestier, 1895, no 55, juin 2008
1. Voir Roger Odin (dir.), La Théorie du cinéma, enfin en crise, Montréal, CINEMAS, printemps 2007, vol. 17, n° 2-3.
Sur Kritikat.com
Fondateur de la revue bi-annuelle Décadrages cinéma à travers champs et auteur de La Fiction au cinéma (L’Harmattan 2001), Alain Boillat a consacré sa thèse à la voix au cinéma. Il nous en propose ici une version abrégée sous forme d’une réflexion théorique et historique sur la nature et l’emploi du matériau vocal au cinéma. De la voix vive du bonimenteur du cinéma parlé à la « voix in » enregistrée puis restituée du cinéma parlant, de la « voix off » d’un locuteur diégétique hors champs à la « voix over » d’un énonciateur désincarné, absent du monde même du film, c’est toute la richesse de la problématique de l’utilisation de cet autre propre de l’homme qui s’exprime ici.
A la fin des années 1930, le parlant supplante définitivement son prédécesseur, l’intégration de la voix se généralise et se standardise. En 1936, Sacha Guitry réalise « une uvre à la fois volubile et proche du cinéma muet »: Le Roman d’un tricheur. Ce film, que Panofsky qualifiait de nostalgique, donne littéralement la parole à la voix over en la prenant aux acteurs. L’extinction de la voix synchrone se fait au profit d’un énonciateur omniprésent qui explore toutes les nuances du registre vocal over: description des images, distanciation vis à vis de la représentation, connivence avec le spectateur, pouvoir de manipulation des événements se déroulant à l’écran Conteur et ventriloque, Guitry venu du spectacle vivant aime à mélanger les genres d’où le statut paradoxal de son film qui, fixé sur pellicule, tient pourtant de la performance unique. Il ira jusqu’au bout de cette démarche en 1938 où la séance de Quadrille est interrompue afin que le troisième acte soit joué sur scène et, en 1942, quand Fernand Ledoux intervient dans l’action du court-métrage La Loi du 21 juin 1907. François Truffaut et Alain Resnais ont affirmé le rôle fondateur du Roman d’un tricheur dans leur propre utilisation de la voix over. Présente dès le générique comme pour mieux camper son statut démiurgique-Que le film soit et le film fut- la voix over chez Guitry oscille dans « un mouvement contradictoire d’exhibition et d’effacement ».
Monteur de formation, Alain Resnais a le goût des structures narratives et formelles complexes et raffinées où la voix, qu’elle soit attraction (On connaît la chanson en 1997), narration (L’Année dernière à Marienbad en 1961) ou de régime mixte (I Want To Go Home en 1989) est toujours à l’honneur. Grâce à la postsynchronisation systématique, paroles et images se combinent et participent de la morphologie subtile voulue par le réalisateur. Alain Resnais tourne en 1959 sa première uvre de fiction, Hiroshima mon amour qui fera date dans l’histoire de la voix au sein du dispositif cinématographique en juxtaposant trois régimes de voix over. L’explosion atomique du prologue s’accompagne d’une voix proche du documentaire qui permet de camper toute l’horreur de l’univers dans lequel se déroule l’action. Puis, le récit en flash-back où la voix over est le moyen de la mise en place de l’enchâssement narratif. Enfin la voix intérieure qui escorte les déambulations de la Française dans les rues d’Hiroshima. L’enchaînement des différentes fonctions reflète les stades successifs d’intériorisation du personnage féminin, les phases progressives de construction de sa propre identité. Cette singularité même de l’usage de la parole a valu au film de Resnais le qualificatif peu élogieux de bavard tant il est vrai que le procédé n’est pas sans engendrer un certain malaise. Tout au long du tournage au Japon, la voix de Marguerite Duras a accompagné Resnais sous forme de cassettes envoyées régulièrement par l’écrivain, rien d’étonnant alors à ce qu’il ait chercher « à créer chez le spectateur une sorte d’hypnose ». A n’en pas douter, « la voix du film est celle de Duras elle même » et le spectateur est soumis « à l’emprise d’une conscience ».
En 1996, Jean Châteauvert dans Des mots à l’image, la voix over au cinéma avait brosser le portrait protéiforme de cet usage si particulier de la parole: « le narrateur en voix over peut parfois lire l’image, l’ignorer, s’éclipser dans certains segments du film, réapparaître dans d’autres et, plus encore, assumer des fonctions qui sont liées à la matérialité même du récit filmique ». Alain Boillat complète et enrichit le débat en mettant en valeur « les vertus humanisantes et unifiantes de la voix over » ainsi que sa faculté « d’immersion du spectateur dans le monde du film » prenant ainsi le contre-pied de l’opinion commune qui voit surtout en elle un facteur de distanciation. Une voix désincarnée qui « tel un esprit plane au dessus du monde diégétique » et donne corps au film. Désormais la parole n’est plus le parent pauvre de la recherche cinématographique mais un domaine à part entière disposant de ses propres critères d’analyse.
Emmanuelle Romeyer, 26 février 2008, Critikat.com
Sur le site Bibliothèque du film
L’ouvrage est la version réduite d’une thèse soutenue en 2006 à l’université de Lausanne sous la direction de François Albera. Cette publication nous fait partager l’énorme complexité théorique de l’approche d’Alain Boillat, dont les nombreux exemples d’analyses filmiques permettent à la fois d’aérer et d’illustrer ses propos très denses.
L’auteur propose d’examiner le phénomène de la voix au cinéma, et plus particulièrement la voix-over, dans une approche sémiopragmatique considérant à la fois la représentation et les différents paramètres qui définissent les dispositifs du cinéma parlé et du cinéma parlant, distinction qui est à la base de sa réflexion.
L’originalité de cette approche est sa conception matérialiste de l’énonciation filmique. L’auteur problématise les spécificités machiniques de la production sonore au cinéma, basée sur une dichotomie entre la voix vive (la voix-attraction) et la voix fixée (la voix-narration). Pour saisir les différents paramètres qui régissent le fonctionnement de ces deux types de manifestations, l’auteur remonte loin dans l’histoire de la voix liée aux spectacles antérieurs au cinéma tels que les projections de lanterne magique ou le vaudeville. Une fois le lien établi, il s’attache avant tout au phénomène du bonimenteur du cinéma des premiers temps et renoue ainsi avec la théorie du « cinéma des attractions 1 » d’André Gaudreault et de Tom Gunning, qui lui permet d’analyser l’interaction entre l’homme et la machine au sein du dispositif cinéma. La présence du bonimenteur est très courante au début du cinéma, son rôle étant d’accompagner de ses propos les projections. Cette « attraction vocale » peut avoir plusieurs fonctions : résumer l’histoire du film, inventer des dialogues aux personnages ou encore commenter ce qui se passe à l’écran. Parmi les figures phares du cinéma des premiers temps, Méliès aimait parfois se faire le bonimenteur de ses propres films. Nous invitons le lecteur à découvrir son univers qui se prête remarquablement à cette pratique à travers l’exposition qui se tient actuellement à la Cinémathèque française.
Le boniment est le lieu d’exercice d’un régime vocal singulier (la voix-attraction) qui, selon l’argument de Boillat, revient à l’époque du parlant sous la forme de la voix-over. Contrairement à d’autres études, Alain Boillat défend l’hypothèse que le boniment s’inscrit déjà dans une dichotomie de monstration-narration 2. En analysant Le Roman d’un tricheur de Sacha Guitry, Alain Boillat discute les liens entre les pratiques du boniment et la voix-over et démontre comment les pratiques orales vivantes ont dérivé vers l’enregistrement phonocinématographique. L’auteur distingue quatre régimes vocaux qu’il examine sous une approche historique et linguisticopragmatique. Ce sont la voix-attraction, la voix-action, la voix-explication et la voix-narration. La voix-attraction se positionne dans une logique triangulaire considérant le niveau technique, le niveau esthétique et la réception par le spectateur, tandis que la voix-narration, et donc la voix-over, se situe du côté de l’intégration narrative. Une des fonctions fondamentales de la voix-over est de « créer un monde »; l’analyse d’Hiroshima mon amour illustre bien ses propos.
À plusieurs reprises, l’importance de l’aspect technique émerge de son travail; rappelons que la fixation de la voix à la fin des années 1920 est en elle-même un facteur d’intégration et doit être considérée indépendamment du régime vocal proprement dit.
La lecture de ce livre peut s’avérer ardue pour qui n’est pas familier avec les théories linguistiques diverses sur lesquelles Boillat appuie sa réflexion. C’est que l’auteur a une double formation de linguiste et d’historien et une franche inclination pour les travaux sémiologiques. Néanmoins, il réussit à dégager d’une manière exemplaire le rôle de la voix dans une double perspective, celle des conditions matérielles de la production mécanique et celle de l’élaboration fictive d’un pôle humanisant.
Bernadette Ac, BiFi
1. Pour ce concept, voir l’ouvrage The Cinema of attractions reloaded de Wanda Strauven. Il contient également l’article fondateur de la théorie de Tom Gunning et André Gaudreault « Le Cinéma des premiers temps: un défi à l’histoire du cinéma? » qui propose de repenser la période de 1895 à 1910 comme une valorisation de sa production cinématographique: revoir ces films dans la perspective de l’attraction, au lieu de se plier aux concepts narratifs, apparus seulement dans les années 1920.
2. Le terme est emprunté à la théorie de Gaudreault.
Sur le site de l’Institut Jean Vigo
Ce travail très solide, publié avec le sérieux des éditions lausannoises, pose clairement son objet qui fera parcourir un vaste espace de l’histoire du cinéma: il s’agit de réinstaller la voix « comme un des facteurs [discursifs] essentiels de l’organisation des films parlants ». Mais l’auteur commencera en amont, consacrant un bon tiers du livre à la période muette, et mêle avec dextérité les considérations théoriques à l’analyse historique. À contre-courant des modes de notre temps, il se permet même de réhabiliter l’analyse sémiologique, chose dont on lui sait gré. Sa bibliographie est ample et intègre en particulier les travaux en langue anglaise comme ceux de Rick Altman.
L’idée directrice est la suivante: la voix, dans un film, est « le facteur emblématique de l’humain » à l’intérieur d’un moyen d’expression mécanique. C’est dans le conflit de ces deux postulations que tout se joue. La présence d’une voix, directe ou enregistrée, occulte plus ou moins la « réalité machinique » du spectacle cinématographique et incite le spectateur « à se figurer mentalement une origine humaine de l’ensemble de la représentation ».
Pour avancer dans son hypothèse, Alain Boillat met au point une double typologie. La première se place sur le plan des conditions matérielles et oppose voix « vive » et voix enregistrée; la seconde intervient au niveau fictionnel et oppose deux régimes, la voix « attraction » et la voix « narration » (on reconnaît le couple conceptuel d’André Gaudreault). En fonction de ces deux couples notionnels, le cinéma se partage selon des lignes qui ne recouvrent pas forcément les divisions académiques. En particulier, le parlant n’est pas la rupture que l’on dit: au sein de celui-ci, survivent pendant longtemps des particularités qui étaient celles du muet, ou plutôt d’une partie du muet, car dans ce dernier, cohabitaient des films de l’un ou de l’autre type.
Boillat appelle « cinéma parlé » le dispositif spécifique dans lequel la voix, extérieure au film, raconte celui-ci au spectateur (on parle du film, le film est objet); et « cinéma parlant » celui dans lequel la voix est intégrée: on parle dans le film, le film est sujet. Cette distinction, parfaitement claire et argumentée, ouvre effectivement des horizons nouveaux à la réflexion théorique aussi bien qu’à la réévaluation de ce que l’on dit du son et de la parole dans le muet et dans le parlant.
Du point de vue de l’histoire, Boillat est conduit à valoriser certains moments particuliers: la période des premiers temps, précisément celle où existaient les bonimenteurs (1895-1908), déjà bien étudiée mais autrement par Germain Lacasse; la période de l' »interrègne » entre muet et sonore (les années 1927-1932), comme l’a jadis dénommée Noël Burch. Mais il fait aussi une place à certaines uvres emblématiques de la « modernité » comme Hiroshima mon amour, que cette entrée problématique permet de relire avec un regard nouveau.
Une théorie sous-tend toute cette analyse, appuyée sur une approche pragmatique et une philosophie globalement cognitiviste. Le cinéma (selon une idée de François Albéra) appartient de manière native au domaine de l’oralité et il faut donc envisager le spectacle filmique comme étant au départ une performance. Cela est particulièrement probant dans le cas du bonimenteur de la période muette. Cette idée nous vaut un excellent chapitre sur ce phénomène singulier, dans lequel est établie une relation avec les travaux du médiéviste Paul Zumthor sur la poésie orale. Car le cinéma descend de types de performances très antérieurs à lui[1]. Le bonimenteur remplit toute une série de fonctions entre le film et le public, analysées ici finement, qui pourraient toutes se ramener à un rôle de traducteur. Sa présence physique est toujours perceptible par le spectateur, mais à des degrés divers. Plus la synchronisation est précise (déjà dans les tentatives au temps du muet), plus cette présence s’efface et la voix « émigre au sein de l’espace de la production ». Mais il arrive que, dans le premier parlant, cette intégration ne soit pas achevée. C’est ce que démontre le chapitre consacré au génial Roman d’un tricheur de Sacha Guitry.
À l’occasion de cette réflexion sur l’oralité dans le cinéma et sur les fonctions de la voix over, Boillat élargit largement son sujet et parle aussi du bruit du projecteur- faisant justice de la légende répandue qui prétend que la musique avait pour première fonction de le couvrir-; il évoque le bruit du public dans la salle; il parle de la musique d’accompagnement. Soit toute une série de manifestations d’extériorité au monde filmique. Mais pour l’essentiel, c’est aux diverses fonctions de la voix que l’ouvrage est consacré, et il permet de revoir d’autres idées reçues comme celle qui voudrait que la voix over soit un effet de distanciation: il croit tout au contraire (et pense le démontrer) que la voix du bonimenteur, ou certaines voix over du parlant, produisent un effet de « présentification » du corps qui l’énonce. Il récuse aussi l’idée de Noël Burch selon laquelle cette voix serait directive et « disciplinaire »: elle pouvait tout autant produire de la jouissance, certains témoignages l’attestent.
En somme, c’est un principe de plaisir qui se trouve rétabli dans ce phénomène de longue durée, principe de plaisir qui s’inscrit contre la domination du machinique et du virtuel dans lequel nous sommes sans doute majoritairement immergés.
François de la Bretèque, Institut Jean Vigo, 15 février 2008
Bonimenteurs et narrateurs
Le cinéma des premiers temps (appellation usitée pour pallier le terme péjoratif de « cinéma primitif ») était muet. Cette assertion, admise par le grand public, est en réalité inexacte car le cinéma muet était souvent « parlé », sonorisé en direct par une personne racontant l’histoire, un bonimenteur. Vers la fin des années 20, lorsque le 7e art est devenu parlant. les bonimenteurs ont cédé leur place à d’autres narrateurs. qu’ils soient un personnage commentant en voix off l’histoire qu’il vit ou une voix omnisciente ne faisant pas partie du récit, une voix sans corps appelée voix-over.
Pour Alain Boillat, maître-assistant à l’Université de Lausanne, il existe « cinq matières de l’expression cinématographique »: les images, les bruits, la musique, les mentions écrites et la voix. C’est sur cette dernière qu’il se penche dans Du bonimenteur à la voix-over. Une imposante analyse qui pourra certes se révéler ardue pour qui n’est pas familier avec l’histoire des théories du cinéma, mais s’avère exemplaire dans sa manière de multiplier les exemples concrets et, comme le note le professeur François Albera dans sa préface, de renouveler les réflexions d’illustres aînés comme Roland Barthes, Christian Metz, Gérard Genette, Jean Mittry ou Michel Chion.
SGO, La Liberté, 12 janvier 2008
Du bonimenteur à la voix-over: un ouvrage d’Alain Boillat pour les cinéphiles
Du bonimenteur à la voix-over est le titre de l’ouvrage que vient de publier, aux éditions Antipodes, Alain Boillat, docteur ès Lettres et maître-assistant à la Section d’ Histoire et Esthétique du Cinéma à l’Université de Lausanne. Ce livre est, en fait, extrait de la thèse de doctorat de l’auteur et propose une réflexion historique et rhétorique « à propos de la place et de la fonction conférées à la voix qui est une manifestation foncièrement humaine au sein du médium qu’est le cinéma ».
Alain Boillat, qui est l’un des spécialistes les plus pointus de l’analyse de la voix au cinéma, s’interroge d’abord sur l’accompagnement verbal qu’offrait en direct (live) un locuteur, le bonimenteur, à l’époque des débuts du cinéma et du film muet. Par la suite, il va rendre compte des diverses spécificités de l’oralité du cinéma parlé pour confronter ensuite la médiation, qui s’opère au sein de ce dispositif, aux principes de la voix enregistrée, notamment en ce qui concerne le cas particulier de la voix-over.
Cette dernière se distingue de la voix-in (émanant d’un locuteur visible à l’image) ainsi que de la voix-off (associée par le spectateur à un locuteur hors-champ), par le fait qu’elle renvoie à une source verbale qui est un énonciateur absent du « monde du film ». Cette voix renvoie, par conséquent, à un sujet dont on n’a pas d’image et qui n’a donc pas de « corps ». La voix-over dessine, par conséquent, « un lieu à habiter, un non-corps à revêtir qui est le corps du film ».
Après une première vague dans le film « noir » américain des années 1940, qui fut étonnamment audacieux (un mort pouvait se faire le narrateur de ses dernières heures), puis chez Orson Welles et Jean Cocteau notamment, le cinéma « moderne » fera largement usage de cette « disjonction » (Alain Resnais, Jean-Luc Godard).
L’émergence des « nouvelles technologies » n’a, en fin de compte, pas modifié la place et la fonction attribuées à la voix dans le domaine de l’exploitation cinématographique et cela même dans les productions ayant massivement pu intégralement recours à l’image de synthèse. En effet, la voix continue à être exploitée comme la trace d’une expression humaine individuelle, reconnaissable dans sa « nature prophonographique ». Il y a la voix « action », régie par le principe du synchronisme qui assure un simulacre réaliste de l’humain en occultant toute part « machinique », la voix-attraction, issue des spectacles vivants et susceptible d’être mise en scène sur la base d’une interactivité fictive dans un film parlant et, enfin, la voix-narration ou voix-explication, où le verbal se met au service d’une intégration au discours filmique pour susciter l’impression qu’il est à l’origine de ce dernier. L’auteur arrive à la conclusion que la voix-over est appelée à connaître un nouvel essor avec l’ Internet et avec des supports tels que le CD-ROM ou les jeux-vidéo.
Enfin, en abordant de façon systématique les modes de synchronisation et les relations sémantiques qui s’installent entre les mots et les images, Alain Boillat a conçu des instruments pour l’analyse filmique qu’il applique à certaines oeuvres singulières du point de vue du régime vocal telles que Le Roman d’un tricheur de Sacha Guitry, Lola Montès de Max Ophuls ou encore Hiroshima mon amour, d’ Alain Resnais.
La voix in, off, over: qui parle au cinéma ?
Dans Du bonimenteur à la voix-over, Alain Boillat, maitre-assistant à la section d’histoire et esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne, propose une réflexion historique et théorique sur la place et la fonction conférées à la voix au sein du médium qu’est le cinématographe. La voix « résonnait déjà dans les salles à l’époque improprement nommée « muette » et, selon l’auteur, elle constitue « un facteur essentiel de l’organisation discursive du film parlant, lorsqu’elle apparaît sous une forme over, détachée du monde du film » pour commenter, raconter et faire pénétrer le spectateur dans un environnement ou dans la conscience d’un personnage.
Alain Boillat est au micro de Nicole Duparc
RSR, Espace 2, 24 octobre 2007, Nicole Duparc