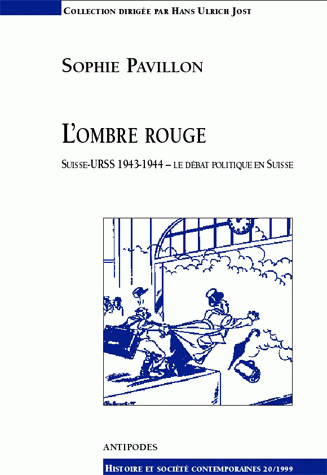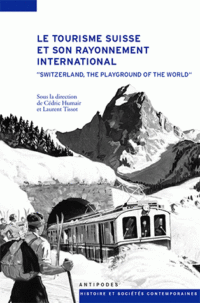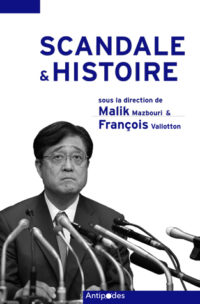L’Ombre rouge, La tentative d’établissement de relations diplomatiques avec l’URSS par la Confédération helvétique et le débat politique en Suisse (1943-1944)
Pavillon, Sophie,
1999, 324 pages, 17 €, ISBN:2-940146-13-6
Au moment où la bataille de Stalingrad fait basculer la Seconde Guerre mondiale en laissant entrevoir l’imminence d’une victoire des Alliés sur l’Axe, un grand débat s’ouvre en Suisse à propos de l’URSS. Il s’agit de réexaminer les relations entre l’État fédéral et l’Union soviétique à la lumière des récents événements. Des milieux de plus en plus larges réclament un établissement de relations officielles avec l’URSS, que ce soit pour inscrire la Suisse dans les relations internationales issues de la guerre ou pour ouvrir à l’économie helvétique le grand marché russe. Dès lors, le régime autoritaire stalinien est évalué en fonction de ces enjeux; la dénonciation des crimes du stalinisme s’en trouve réduite à la portion congrue.
Description
Au moment où la bataille de Stalingrad fait basculer la Seconde Guerre mondiale en laissant entrevoir l’imminence d’une victoire des Alliés sur l’Axe, un grand débat s’ouvre en Suisse à propos de l’URSS. Il s’agit de réexaminer les relations entre l’État fédéral et l’Union soviétique à la lumière des récents événements. Des milieux de plus en plus larges réclament un établissement de relations officielles avec l’URSS, que ce soit pour inscrire la Suisse dans les relations internationales issues de la guerre ou pour ouvrir à l’économie helvétique le grand marché russe. Dès lors, le régime autoritaire stalinien est évalué en fonction de ces enjeux; la dénonciation des crimes du stalinisme s’en trouve réduite à la portion congrue.
Le gouvernement de Staline refuse d’établir des relations diplomatiques avec la Suisse, en novembre 1944. Traitée de « profasciste » par les médias soviétiques, puis par une partie substantielle des médias internationaux, la politique du gouvernement suisse pendant la guerre est sévèrement critiquée. Après quelques escarmouches entre la gauche et les partis bourgeois, un front uni se soude en Suisse, pour veiller à ce que le pays sorte de son isolement international aussi rapidement que possible.
Presse
Die Schweiz und die Sowjetunion
Der Weg zur Wiederaufllahme der Beziehungen mit Moskau
Zwischen 1918 und 1946 hatte die Schweiz keine Beziehungen zu Russland. Sie waren abgebrochen worden, weil die Schweiz den kommunistisch gewordenen Staat bezichtigt hatte, sich über seine Berner Mission in die innenpolitischen Querelen des Generalstreiks eingemischt zu haben. Obwohl die handelspolitischen Kontakte zu Russland und spiiter zur Sowjetunion nicht vôllig unterbunden wurden, stellten diese « beziehungslosen Zeiten » für die Schweiz eine Ausnahmesituation dar. Normalerweise bedeutete die Neutralitiit, dass unser Land diplomatische Kontakte mit allen Ländern zu unterhalten suchte. Rigoroser Befürworter der diplomatischen Nichtanerkennung war der Vorsteher des Politischen Departementes in den zwanziger und dreissiger Jahren, Bundesrat Giuseppe Motta. Er stützte sich dabei auf eine damais in der Schweiz weit verbreitete antisowjètische Haltung. Vor allem im bürgerlichen Lager befürchtete man, dass eine Anerkennung Tür und Tor für die kommunistische Propaganda öffnen würde.
Erst die veränderte internationale Situation nach 1942, ais die Vereinigten Staaten, Grossbritannien und die Sowjetunion sich zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen Hitler-Deutschland zusammenschlossen, brach die rigorose Abwehrhaltung der Schweiz auf. Bundesrat Marcel Pilet-Golaz hatte zwar versucht, die Politik Mottas fortzusetzen, aber er geriet von Ende 1942 an in immer härtere Bedrängnis. lm Sommer 1944 machte Pilet via London den Versuch, mit Moskau Gesprllche aufzunehmen. Doch der Kreml zeigte ihm die kalte Schulter und lehnte nun seinerseits die Normalisierung ab. Erst nach Ende des Krieges gelang es Pilets Nachfolger Max Petit pierre, zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen. lm Sommer 1946 wurden zwischenden beiden Staaten die diplomatischen Kontakte wieder hergestellt.
Ideologie statt Aussenpolitik
Die Auseinandersetzung um die Anerkennung der Sowjetunion durch die Schweiz ist mehrmals Gegenstand historischer Untersuchungen geworden. Ein Vergleich der bisherigen Forschungen zeigt, dass die Ergebnisse in den wesentlichen Grundzügen übereinstimmen. Unterschiede gibt es nur in der Setzung von einzelnen Akzenten. Hier scheiden sich die Geister.
Als erstem und lange ais einzigem wurden in den sechziger Jahren dem Basler Historiker Edgar Bonjour die Archive geöffnet. ln seiner « Geschichte der schweizerischen Neutralität », die 1970 erschienen ist, widmet er dem Theina, zusammenmit einer Gesamtwürdigung der Tatigkeit von Bundesrat Pilet-Golaz, über 150 Seiten. Bonjour beleuchtet die komplexen Vorgänge erschöpfend und spart nicht mit Kritik an dem damaligen Aussenminister und seinem Vorgänger. Motta wie Pilet hatten ideologische Erwagungen über die Anforderungen der Politik gestellt und sich dabei selber ins Zwielicht gebracht. Dem rigorosen Nein gegenüber der Sowjetunion stand ihre tolerante Haltung angesichts der Bedrohung durch die beiden Diktaturstaaten Deutschland und Italien entgegen. Das galt vor allem fUr die Zeit Mottas, ais die Schweiz noch nicht durch die Achsenmachte völlig eingeschlossen war. Pilet hingegen wird vorgeworfen, er habe sich darauf festgelegt, das Problem erst nach Kriegsende zu Iösen. Auf diese Weise habe er môglicherweise die günstige Gelegenheit verpasst, schon im ersten Halbjahr 1944 zu einer Regelung mit der UdSSR zu kommen.
Beeinträchtigter Handel
Von der Öffnung der Archive und von der jüngsten Welle der « aufarbeitung der Geschichte » hat auch das Thema Schweiz-Sowjetunion profitiert. Vorausgegangen ist Dietrich Dreyer, der 1989 die Beziehungen der ungleichen Partner seit 1917 untersuchte (vgl. NZZ vom 10./11.6.89). Schondamals sind zahlreiche neue Details bekanntgeworden. ln der jüngsten Zeit wurden erneut weitere Dokumente erschlossen. Christina Gehrig-Straube hat in einem umfangreichen, 1997 erschienenen Werk die Verhaltnisse ausgelotet. Sie setzt an beiin Abbruch der Beziehungen wiih. rend des Generalstreiks, ais vermutet wurde, die Russen hatten sich in schweizerische Belange eingemischt. Eine weitere Belastung bedeutete der Fall des Russlandschweizers Moritz Conradi, der einen Sowjetvertreter an einer Konferenz erschossen hatte und danach von einem Waadtlllnder Gericht freigesprochen wurde. Die Handelsabkommen von 1927 und 1933 brachten keinen spürbaren Aufschwung des gegenseitigen Warenaustausches. Nachdem im Februar 1941 eine neue Vereinbarung getroffen worden war, von der sich die inzwischen von den Achsenmiichten vôllig eingeschlossene Schweiz Zugang zu den ostasiatischen Märkten erhoffte, zerschlug sich diese Erwartung nach dem Überfall Deutschlands auf Russland am 22. Juni 1941.
Späte Wende
lm Krieg kamen weitere Belastungen hinzu, so die Sperre der sowjetischen Guthaben in der Schweiz 1941, die Arztemission an der Ostfront und die Kontroverse um die in der Schweiz internierten Russen. Eine Wende kam erst 1945 mit der Currie-Mission und der Sperre der deutschen Guthaben in der Schweiz. Inzwischen hatte auch Bundesrat Pilet seinen Sitz geriiumt, nicht zuletzt wegen des Scheiterns seiner Russlandpolitik. Sein Nachfolger Petitpierre fand in Moskau ofTene Ohren.
Christina Gehrig-Straubes Buch besticht durch eine Fülle von Einzelheiten. Sie gelangt zu ahnlichen Schlüssen wie schon dreissig Jahre vorher Edgar Bonjour. Die Verfasserin sieht die Gründe für das Debakel gegenüber der Sowjetunion in der starren ideologischen Ausrichtung der schweizerischen· Politik. Mit einer pragmatischen Haltung wie gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland ware der Schweiz 1944 der Canossagang ais Bittstellerin erspart geblieben.
Kontroversen 1943 und 1944
Störend ist in der Darstellung von Sophie Pavillon die an manchen Orten durchscheinende Tendenz, das Übel fast ausschliesslich in der Schweiz zu suchen. Grotesk scheint es beispielsweise, wenn in Andeutungen die Ansicht durchschimmert, erst die massiven Lieferungen der Schweiz an Deutschland hiitten den Nazis ermoglicht, die Sowjetunion mit Krieg zu überziehen. Das ist ein Beispiel für eine der momentan üblichen helvetischen Nabelschauen, die sich in Selbstanklagen zu ereifern und zu überbieten versuchen. Man kann nur holTen, dass eine splltere Generation wieder zu einem sachlicheren Urteil zurückkehrt. Geschichte kann nicht in Details zersplittert, sondern sollte als Gesamtheit betrachtet und gedeutet werden.
- Edgar Bonjour: Geschichte der schweizerischen Neutralität. Vier ]ahrhunderte eidgenossischer Aussenpolitik. Band V. 1939-1945. Helbling & Lichtenhahn, Basel: 1970.
- Dietrich Dreyer: Schweizer. Kreuzund Sowjetstem. Die Beziehungen zweier ungleicher Partner seit 1917. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich: 1989.
- Christine Gehrig-Straube: Beziehungslose Zeiten. Das schweizerisch-sowjetische Verhältnis zwischen Abbruch und Wiederimfnahme der Beziehungen (1918-1946) auf Grund schweizerischer Akten. Verlag Hans Rohr, Zürich: 1997.
- Sophie Pavillon: L’ombre rouge. Suisse-URSS 1943-1944. Le débat politique en Suisse. Editions antipodes, Lausanne: 1999.
Alfred Cattani, NZZ, 8 mai 2000
Les éditions Antipodes, diffusées par la Maison des sciences de l’Homme (54, boulevard Raspail, F-75006 Paris) ont publié dans la collection « Histoire et société contemporaines » de l’Université de Lausanne L’ombre rouge. Suisse-URSS 1933-1944. Le débat politique en Suisse, par Sophie PAVILLON, sur la grande question, pour la Suisse, de l’établissement des relations diplomatiques avec l’Union soviétique après un quart de siècle de rupture.
« Au moment où la bataille de Stalingrad fait basculer la Seconde Guerre mondiale en laissant entrevoir l’imminence d’une victoire alliée sur l’Axe, un grand débat s’ouvre en Suisse à propos de l’URSS. Il s’agit de réexaminer les relations entre l’État fédéral et l’Union soviétique à la lumière des récents événements. Des milieux de plus en plus larges réclament un établissement de relations officielles avec elle, que ce soit pour inscrire la Suisse dans les relations internationales issues de la guerre ou pour ouvrir à l’économie helvétique le grand marché russe. Dès lors, le régime autoritaire stalinien est évalué en fonction de ces enjeux; la dénonciation des crimes du stalinisme s’en trouve réduite à la portion congrue.
Le gouvernement de Staline refuse d’établir des relations diplomatiques avec la Suisse en novembre 1944. Traitée de « profasciste » par les médias soviétiques, puis par une partie substantielle des médias internationaux, la politique du gouvernement suisse pendant la guerre est sévèrement critiquée. Après quelques escarmouches entre la gauche et les partis « bourgeois », un front uni se soude en Suisse pour veiller à ce que le pays sorte de son isolement aussi rapidement que possible ».
Société d’Etudes historiques des relations internationales contemporaines (S.E.H.R.I.C), no 100, hiver 99
Le jour où la Suisse tendit la main à l’URSS de Staline…
Les Suisses avaient une peur bleue des « bolchéviques ». Dès 1943, pourtant, la question de la reconnaissanœ diplomatique de l’URSS se pose.
Longtemps, l’histoire des relations entre la Suisse et l’URSS a été considérée à travers une lorgnette purement idéologique. Depuis la grève générale de 1918-interprétée pendant des décennies comme une conspiration bolchévique-la Russie des Soviets apparaît aux yeux de la bourgeoisie helvétique comme un partenaire non fiable, voire hostile.
Durant l’entre-deux-guerres, les attaques contre le « judéo-bolchévisme » constituent l’arme privilégiée de la droite pour discréditer la gauche et le mouvement ouvrier; sur le plan extérieur, les responsables successifs du Département politique Giuseppe Motta puis Marcel Pilet-Golaz, incarnent l’anticommunisme et la bienveillance vis-à-vis des pays de l’Axe qui caractérisent la diplomatie helvétique de cette époque.
En se focalisant sur le processus qui conduit les autorités fédérales à proposer à l’URSS l’établissement de relations diplomatiques, un récent ouvrage de Sophie Pavillon [L’ombre rouge, Suisse URSS 1943-1944 – le débat politique en Suisse] tente de mieux comprendre les raisons qui poussent le Gouvernement suisse à modifier la ligne qu’il a adoptée depuis des années. Au-delà de la seule question des relations bilatérales, son étude montre comment la Suisse a du réorienter sa politique face à l’évolution de la situation internationale au cours du deuxième conflit mondial.
Le refus soviétique
Dès 1943, divers mouvements issus de la société civile s’adressent aux autorités afin de réclamer l’établissement immédiat de relations diplomatiques avec l’URSS. Au moment où les risques grandissent de voir l’Allemagne ne plus incarner le principal débouché de l’économie helvétique, les milieux industriels se montrent intéressés par les perspectives offertes par le grand marché russe.
Dans le le même temps, un nombre toujours croissant d’observateurs politiques souligne que la Russie est appelée à devenir l’une des pièces maîtresses de la scène internationale de l’après-guerre et qu’il convient d’en tenir compte sans retard (et sans état d’âmes pour les aspects les plus sombres de l’autoritarisme stalinien doit-on ajouter). Une pétition rassemblant plus de 100’000 signatures renforce encore la pression sur le Département politique.
Tout en prenant soin de ne rien tenter qui pourrait être interprété comme un revirement politique, Pilet-Golaz prend en charge un dossier qui va tourner à sa totale confusion. En effet, après avoir manifesté sa volonté d’établir à nouveau des rapports réguliers avec Moscou, le Gouvemement suisse se voit gratifié le 1er novembre 1944 d’une fin de non-recevoir; qui plus est, les autorités soviétiques sont à l’origine de la diffusion, dans les médias du monde entier, d’attaques contre la politique menée par le Gouvernement suisse, qualifiée de « profasciste ».
Le chef de la diplomatie helvétique démissionne six jours plus tard: il vient d’essuyer un échec cinglant et personne ne semble plus retenir une figure qui, de par sa politique passée, ne pourrait rendre que plus difficiles les futures relations avec les Alliés.
La gestion de la crise
Ce camouflet diplomatique aura des répercussions importantes. La condamnation soviétique ayant été radiodiffusée, elle suscitera dans de nombreuses chancelleries des commentaires remettant en question la prétendue neutralité de la Suisse. En ce sens, la crise de novembre préfigure les vives critiques que les Alliés ne manqueront pas d’adresser aux autorités helvétiques à la fin du conflit; il faudra les Accords de Washington puis l’établissement, en mars 1946, des relations diplomatiques avec l’URSS pour que la Suisse parvienne à sortir de son isolement.
Sur le plan intérieur, les attaques des médias intemationaux viendront cimenter l’union sacrée des partis gouvemementaux; les socialistes, tout auréolés de leur premier siège au Conseil fédéral, font taire en effet rapidement les quelques critiques qui s’étaient élevées de leurs rangs à l’adresse des autorités. Autant d’éléments qui permettront à la Suisse de négocier sans trop de dégâts le délicat tournant de l’après-guerre.
François Vallotton, La Liberté – Le Courrier, 8.11.1999
Du grain à moudre pour la Commission Bergier
L’excellente historienne romande Sophie Pavillon vient de publier, sous le titre L’Ombre rouge, un ouvrage consacré à l’attitude de notre diplomatie envers l’Union soviétique dans la seconde partie de la Deuxième Guerre mondiale.
Cette étude scientifique est lestée de 577 références aux documents de l’époque et accompagnée de 26 annexes, permettant de consulter entre autres des lettres et des notes diplomatiques souvent inédites.
De Motta en Piler-Golaz
On sait que, dès 1917, la haute-bourgeoisie helvétique a voué une haine féroce au pouvoir soviétique : depuis l’expulsion de la mission Berzine (accusée d’avoir fomenté la grève en 1918!) et l’acquittement du Russe blanc qui avait assassiné à Lausanne le diplomate soviétique Vorovski), la politique suisse à l’égard de l’URSS n’a pas changé d’un iota jusqu’en 1943. N’ayant jamais reconnu le gouvernement de Moscou, Berne prend toujours les positions les plus extrêmes: par exemple, au moment où, recherchant la création d’un front commun contre le fascisme, l’Union soviétique adhère à la Société des Nations, le Conseil fédéral s’y oppose.
Cette politique ultra-réactionnaire a été personnifiée, de 1920 à 1940, par le chef de ce qu’on appelait alors le « Département politique », Guiseppe Motta, admirateur de Mussolini et de Salazar et membre du parti catholique-conservateur (ancêtre des démocrates-chrétiens d’aujourd’hui). Son successeur radical Marcel Pilet-Golaz a suivi la même orientation, recevant, en pleine guerre, les représentants des Frontistes hitlériens « suisses » et favorisant tous les rapprochements possibles avec le 3e Reich, y compris l’envoi à l’Est d’une mission militaire « médicale » dont le but était d’aider la Wehrmacht à combattre « les Rouges ». On a même dit qu’au début de 1943, quand les chances de victoire de l’Allemagne apparurent comme fortement compromises, Pilet-Golaz avait proposé aux Américains de conclure une paix séparées avec Hitler afin de dresser un rempart contre la « bolchevisation » de l’Europe…
La sagesse vint à Stalingrad
Cette obstination dans une hostilité foncière envers l’Union soviétique était-elle due à la réprobation suscitée par les atteintes à la démocratie et les crimes staliniens? Nullement. Dans le cas d’autres Etats, on n’était pas si délicat. Par contre, ce que la classe dirigeante helvétique ne pouvait admettre, c’est que, quelque part à travers le monde, un pays tente de prouver qu’on peut se passer du capitalisme. L’axe de la politique du Conseil fédéral, c’est l’anticommunisme.
Tout cela ne posait guère problème tant que l’URSS était jugée faible et isolée, c’est-à-dire jusqu’à Stalingrad. Mais, dès le moment où il apparaît que ce pays va vaincre les nazis, la perspective qui, pendant un quart de siècle, a guidé la diplomatie helvétique, se brouille. On sait maintenant à Berne que, dès la fin de la guerre, on devra compter avec une nouvelle puissance. On ne se presse pas pour autant. Les tentatives de prise de contact à travers les ambassades alliées sont molles.
Une administration fédérale gangrenée
Quelles sont les causes de cette incapacité à s’adapter aux nouvelles donnes internationales? D’où provient cette myopie politique? Pourquoi ne suit-on pas les conseils donnés à Berne tant par les Américains et par les Anglais? Ceux-ci répétaient en effet à la Suisse: « Dépêchez-vous de reconnaître le gouvernement de Moscou! »
Parce que, en premier lieu, le Département politique avait été truffé par Motta et Pilet-Golaz de collaborateurs qui cachaient à peine leur penchant pro-nazi. Ainsi écrit Sophie Pavillon: « Les déchaînements antisémites apparaissent comme un exutoire privilégié, au Département politique fédéral, pour faire face à cet échec diplomatique cuisant » (il s’agit du refus soviétique). Puis, citant des documents émaillés de grossièreté racistes et antisémites effarantes, elle écrit : « Comme dans les décennies précédentes, l’antisémitisme et l’antisocialisme surgissent bien souvent des dossiers de l’administration fédérale, et ces différentes formes d’hostilité nous semblent jouer un rôle dans la manière dont le Département politique traite le dossier Suisse-URSS aux plans politiques intérieur et extérieur. »
Le profit avant l’intérêt du pays et du monde
Mais l’essentiel reste que le patronat industriel et financier suisse était tellement lié à la machine de guerre allemande que ses intérêts matériels lui dictaient de continuer à aider Hitler (ce qui ne l’empêchait nullement d’ailleurs de lorgner, du seul point de ses profits, vers le futur marché soviétique).
Du reste, lorsque Pilet-Colaz finit par préciser à Moscou que le désir de la Confédération était de nouer des liens diplomatique avec l’URSS, cette dernière refusa. C’était en novembre 1944. La Pravda justifia ainsi cette fin de non-recevoir: « Au cours de toute la seconde guerre mondiale, la Suisse a apporté à l’Allemagne une aide économique considérable, lui fournissant des armements, des munitions, des roulements à billes, des moteurs, des machines outils, des instruments et d’autres équipements.(…) L’Allemagne (…) a même fourni à la Suisse des matières premières pour assurer la livraison du matériel de guerre.(…) La Suisse a encouragé par tous les moyens le commerce avec l’Allemagne donnant à ses firmes des garanties financières en cas de pertes possibles en corrélation avec le transport. » L’article comprend la liste des fournitures militaires, avec leur nombre exact (les Soviétiques semblent bien renseignés) livrées par Oerlikon. Sont cités aussi Hispano, Tavaro et Winterthour. Et cela quasiment jusqu’en mai 1945 (alors que la Suède avait commencé à réduire ses prestations dès 1942!)
Comme toujours, les intérêts du grand capitalisme se moquaient des peuples: ceux-ci, partout en Europe, se faisaient massacrer par les nazis, assurant, grâce à leurs millions de morts, la survie de notre pays, à laquelle les Suisses et les Suissesses contribuaient également selon leurs possibilités. Beaucoup de « nos » magnats de l’industrie et de la finance n’en avaient cure, apportant à l’armée hitlérienne une aide qui-l’auteur le souligne à plusieurs reprises-allait bien au-delà de ce que les pressions allemandes auraient été capables d’obtenir.
Le jour approche où la Commission Bergier, dont le rôle est d’établir la vérité sur l’histoire de notre pays pendant cette période cruciale de son passé, doit rapporter. Il est impératif qu’elle dégage clairement les responsabilités, empêchant Blocher et ses émules de semer la confusion, puisqu’ils feignent hypocritement de croire que dénoncer les classes dominantes de l’époque, ce serait accuser le peuple suisse. Sophie Pavillon et son Ombre rouge contribuent à y aider.
Michel Buenzod, Gauche Hebdo, 19.11.99
Comment renouer avec l’URSS?
Après la victoire de Stalingrad, la Suisse cherche à rétablir des rapports officiels avec la Russie des Soviets: récit d’une tractation difficile.
Rompues par les événements révolutionnaires de 1918, les relations diplomatiques entre la Suisse et la Russie des Soviets se ressentiront jusqu’à leur rétablissement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, du conflit idéologique des années 30, et cela malgré la signature d’accords commerciaux entre les deux pays à trois reprises, la dernière fois en 1941, à la veille de l’attaque allemande à l’Est. Aussi la reprise des rapports, officiels suscite-t-elle, on s’en doute, un vif débat à Berne et dans l’opinion publique helvétique, qui éclaire la politique de neutralité du Conseil. fédéral durant la Seconde Guerre mondiale autant qu’ont pu le faire les questions soulevées par les fonds en déshérence, les achats d’or de la Banque nationale et la politique des réfugiés il y a quelques années.
La réévaluation des rapports helvético-soviétiques est rendue inévitable par la victoire des Russes à Stalingrad. Au-delà de la conjoncture elle s’inscrit pourtant, du point de vue suisse, dans une double continuité, celle de la politique commerciale des industries d’exportation, vivement intéressées par le marché russe, et celle de la lutte contre la subversion révolutionnaire que les partis bourgeois estiment avoir stoppée lors de la grève générale de 1918. Mais à la fin de la guerre, il est plus difficile de trouver, comme les Suisses le souhaitaient, une solution bilatérale. L’URSS fait partie de la coalition des vainqueurs et l’accommodement recherché devra s’inscrire peu ou prou dans la grande stratégie à laquelle la Confédération ne participe pas en raison de sa neutralité.
En 1944, le Conseil fédéral mettra plusieurs mois à comprendre cette nouvelle donne. Il croit possible de distinguer le temps de la guerre de celui de l’après-guerre et d’avancer à petits pas en direction de Moscou. C’est oublier que les Anglo-Saxons exigent alors autant que les Soviétiques la rupture des relations privilégiées entretenues avec le Reich et cela avant même la victoire inéluctable de la coalition antihitlérienne. La Suède se révélera plus habile. Après avoir plus largement encore que la Suisse participé à l’effort de guerre allemand, elle inclinera sa neutralité en direction des futurs vainqueurs sans état d’âme particuliers.
Mal engagé, négligeant les sacrifices immenses consentis par les peuples de l’Union soviétique, le dialogue helvético-soviétique que recherche ouvertement le Conseil fédéral aboutit à un refus insultant et public de la part du Kremlin. Assumant toute la responsabilité d’un échec dont il est effectivement en grande partie responsable, le chef de la diplomatie helvétique, Marcel Pilet-Golaz, se retire. Max Petitpierre reprendra sur des bases plus solides et des perspectives plus globales la tentative de 1944.
Tirant heureusement parti de son mémoire de licence, présenté à l’UNIL, Sophie Pavillon fait un recit très fouillé de cet épisode controversé. Elle insiste avec raison sur le manque d’ouverture démocratique de la politique extérieure de la Suisse et elle fait la démonstration que la neutralité ne peut tenir lieu de politique extérieure comme le croient encore aujourd’hui trop de citoyens.
Jean-Claude Favez, Le Temps, 20.11.99
En 1943, la Suisse et l’URSS
En 1943, la Suisse doit-elle tenter un rapprochement avec l’Union soviétique? Le Conseil fédéral hésite, l’URSS résiste. Un ouvrage très documenté de Sophie Pavillon éclaire les ombres de l’histoire
Reconnaissance diplomatique ou pas. Telle est la question qui se pose au Département politique fédéral au cours de l’année 1943, au sujet de l’Union soviétique.
1943. La bataille de Stalingrad marque le début du repli des forces du Troisième Reich. La guerre n’est pas terminée mais la donne est en train de changer. La Suisse doit réévaluer ses relations diplomatiques avec l’URSS. C’est ce moment charnière de la politique extérieure helvétique que Sophie Pavillon, historienne à l’Université de Lausanne, s’est chargée d’étudier dans son mémoire de licence. Les éditions Antipodes ont eu la bonne idée de le publier. L’historienne donne un récit très fouillé des tractations diplomatiques, accompagné de nombreuses annexes, entre autres des lettres et notes souvent inédites.
Le camouflet de l’Union soviétique
Ce n’est pas de gaîté de cœur que le Conseil fédéral, par le biais du Département politique, engage un rapprochement avec l’URSS. Les relations étaient au point mort depuis longtemps. En 1918, la grève générale avait donné des sueurs froides au gouvernement helvétique, attisant son anti-bolchevisme et instituant pour longtemps une stricte inflexibilité dans l’établissement des relations politiques et commerciales avec l’Union soviétique. C’est aussi en 1918 que la mission soviétique dirigée par Jean Berzine est expulsée de Suisse. En 1923, Moritz Conradi, un Russe blanc tire sur le diplomate Vorovski. Le Conseil fédéral rejette la thèse de l’attentat politique. Ces événements montrent que la Suisse a coupé ses liens avec l’Union soviétique, même si elle garde un œil intéressé sur l’énorme potentiel économique du marché russe. En effet, de 1918 à 1943, aux milieux de gauche, traditionnellement favorables à l’URSS, s’étaient alliés ceux de l’industrie d’exportation, le Vorort en particulier, qui lorgnait sur ces nouveaux marchés à conquérir. Mais le Conseil fédéral, dont le représentant diplomatique est Marcel Pilet-Golaz, un des opposants les plus acharnés à l’URSS, ne fléchit pas.
Cependant, au lendemain de la victoire de Stalingrad, l’URSS est du côté des vainqueurs. Aux voix qui s’élèvent pour reconnaître l’Union soviétique et tenter le rapprochement s’agrègent les secteurs de la bourgeoisie helvétique, préoccupés de l’avenir de la Suisse dans la constellation internationale de l’après-guerre. Le Département politique opère alors un discret rapprochement diplomatique avec l’URSS. A petits pas, dans les couloirs et les antichambres. Mais en novembre 1944, l’URSS refuse d’établir des relations diplomatiques avec la Suisse. L’affront est grave, le camouflet public. La Pravda critique violemment « l’aide économique considérable » apportée par la Suisse à l’Allemagne, ne manquant pas de citer le nom des entreprises-fournisseurs telles que Oerlikon ou Winterthour. Assumant toute la responsabilité d’un échec dont il est en grande partie responsable, le chef de la diplomatie helvétique, Marcel Pilet-Golaz se retire. Quant aux alliés, ils observent une prudente réserve. A l’extérieur comme à l’intérieur, le gouvernement helvétique essuie les reproches concernant sa politique pendant la guerre, et plus spécialement ses relations avec l’Allemagne nazie. Et, dit Sophie Pavillon, « on peut interpréter le refus soviétique comme un signe annonciateur de l’attitude peu amène que les Alliés adoptent à l’égard de la Suisse lors des négociations marquant la fin de la guerre. »
L’attitude de la Suisse au sortir de la guerre
Après les questions soulevées par les fonds en déshérence, après le débat porté sur l’attitude de la Suisse pendant et au sortir de la deuxième guerre mondiale, l’ouvrage de Sophie Pavillon apporte une contribution supplémentaire à l’éclaircissement, difficile, de l’histoire helvétique. Y sont stigmatisés l’étroitesse de la politique extérieure suisse, son antibolchevisme crispé, son attentisme diplomatique; elle montre aussi, comme le dit Jean-Claude Favez à propos de cet ouvrage (Le Temps, 20 novembre 1999), « que la neutralité ne peut tenir lieu de politique extérieure comme le croient aujourd’hui trop de citoyens. »
Géraldine Savary, Domaine Public 1410, 3.12.1999