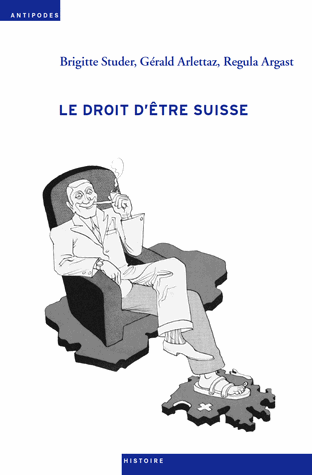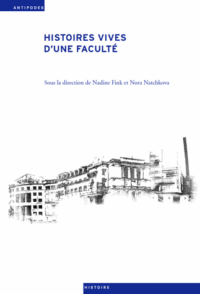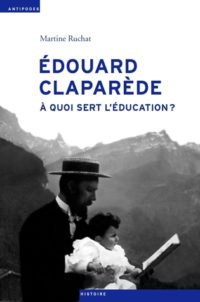Le droit d’être suisse
Acquisition, perte et retrait de la nationalité de 1848 à nos jo
Argast, Regula, Arlettaz, Gérald, Enckell, Marianne (trad.), Gaillard, Ursula, Gilliard, Diane (trad.), Studer, Brigitte,
2013, 261 pages, 22 €, ISBN:978-2-88901-041-7
Dans un contexte de forte mobilité des populations, la politique de naturalisation constitue un des éléments clés de l’intégration, mais aussi de l’évolution de la société nationale. Ce livre analyse les normes légales et les critères qui ont structuré l’acquisition, le refus et le retrait de la nationalité suisse de 1848 à nos jours. Sa perspective historique met en lumière les enjeux du débat actuel et permet de concevoir une politique de naturalisation adéquate.
Description
Ce livre analyse les normes légales et les critères qui ont structuré l’acquisition, le refus et le retrait de la nationalité suisse de 1848 à nos jours. Il prend en compte l’impact du discours des experts et des agents de l’État, ainsi que les interventions des acteurs sociaux et il met en lumière les procédures politico-administratives à travers l’analyse de nombreux cas.
Dans un contexte de forte mobilité des populations, la politique de naturalisation constitue un des éléments clés de l’intégration, mais aussi de l’évolution de la société nationale. Cette politique pose non seulement la question de l’appartenance et de la notion de citoyenneté, mais elle apparaît également comme un instrument de gestion de la société nationale et de la population du pays.
Contribution importante à la recherche internationale sur un thème sensible et d’une grande actualité politique en Suisse comme en Europe, la perspective historique de cet ouvrage met en lumière les enjeux du débat actuel et permet de concevoir une politique de naturalisation adéquate.
Table des matières
-
Introduction
-
Entre tradition et innovation: Le droit de cité suisse dans le nouvel État fédéral, 1848-1898
-
L’ »assimilation », but ultime de l’octroi de la nationalité? 1898-1933
-
D’une politique de naturalisation restrictive à une politique intégratrice? 1934-2004
-
La déchéance de la nationalité pendant la Seconde Guerre mondiale
-
Conclusion
Presse
Dans la Revue historique vaudoise
Cet ouvrage constitue le prolongement du programme national de recherche intitulé « Intégration et exclusion » (PNR 51). Il examine la politique de naturalisation suisse depuis la création de l’État fédéral jusqu’à nos jours.
Après l’introduction permettant la compréhension méthodologique, historique et conceptuelle de l’ouvrage, Regula Argast se penche sur l’évolution du droit de cité suisse entre 1848 et 1898 et l’importance de ces changements pour l’État, la société et les individus. La naissance de l’État fédéral en 1848 voit apparaître un principe de nationalité unique en son genre, le triple droit de cité communal, cantonal et fédéral qui inclut aussi les droits et devoirs des citoyens. Les droits civiques suisses y sont plus étendus que dans la plupart des États d’Europe. L’égalité des droits ne concerne cependant que les hommes suisses de confession chrétienne. La Suisse est caractérisée à cette époque par un pouvoir fédéral faible. La naturalisation, jusqu’en 1874, relève de la compétence des cantons. Les communes y sont largement associées, les droits civiques étant liés au lieu d’établissement des citoyens. Cependant, concrètement, le libre établissement déclaré par la nouvelle constitution n’est reconnu ni aux femmes, ni aux juifs (jusqu’en 1866), ni aux nécessiteux, ni aux personnes de mauvaise réputation ou ayant subi une condamnation. Et les Suisses naturalisés doivent attendre cinq ans pour en bénéficier.
En 1850, la Suisse compte à peine 2,4 millions d’habitants, dont seulement 3% d’étrangers. À cette époque, notre pays connaît un solde migratoire négatif, engendré par le paupérisme qui sévit à cette époque. Entre 1837 et 1850, alors que notre pays accueille 16 000 immigrants, quelque 35 000 personnes quittent la Suisse. La situation est particulièrement précaire pour les heimatloses, privés de droit de cité cantonaux et communaux, donc privés d’assistance. L’assistance aux pauvres était confiée aux communes d’origine. Ainsi les communes veillaient scrupuleusement à maintenir aussi bas que possible le nombre des personnes qui pourraient y avoir droit. Il s’agit là du principal frein à l’obtention du droit de cité suisse. Cependant, l’émi- gration dépassant l’immigration, la population étrangère n’est pas perçue à cette époque comme un problème quantitatif ou culturel, financier ou juridique.
En Suisse l’attribution du droit de cité à la naissance se fonde sur le principe du droit du sang. La Constitution de 1848 a repris sans discussion ce principe en vigueur jusque-là. L’auteure l’interprète comme l’expression de l’autonomie des communes et des cantons en vue de préserver leur contrôle sur le partage de leurs biens. Ce principe garantit également l’inaliénabilité du droit de cité suisse permettant ainsi aux Suisses de l’étranger de revenir en tout temps au pays au titre de Suisses.
Une loi fédérale de 1850 a permis la naturalisation jusqu’en 1872 de 25’000 à 30’000 heimatloses. La Constitution de 1874 a engendré la première loi fédérale sur la naturalisation deux ans plus tard. Le droit de naturalisation entre autres y est étendu aux épouses et aux enfants. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la Confédération n’interviendra que modestement dans les processus de naturalisation. Son autorisation est cependant requise, mais l’examen de la moralité des candidats reste confié aux cantons et aux communes.
Dans le chapitre suivant, Gérald Arlettaz se pose la question de la notion d’assimilation comme but de l’octroi de la nationalité dans les années 1898-1933.
Le tournant du XXe siècle est marqué par une forte augmentation de la population étrangère et la naissance d’une idéologie nationaliste. Pour la première fois en 1898, un conseiller national radical évoque « un danger démographique, social et politique ». D’importantes réformes constitutionnelles et législatives modifieront les conditions de naturalisation. La Confédération reprend cette compétence aux cantons. Le concept de devoir d’ »assimilation » pour les étrangers deviendra récurrent dans la première moitié du XXe siècle. Un Office central de police des étrangers est institué en 1917 qui met en place un contrôle et une régulation de l’entrée des étrangers. Cette politique aboutit en 1931 à la première loi sur l’établissement et le séjour des étrangers. Outre le développement du sentiment d’identité nationale, le jeune État fédéral connaît d’importants défis liés au développement économique et à l’évolution du rôle social de l’État. La Suisse connaît un tournant vers une société dite moderne. L’augmentation du nombre des étrangers (14,7 % en 1910) fait débat dans toutes les couches de la société et dans la presse et devient source de division. Il en résulte une tension croissante entre le phénomène migratoire nécessaire à l’économie et le processus d’intégration nationale. Le discours sur la « surpopulation étrangère » se radicalise. La naturalisation est onéreuse et compliquée. À la lumière des chiffres, Gérald Arlettaz constate que mentalité et statistiques divergent complètement. Il analyse dans ce chapitre les débats autour des modifications législatives.
La question du droit du sol, en opposition au droit du sang, revient régulièrement durant cette période. Après la Première Guerre mondiale, l’augmentation des demandes de naturalisation pour des motifs économiques renforce l’exigence d’être « assimilé » pour devenir citoyen suisse. Le concept d’ »assimilation » se réfère à une vision politique de la société suisse. Il implique que l’étranger fasse siennes un certain nombre de valeurs politiques, civiles, sociales et culturelles. La révision de la loi de 1903 verra s’opposer fortement la gauche – qui juge la politique du Conseil fédéral « réactionnaire » – et la droite. Elle n’empêchera pas la politique envers les étrangers de se durcir progressivement.
Brigitte Studer analyse les changements de la politique de naturalisation entre 1934 et 2004, passant d’une conception restrictive à une politique d’intégration. Exclusion des « indésirables » et sélection des « assimilables », la lutte contre la surpopulation étrangère devient la mission de la police des étrangers des années 1930 aux années 1950. L’évocation d’un « risque de surpopulation étrangère » permet de justifier une régulation politique à la fois quantitative et qualitative. Entre les deux guerres, les conditions de naturalisation deviennent de plus en plus sévères. Cette politique est principalement dirigée contre les juifs. Durant la Seconde Guerre, la politique de contrôle et de régulation des étrangers se durcira encore. Elle n’épargne pas les Suisses eux-mêmes. Pour la première fois, la possibilité de déchoir un Suisse de sa nationalité est ancrée juridiquement. On est dans une logique d’exclusion. Le nombre de naturalisations baisse durant la guerre, puis stagne après celle-ci.
Contrairement aux craintes des autorités, l’économie suisse se met à tourner à plein régime après la guerre. Pour la première fois, les autorités organisent l’immigration massive de travailleurs en Suisse, en majorité des Italiens; Allemands et Autrichiens n’étant pas encore autorisés à sortir de leur pays. Pour les autorités et le public, cette nouvelle population d’immigrés doit être transitoire. Les droits de ces travailleurs – sévèrement contrôlés – sont limités et discriminatoires.
La nouvelle loi fédérale de 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse durcit la réglementa- tion de la naturalisation pour les étrangers (durée de résidence augmentée à 12 ans, introduction d’un exa- men d’aptitude à être naturalisé pour évaluer le degré d’« assimilation » du candidat). Par contre, cette réforme permet la naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par naissance et permet à celles ayant épousé un étranger de conserver leur nationalité pour autant qu’elles en fassent la demande.
Dans les années 1960, la politique et le discours de la Suisse sur les étrangers se résument quasiment à la question des travailleurs. Leur nombre double de 1958 (262 000) à 1965 (561 000). Le problème de l’ »inté- gration » des étrangers est aigu et devient une véritable question de société. À partir des années 1970, l’éga- lité des droits entre hommes et femmes s’impose comme nouvelle norme sociale. Pourtant, entre 1965 et 1974, pas moins de cinq initiatives xénophobes sont lancées par la droite nationaliste qui brandit des scénarios apocalyptiques. Aucune de ces initiatives ne sera acceptée, mais elles bloqueront jusqu’à la seconde moitié des années 1970 toute réforme du droit visant à assouplir et faciliter la naturalisation.
Dans la seconde moitié des années 1970, le discours change un peu et le concept de surpopulation étrangère disparaît. On tente de le contrer par l’ »intégration » ou l’ »assimilation » des enfants nés en Suisse. Pourtant la récession économique débutée en 1974 mettra un frein à la volonté d’intégration des étrangers. La priorité à la main-d’œuvre indigène est restaurée. Les étrangers jouent un rôle de tampon conjoncturel.
En 1981, une initiative, bien que largement rejetée, rendra possible pour les travailleurs étrangers le libre choix de l’emploi, l’accès à un permis illimité et le regroupement familial. En 1983, c’est la problématique nouvelle des réfugiés qui fera échouer la naturalisation facilitée.
Cependant, l’évolution du respect de l’égalité des droits entre femmes et hommes verra jusqu’en 1992 diverses mesures abolissant la discrimination envers les Suissesses mariées à un étranger, l’inégalité dans la transmission de la nationalité aux enfants et l’obtention de la nationalité par une étrangère épousant un Suisse. Les années 1990 verront une hausse sensible des naturalisations avec l’introduction naturalisée des époux étrangers de citoyennes et citoyens suisses.
Avec la crise économique des années 1990, l’augmentation du chômage et la hausse des coûts de la sécurité sociale, une forte tendance xénophobe, attisée notamment par l’Union démocratique du centre, refait surface. Cela aura des conséquences sur la hausse des demandes d’obtention du droit de cité suisse. La naturalisation, vue comme un moyen de lutter contre « la pénétration étrangère » est encouragée. D’autre part, la crise économique renforce l’attrait d’un statut de citoyen suisse et des droits qui y sont rattachés. De 6000 en 1990, le nombre de naturalisations a passé à 22 700 en 1999 puis 47 000 en 2010.
En conclusion, deux logiques antagoniques s’affrontent jusqu’à nos jours: l’adaptation du droit de la nationalité aux besoins d’une société en mutation et le repli nationaliste.
Nicole Schwalbach, dans le chapitre 4, aborde la déchéance de la nationalité durant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, la Suisse a passé à deux reprises des arrêtés permettant de déchoir de leur nationalité les personnes qui, du point de vue des autorités, mettaient en péril l’indépendance ou la sécurité du pays. Le principe de l’inaliénabilité du droit de cité suisse est suspendu pour une période cependant clai- rement définie.
L’article de Nicole Schwalbach développe de manière précise et détaillée les diverses argumentations avancées durant cette période et qu’il nous est difficile de résumer ici.
Enfin, dans leurs conclusions, les auteurs reprennent les différentes étapes qui ont jalonné l’histoire du système constitutionnel de naturalisation suisse. De ses débuts libéraux de 1848 jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale, suivis de six décennies de plus en plus restrictives jusqu’à la fin des années 1970, pour aboutir à la politique actuelle. Une politique très contrastée, qui montre à la fois des signes de libéralisation et de durcissement, à l’image des représentations populaires actuelles.
Sylviane Klein, Revue historique vaudoise, no 125, 2017, pp. 266-269.
Dans Le Mouvement social
L’ouvrage est la traduction française d’un ouvrage paru en 2008 en allemand (Das Schweizer Bürgerrecht. Erwerb, Verlust, Entzug von 1848 bis zur Gegenwart, Zurich, Neue Zürcher Zeitung). Il vise à « reconstituer la genèse de la politique de naturalisation suisse depuis la création de l’État fédéral jusqu’à nos jours et à en décrire l’application » (p. 8). Les auteur-e-s s’attachent ainsi à mettre en relation formation nationale et politique de la nationalité. L’un des intérêts majeurs de cet ouvrage est de montrer comment les rapports entre les trois échelons cantonal, communal et fédéral ont orienté non seulement la politique de la nationalité mais aussi les formes de politisation de cette question.
Ce livre s’inscrit dans une perspective à la fois foucaldienne et socio-historique. La politique de la nationalité y est ainsi analysée comme une forme de biopolitique. Sa mise en œuvre est conçue comme le résultat d’une série d’interactions entre différents types de discours – scientifiques, politiques, administratifs, juridiques – et différents acteurs sociaux qui forment ce que Michel Foucault désignait par la notion de « dispositif « . Enfin, l’ouvrage examine les formes de problématisation de la question de l’incorporation des étrangers. Il propose aussi une socio-histoire des discours sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse depuis 1848 et les pratiques documentées depuis lors. Les auteur-e-s s’appuient sur les travaux de Gérard Noiriel pour penser que « le souci de donner forme à l’espace national, devenu plus présent depuis la création de l’État fédéral en 1848, a pu influencer les critères présidant à l’acquisition et à la perte de la nationalité suisse » (p. 23). Leurs analyses s’inscrivent également dans une perspective proche des travaux de Dieter Gosewinkel sur la loi allemande de la nationalité comprise comme un instrument d’unification du droit et de centralisation étatique.
Outre une introduction très complète, l’ouvrage se compose de quatre chapitres, d’une conclusion et d’une série très intéressante d’annexes composées d’illustrations, de caricatures, d’articles de journaux ou de reproductions de documents administratifs. Le premier chapitre, rédigé par Regula Argast, porte sur la période qui va de la constitution de l’État suisse en 1848 à l’année 1898. L’objectif principal de l’auteure est de montrer que le code de la nationalité suisse ne s’est pas fait à partir de « théories politiques ou ethniques ou nationales » (p. 75), mais qu’il s’est formé à partir des conditions particulières de fonctionnement du jeune État fédéral. Dans cette première phase de construction nationale, l’État fédéral s’ingère peu dans les normes et les procédures de naturalisation. La question de la naturalisation constitue alors un enjeu principalement pour les cantons et les communes qui se réservent ainsi le monopole d’une définition de l’appartenance à la nation suisse et y voient un élément propice pour renforcer leur pouvoir ou leur marge de manœuvre par rapport à l’État fédéral. Ce chapitre montre très bien comment le droit fédéral n’a pas remplacé le droit cantonal et communal en matière de nationalité, mais qu’il s’y est superposé en produisant un déplacement des contraintes qui pesaient jusque-là sur les hommes suisses aux nouveaux naturalisés. Ce chapitre met aussi en évidence les dynamiques d’inclusion et d’exclusion qui se trouvent au cœur du processus de formation nationale. Il donne à voir de manière très claire la transposition de pratiques ayant eu cours au niveau cantonal et communal aux modalités de délimitation du groupe national et de mise à l’épreuve de nouveaux citoyens suisses.
Le chapitre suivant a été rédigé par Gérard Arlettaz. Il a pour objet le débat sur l’articulation entre naturalisation et assimilation qu’il replace dans le contexte d’une problématisation nouvelle de la question de la « surpopulation étrangère » (Überfremdung). Apparue au tournant du XXe siècle, la question de l’Überfremdung acquiert une centralité nouvelle après la Première Guerre mondiale et devient ainsi le vecteur d’une politique nationaliste. On regrette d’ailleurs que ce chapitre ne fournisse pas davantage d’éléments explicatifs sur le rôle de la Première guerre mondiale. Les formes d’oppositions apparues entre Suisse alémanique et Suisse romane à la faveur du premier conflit mondial et la fragilisation de l’unité nationale qui en a découlé auraient ainsi pu être mises en relation avec l’augmentation des demandes de naturalisation consécutive à la Grande Guerre pour expliquer comment « le concept d’Überfemdung est devenu l’expression d’une stratégie de nationalisation de la société » (p. 81). Cependant, il montre très bien comment la diffusion de ce thème a transformé le rôle attribué à la naturalisation dans le projet d’incorporation des étrangers à la nation. En effet, jusqu’en 1917, la naturalisation se conçoit comme la condition d’une assimilation des étrangers et, par conséquent, comme la solution première et principale à l’Überfremdung. En revanche, à partir du moment où les discours nationalistes s’emparent de cette question, la solution à ce « problème » passe par le contrôle et la limitation de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire suisse et la naturalisation s’apparente alors à la décision prise par l’État pour confirmer l’assimilation préalable de l’étranger à qui il accorde la nationalité suisse.
Le troisième chapitre a pour auteure Brigitte Struder. Il prend pour point de départ la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers qui entre en vigueur en 1934 et examine toute la période qui va jusqu’en 2004. Cette loi introduit une distinction entre étrangers bénéficiaires d’un permis d’établissement et ayant les mêmes droits que les citoyens suisses, à l’exception des droits politiques, et une population plus flexible d’étrangers soumis à une autorisation de séjour. À partir des années 1930, la question d’une sélection des étrangers naturalisables est donc remplacée par celle des étrangers autorisés à séjourner sur le territoire. Enfin, le dernier chapitre a pour objet les cas de déchéances de nationalité pendant la Seconde guerre mondiale. Son auteure, Nicole Schwalbach, procède à la genèse de cette politique en montrant comment le principe d’inaliénabilité de la nationalité a été peu à peu remis en cause dans le cas des femmes (notamment les Juives allemandes devenues apatrides), les binationaux et les Suisses ayant des liens avec le national-socialisme au motif que ces personnes mettaient en péril la sécurité de l’État. Ce chapitre montre ainsi très bien le lien entre la mise en place d’une politique de déchéance de la nationalité et la volonté de la Suisse de préserver son statut d’État neutre.
Si cet ouvrage propose un examen très fouillé et très stimulant de l’histoire de la politique de la nationalité en Suisse, sa construction ainsi que certaines des analyses qu’il présente grèvent cependant le propos des auteur-e-s. On regrette en effet que les chapitres ne dialoguent pas davantage entre eux et en viennent parfois à se répéter. En dépit de l’introduction qui montre très bien leur articulation, ces effets de répétition donnent l’impression qu’on s’est contenté de juxtaposer des textes écrits séparément.
D’autre part, on aurait aimé que le primat donné à la Suisse alémanique dans les analyses des auteur-e-s soit davantage justifié. En l’état, on ne parvient pas à comprendre s’il s’agit d’un biais ou si cela tient au rôle de cette région dans l’histoire de la politique de la nationalité. Plus généralement, il aurait été bon que cet ouvrage – du moins dans sa traduction française – explicite plus clairement certains éléments spécifiques au contexte suisse sous la forme de notes ou d’encadrés.
Enfin, et c’est là la critique majeure qui peut être faite à cet ouvrage, les auteur-e-s inscrivent leurs analyses dans une perspective qu’ils distinguent de celle choisie par Rogers Burbaker. À l’inverse de ce que ferait cet auteur, ils souhaitent montrer que les lois sur la nationalité ne sont pas l’expression d’une représentation de l’appartenance à la nation mais bien plutôt le produit d’une configuration historique particulière qui fait de la question de la nationalité un instrument de régulation utilisé par l’État. D’une part, il s’agit là d’une déformation des travaux de Rogers Brubaker. Il suffit de relire la façon dont il analyse l’adoption du principe du droit du sol en 1889 en France et le rôle qu’il accorde à l’obligation militaire pour voir comment ce dernier lie représentations de l’appartenance nationale, contexte politique et social et utilisation par l’État de la politique de la nationalité. D’autre part, à trop vouloir placer l’étude qu’ils mènent au-delà des représentations, les auteur-e-s ont tendance à ne pas considérer suffisamment les présupposés ou les impensés qui structures des débats qu’ils examinent. Ainsi, il aurait été intéressant de souligner que le débat sur le rôle de la socialisation ou le fait d’accorder plus facilement la nationalité suisse à un étranger dont la mère est d’origine suisse se fondent aussi sur des représentations particulières de l’appartenance à la nation suisse. Cela aurait permis de mettre en évidence de manière plus précise comment l’idée d’une socialisation nécessaire fait progressivement l’objet d’une essentialisation qui a pu donner lieu à des discours exprimant une conception racialisée de la nation. De même, on aurait aimé que les auteur-e-s analysent les critères d’évaluation des dossiers en mettant en évidence ce qu’ils laissent implicitement penser des étrangers candidats à la naturalisation.
Cela étant dit, cet ouvrage a le mérite de faire connaître l’histoire de la nationalité suisse à un public francophone plus large et les analyses qu’il livre donnent ainsi à penser les comparaisons possibles entre différents pays européens.
Sarah Mazouz, Le Mouvement social, n° 252, 2015/3
Dans Le cartable de Clio
Le droit d’être suisse. Acquisition, perte et retrait de la nationalité de 1848 à nos jours est la traduction française mise à jour de l’ouvrage Das Schweizer Bürgerrecht. Erwerb, Verlust, Entzug von 1848 bis zur Gegenwart, paru en 2008 aux Éditions de la Neue Zürcher Zeitung. Il avait notamment été dirigé par le regretté Gérald Arlettaz, historien de référence pour ce qui concerne l’immigration en Suisse.
Cet ouvrage retrace l’évolution des différentes lois et révisions sur la nationalité suisse depuis la fondation de l’État fédéral, ainsi que leur mise en application au niveau national. Pour cela, les auteurs ont eu recours à un grand nombre d’études historiques et examinent, entre autres sources, les textes de loi eux-mêmes, mais également les messages du Conseil fédéral, des publications contemporaines ainsi que diverses déclarations et rapports officiels. Cette démarche diachronique permet de mettre en évidence des ruptures, mais également certaines permanences dans les discours et les représentations qui se manifestent dans les débats sur la politique actuelle de naturalisation.
L’étude s’organise, outre l’introduction et la conclusion, selon un découpage chronologique en trois chapitres, auxquels s’ajoute une partie supplémentaire sur les dispositions de retrait de la nationalité pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier s’intéresse ainsi à la période 1848-1898, le second aborde la période allant de 1898 à 1933, qui voit se concrétiser le passage à une politique restrictive et protectionniste, et le troisième explicite le changement de politique intervenant dès 1934 et qui traduit deux tendances divergentes, à savoir la « lutte contre la surpopulation étrangère » et une volonté fédérale d’objectiviser la naturalisation.
L’introduction de l’ouvrage pose d’emblée l’importance des enjeux de l’étude de la politique de naturalisation. Mettant en tension les concepts de citoyenneté et de nationalité, elle expose le processus d’inclusion nationale de la population helvétique aux dépens de l’exclusion des non-suisses. Les auteurs considèrent en effet la nationalité comme étant un « dispositif construit qui reflète les représentations normatives de la nation et qui est le produit des rapports sociaux de son temps » (p. 27). Car, au-delà d’une gestion politique de la population, l’enjeu réel de la naturalisation est bien de rendre possible une répartition des biens sociaux selon des caractéristiques sociales, ethniques et même de genre, puisque l’accès à la nationalité suisse détermine également de nombreuses dispositions légales concernant la réglementation de la famille, l’accès à l’aide sociale et aux assurances, ainsi qu’au marché du travail. En outre, il révèle également les tensions entre la constitution d’une autorité politique fédérale et la défense d’intérêts locaux de la part des cantons.
Dans la première période (1848-1898), le jeune gouvernement fédéral, en accord avec les principes de libéralisme politique et économique, assure principalement le libre marché, la libre circulation des personnes ainsi que la promotion du bien-être général. Un solde migratoire négatif et l’absence de conception de « nation suisse » ne motive en effet aucun interventionnisme fédéral. La nationalité se comprend alors comme une appartenance cantonale et communale – cette dernière donnant droit à l’assistance – alors que la citoyenneté (les droits et devoirs incombant aux citoyens, c’est-à-dire les hommes suisses de confession chrétienne) renvoie à un niveau fédéral. La nouvelle Constitution de 1874 marque une première modification notable avec le transfert à la Confédération de la compétence de régler l’acquisition ou le retrait de la nationalité.
Au tournant du XXe siècle, la forte augmentation de la population étrangère sur sol suisse pose des questions de gestion à un niveau fédéral, principalement en raison de la tension existant entre une immigration nécessaire pour le développement
économique de la Suisse et le processus d’intégration nationale. La naturalisation se conçoit alors comme la solution pour lutter contre l’Überfremdung (« l’emprise étrangère »), considérant que l’acquisition de la nationalité suisse permet l’assimilation des étrangers. Le contexte de la Première Guerre mondiale transforme profondément la représentation des étrangers dans l’espace public, qui sont désormais tenus pour responsables de la détérioration des conditions socio-économiques de l’après-guerre. Ainsi, les débats sur la révision constitutionnelle qui se tiennent entre 1919 et 1920 intègrent des arguments identitaires et le besoin de défendre les « valeurs suisses », conçues dans l’imaginaire collectif non plus comme un bien à offrir, mais comme un bien à défendre.
L’année 1934 marque un tournant avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers qui avait été adoptée en 1931. La crise des années 1930 légitime la mise en place d’une régulation quantitative et qualitative instituant un système de séjour transitoire pour les étrangers. Jusque dans les années 1970, des décisions politiques, principalement dictées par les pressions internationales et le développement du marché économiques d’autres pays européens, vont dans le sens d’une certaine amélioration de la situation des étrangers. Les autorités fédérales sont ainsi prises entre le besoin d’objectiviser le processus de naturalisation et une certaine réticence de la population helvétique.
Le dernier chapitre propose une présentation succincte sur le retrait de la nationalité suisse pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que mesure d’exclusion active. Cette démarche, mise en place progressivement entre 1903 et 1943, illustre parfaitement les attentes morales, politiques et sociales associées au statut de citoyens helvétiques, telles que l’« intégrité », l’obligation de prouver sa solvabilité mais également des critères ethniques, principalement appliqués aux femmes étrangères qui se mariaient avec des Suisses. Outre l’inégalité de traitement entre hommes et femmes, cette procédure révèle également une différenciation dans la conception du « droit de cité » suisse, entre la nationalité de naissance – protégée dans une certaine mesure par une clause d’inaliénabilité – et la nationalité accordée administrativement, qui reste soumise à conditions.
Cet ouvrage forcément incomplet, puisqu’il ne s’intéresse qu’aux décisions fédérales, sera utilement prolongé par d’autres contributions concernant la « question des étrangers » en Suisse. Mais son caractère synthétique et la richesse des sources mentionnées en fait une référence incontournable pour mieux comprendre la construction nationale, en tant que double processus d’intégration de et à la nation, l’un ne pouvant se concevoir sans l’autre.
Alexia Panagiotounakos, Le cartable de Clio, no. 13/2013, pp. 219-220
Dans la revue en ligne Lectures / Liens Socio
Que nous apprend l’histoire de l’acquisition, de la perte et du retrait de la nationalité suisse de 1848 à nos jours? Cet ouvrage, qui présente une réflexion historique sur cette thématique cruciale pour la Confédération Helvétique, entend répondre à cette question en fournissant une approche qui met en perspective les dimensions politiques, juridiques et sociales du phénomène étudié. Si la thématique de recherche touchant à la question de la naturalisation dépasse les frontières suisses, l’objectif des auteurs est de définir les principes organisateurs que le pouvoir politique a institutionnalisés durant cette période et de comprendre quels sont les enjeux politiques, culturels et économiques qui les sous-tendent.
La question de la nationalité divise la population d’un pays entre, d’un côté les nationaux et, de l’autre les étrangers. La question de la nationalité a la force d’ »inclure » et d’ »exclure ». Cette fonction symbolique rappelle que la naturalisation est un acte politique qui appartient à l’Etat et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une simple procédure administrative à laquelle tout un chacun peut prétendre. Mais il est important de rappeler au lecteur que la nationalité suisse, appelée « droit de cité », revêt un caractère singulier et unique en son genre puisqu’elle se déploie à trois échelons: communal, cantonal et fédéral. La tension entre ces trois entités institutionnelles doit toujours être gardée à l’esprit puisqu’elle permet de comprendre les intérêts divergents qui animent l’évolution historique de la question des naturalisations en Suisse.
L’ouvrage est divisé en quatre chapitres. Les trois premiers chapitres traitent de l’acquisition de la nationalité suisse respectivement de 1848 à 1898, de 1898 à 1933, de 1934 à 2004 et le dernier chapitre aborde la question de la perte de nationalité sur l’ensemble de la période étudiée.
Dans le premier chapitre, les auteurs tentent de montrer que, durant cette période, la question de la naturalisation n’est pas entachée par des problématiques liées à l’application de théories politiques ou d’idées ethniques ou nationales. La nationalité suisse et la question de son obtention sont bien plus liées aux questions de fonctionnement du jeune Etat fédéral ainsi qu’à la prise en compte d’aspects socioculturels, économiques et de la mise en œuvre de la démocratie directe. Afin de favoriser la cohésion nationale, la Confédération se devait d’établir un certain nombre de règles touchant directement au droit de cité: égalités entre les Suisses, garantie des libertés civiles, intégration des populations « nomades »… Autant d’éléments qui n’allaient pas de soi entre les cantons avant l’avènement de la Confédération en 1848.
Dans le deuxième chapitre, la question de l’acquisition de la nationalité évolue avec le renforcement de l’Etat Fédéral. L’arrivée au tournant du siècle d’une forte immigration étrangère fragilise l’unité nationale et les fondements libéraux qui la caractérisent. L’apparition d’une immigration étrangère conduit les Suisses à s’interroger sur les fondements identitaires qui constituent leur nationalité. L’ »assimilation » aux valeurs nationales devient un préalable à la naturalisation imposant ainsi de nouveaux impératifs fondés sur des visions culturalistes, nationalistes et ethno-raciales. À cette période, la politique de la gestion des étrangers repose sur de nombreux critères « scientifiques » mais le discours juridique devient de plus en plus froid et irrationnel.
Dans le troisième chapitre, la période étudiée est marquée par un durcissement des politiques d’accueil des étrangers, étant donné que la peur de leur augmentation demeure la préoccupation principale. Des juristes vont alors définir les principes de la citoyenneté suisse. Le jus sanguinis, clef de voûte du droit de cité suisse, est défini avec précision et le jus soli est rejeté parce qu’il ne permet pas d’appliquer les principes de sélection valorisant le contrôle de la « qualité » et de la « quantité » des prétendants à la naturalisation. Selon les autorités fédérales, le jus soli représente une menace pour les structures politiques traditionnelles du pays ainsi que pour les particularités d’ordre culturel. Les auteurs insistent sur le fait que durant les années d’après-guerre, la Suisse était marquée par une conception ethno-culturaliste de la nation. L’idée de l’importance d’une « aptitude » à devenir suisse est renforcée par celle de la définition du « peuple souche » ainsi que par des normes culturelles et des modèles de comportements. Mais c’est dans les années soixante que les limites de cette approche politique de la naturalisation ont commencé à s’essouffler. Les conceptions politiques commencent à se modifier sans pour autant parvenir à répondre aux exigences d’une société en mutation. Si le choix de l’ »intégration » des étrangers prime désormais sur l’ « assimilation », une double logique contradictoire demeure présente. D’un côté la mise en œuvre des principes de l’égalité et de l’Etat de droit, et de l’autre, le repli sur soi et sur le national.
Le dernier chapitre revient sur la possibilité de retirer aux Suisses leur nationalité durant la période étudiée. Il faut retenir que les critères de retrait de la nationalité, comme ceux d’obtention de la naturalisation, se focalisent sur des attentes et des exigences morales, politiques et sociales.
À la lecture de cet ouvrage, deux remarques s’imposent. En premier lieu, c’est à la fois la singularité de la situation suisse et l’universalité de la thématique abordée qui interpelle le lecteur. Si l’éclairage de l’histoire est fondamental pour comprendre le programme suisse en matière d’accueil des étrangers et de naturalisation, on perçoit que la question de la naturalisation repose sur des notions difficiles à définir car abstraites (assimilation, intégration, communauté nationale…). En second lieu, il ressort de cet ouvrage que le poids du discours institutionnel, en particulier de celui de juristes, a entravé pendant de nombreuses années une analyse multi-située sur la problématique de l’immigration étrangère et de la naturalisation. Ce n’est que très récemment que d’autres disciplines ont pu s’intéresser à cette question, permettant de remettre en cause un discours unilatéral et en rendant toute sa complexité à la question de la présence des étrangers sur le territoire national.
Aujourd’hui, loin de l’émotion qu’exploite régulièrement la politique pour aborder la question des étrangers sur le sol suisse, on peut légitimement interroger un aspect de la question qui semble encore fort peu étudié. La voix des étrangers, de ceux qui souhaitent être naturalisés, devrait enfin être entendue afin de connaître l’autre versant de cette problématique. Si les intérêts de la politique et du pouvoir sont toujours dominants, quelles sont les aspirations, les besoins des étrangers vivants en Suisse? Dans une telle perspective, la problématique suisse de l’intégration des étrangers se rapproche étroitement de celle de ces voisins européens. L’acquisition de la nationalité, instrument politique du « vivre ensemble », ne peut être envisagée que du point de vue du pouvoir politique.
Anne Jolivet, Lectures, Les comptes rendus, 29 septembre 2013, http://lectures.revues.org/12260
Qu’est-ce qu’un bon Suisse?
Le sujet ne cesse d’être d’actualité et la tendance est au tour de vis: saisi le mois dernier d’un projet visant à l’harmonisation des procédures de naturalisation au niveau fédéral, le Conseil national en a profité pour durcir les exigences envers les candidats. Il a notamment supprimé la disposition selon laquelle les années passées en Suisse entre dix et vingt ans comptent double pour la détermination du délai au terme duquel une demande peut être déposée – faible trace d’une forme de droit du sol dans une législation fermement inscrite dans la tradition du droit du sang.
En soi, ce durcissement ne fait que confirmer une tendance au repli et à la méfiance envers l’étranger lisible dans l’ensemble du débat politique. Mais il reflète aussi, comme le souligne une étude récente, le regard de la Suisse sur elle-même: en définissant les conditions auxquelles peut s’obtenir le statut de citoyen, un pays dit aussi la façon dont il se conçoit et la plus ou moins grande confiance qu’il accorde à ses capacités d’incorporer ceux qui vivent sur son territoire. C’est l’évolution de ces conceptions depuis l’émergence en 1848 d’une jeune démocratie sûre de l’attrait de ses institutions politiques que retracent Brigitte Studer, Gérald Arlettaz et Regula Argast dans Le Droit d’être Suisse.
L’ordre patriarcal
D’abord laissé largement à l’appréciation des cantons, ce droit est vu au début comme un moyen privilégié d’intégration. Il s’agit de lier les habitants dans un réseau de devoirs et de droits – entre autres à l’assistance – cohérent, en supprimant notamment le statut de Heimatlos, dans lequel les communes avaient le pouvoir de reléguer leurs citoyens les plus démunis ou les plus turbulents.
Le socle sur lequel va se développer le futur droit de la nationalité se construit à ce moment: est Suisse tout enfant de père suisse, une règle qui reflète alors essentiellement l’ordre patriarcal de la famille – un ordre qui pousse à exclure sans état d’âme de la citoyenneté les femmes qui épousent un étranger.
A partir du tournant du siècle, toutefois, émerge l’idée que la nationalité se construit sur une base ethnique forte. Dans la Suisse multilingue et multiculturelle, cette idée s’écrit en négatif: pour devenir citoyen, il faut être capable de participer au consensus complexe d’une démocratie riche et exigeante. Mais l’idée domine vite que seules les personnes de souche européenne proche peuvent y parvenir un jour – et que les indésirables, notamment les juifs orientaux, doivent être tenus à distance. Fortement renforcées au cours du premier conflit mondial, c’est l’apparition de la peur de l’emprise étrangère et l’exigence d’assimilation envers les candidats à la nationalité.
La crise des années 30 puis la guerre accentuent cette tendance au repli au sein d’une communauté nationale dont les valeurs doivent être étroitement partagées par tous ses membres. A la faveur des pleins pouvoirs, le Conseil fédéral se donne celui d’exclure certains citoyens de la nationalité. Sont visées les femmes ayant épousé des étrangers, les naturalisés ayant obtenu la nationalité suisse par la ruse ou nuisant au pays par leur activité et certains double-nationaux. La crainte de perdre la pureté et la cohésion de la communauté nationale est si forte qu’elle pousse les autorités à refuser d’y réintégrer les Suissesses devenues apatrides après 1933 du fait de leur mariage avec un juif allemand.
Les exigences de l’économie d’après-guerre finissent par inverser le mouvement. Face à une immigration qu’on échoue à la longue à réduire à un statut exclusivement précaire, l’intégration devient un impératif. La naturalisation redevient un moyen d’y parvenir, même si elle continue longtemps à se mériter en apportant la preuve d’une assimilation pleinement réussie. C’est l’époque des enquêtes de personnalité, des examens visant à attester la bonne connaissance des us et coutumes suisses. Mais le bloc se fissure.
En 1952, les femmes suisses qui épousent un étranger obtiennent le droit de conserver, sur demande uniquement, leur nationalité. Et bientôt, les faiseurs de Suisses font rire. Le mouvement législatif va vers un assouplissement: réduction des émoluments, efforts pour arriver à des procédures administratives basées sur des critères objectifs plutôt que sur la mesure d’un ineffable désir d’assimilation. Une vieille idée, jusque-là toujours écartée, refait surface: parier sur la deuxième génération de migrants en facilitant la naturalisation des jeunes scolarisés en Suisse. Le mouvement bute toutefois sur une forte résistance populaire et même ses modestes avancées semblent aujourd’hui en passe d’être balayées. Mais les auteurs n’abordent guère ce dernier tournant et ce qu’il dit de notre façon d’être Suisses au début du XXIe siècle.
Sylvie Arsever, Le Temps, 15 avril 2013
Le droit d’être Suisse retrace l’histoire de la naturalisation depuis le début de la Confédération. Eclairage.
Les faiseurs de Suisse reviennent sur les écrans de l’actualité. La semaine même où la Commission des affaires juridiques du Conseil national débat d’une révision de la loi sur la nationalité, un ouvrage sur l’histoire de la naturalisation depuis 1848 sort en français. Le droit d’être suisse montre à quel point la pratique évolue et s’inscrit dans une époque. Avec quelques constantes, comme le manque d’harmonisation des critères et l’immense marge de manœuvre – et donc d’arbitraire – laissée aux agents de l’Etat et aux communes qui naturalisent par vote. Longtemps à la traîne, la Suisse se trouve aujourd’hui dans la moyenne des pays de l’Union européenne (UE) concernant son taux de naturalisation. Rencontre avec Brigitte Studer, professeure d’histoire contemporaine et responsable de l’ouvrage.
La conclusion de votre livre ressemble à une recommandation. On y lit qu’il est urgent d' »oeuvrer à la cohésion du pays grâce à l’intégration des 800 000, voire bientôt 900 000, étrangers qui répondent aux conditions de naturalisation mais renoncent aujourd’hui à la demander. » Voulez-vous influer sur le débat politique?
Notre travail s’inscrit dans le programme national de recherche intitulé Intégration et exclusion. Or ces programmes ont aussi pour but d’apporter des réponses utiles aux décideurs politiques. On peut donc y lire une recommandation, oui. Parce que nous estimons qu’on peut parler de déficit de démocratie et d’égalité quand une grande partie de la population qui vit en Suisse n’a pas les mêmes droits que la majorité des habitants; 900 000 personnes, c’est presque un quart de la population qui ne participe pas au système démocratique. Nous avons été frappés aussi par une inégalité des droits dans les fortes disparités qui existent dans les procédures de naturalisation suivant la commune ou le canton où réside l’étranger.
Les fonctionnaires en charge auraient-ils trop de poids?
Quand on travaille sur ce thème, le pouvoir que détiennent quelques agents de l’Etat saute aux yeux. Certains hauts fonctionnaires du Département fédéral de justice et police (DFJP), mais aussi les employés qui, au niveau des communes ou des cantons, enquêtent sur les candidats.
Les jeunes étrangers nés en Suisse n’ont toujours pas un droit automatique à la nationalité. Comment expliquez-vous cette aversion contre le droit du sol, souvent évoqué mais jamais admis?
J’y vois de multiples raisons. D’abord, à la différence de la France où le droit du sol s’est imposé, la Suisse n’a jamais ressenti le besoin d’augmenter sa population. Au contraire. Et puis, le droit du sol étant tributaire du « hasard de la naissance », il ne se conciliait pas avec l’assimilation désirée aux valeurs suisses. Valeurs dont on a estimé qu’elles se transmettaient à travers les générations, par le sang donc. Je pense aussi que la Suisse, petit pays avec beaucoup de frontières et une immigration importante, a peur de perdre le contrôle. Elle ne s’est jamais clairement déclarée comme pays d’immigration alors qu’elle l’est depuis la seconde moitié du XXe siècle.
La Confédération s’est-elle toujours montrée aussi prudente?
Ah non! En 1848, la Confédération, jeune Etat républicain, n’était pas regardante du tout. Elle laissait totalement ces questions aux communes et aux cantons. Finalement elle a dû intervenir car certaines communes se livraient à un marché assez juteux de vente de la nationalité suisse. Ce qui posait des problèmes internationaux car les pays voisins se plaignaient que leurs ressortissants tentaient ainsi d’échapper à l’armée alors qu’ils n’habitaient même pas en Suisse.
La Confédération pose alors des conditions à l’octroi du droit de cité?
Oui, avec la nouvelle Constitution de 1874, elle exige que les naturalisés ne vivent pas à l’étranger mais en Suisse, et cela depuis deux ans. C’est tout.
Quand est -ce que la Suisse devient frileuse?
Au niveau fédéral, une série de durcissements s’impose au fil du XXe siècle. La durée du séjour en Suisse s’allonge. D’abord à quatre ans durant la Première Guerre mondiale, puis à six ans en 1920. La qualification morale et l’idée de conformité apparaissent: le Conseil fédéral déclare que l’étranger doit être devenu « intérieurement suisse ». Désormais, on parle d’assimilation.
Pourquoi ce durcissement?
Au tournant du XXe siècle émergent des mouvements nationalistes, pas seulement en Suisse. La vision nationaliste remplace la vision républicaine, comme le montre Gérald Arlettaz. Celle-ci voulait que chacun participe, que les étrangers soient intégrés et naturalisés. Une autre idée s’impose: la capacité de réception du pays est limitée. On commence alors à parler d' »emprise étrangère » et de « surpopulation étrangère ».
Avec quelles conséquences?
Durant certains moments de la Première Guerre mondiale, Genève, par exemple, ne naturalise plus du tout. La Confédération crée la police des étrangers en 1917, puis inscrit la « défense contre les étrangers » dans la nouvelle loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers en 1931. On exigera que les étrangers puissent subvenir à leurs besoins. D’ailleurs, depuis la fin du Moyen Age jusqu’à aujourd’hui, les communes ont constamment craint de se retrouver avec de nouveaux pauvres sur les bras.
La politique de naturalisation se montre restrictive durant les périodes de guerre. De quoi la Suisse a-t-elle peur?
Durant la Première Guerre mondiale, elle craint les subversions comme les anarchistes, les communistes et les pacifistes alors qu’elle aura peur des espions pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l’entre-deux-guerres, les crises et la logique économique dominent. Dès lors, on a peur des étrangers qui prennent le travail des Suisses.
Va-t-on vers un apaisement dans l’après-guerre?
Non, on favorise l’immigration, mais celle des travailleurs pour couvrir les besoins en main-d’œuvre. On ne veut pas de citoyens. En 1946, on introduit le travail saisonnier comme statut normal et on fait passer des examens médicaux aux étrangers. La loi de 1952 allonge la durée de séjour, à douze ans, pour pouvoir demander la nationalité. La nécessité de passer un test d’aptitude entre aussi dans la législation. Un progrès: désormais, les femmes qui épousent un étranger ne perdent plus leur nationalité suisse si elles en font la demande.
Face au doublement de la population étrangère entre 1950 et 1962, le DFJP conseille de naturaliser pour réduire le nombre d’étrangers. Un signe d’ouverture?
Naturaliser de la sorte est très instrumental. La Confédération se sent forcée et veut couper l’herbe sous les pieds des mouvements xénophobes.
Il faut attendre les années 70 pour que la Suisse se montre à nouveau ouverte. Y a-t-il eu un effet 68?
Oui. Un discours d’ouverture remet en question la nation, les frontières, l’exclusion. L’effet 68 se manifeste aussi du côté des Eglises. On vit une période de haute conjoncture depuis 1945, les trente glorieuses. Mais des initiatives xénophobes voient aussi le jour. Pas moins de cinq entre 1965 et 1974. Dont celle de l’Action nationale de James Schwarzenbach qui veut plafonner les naturalisations. Elles seront toutes refusées, mais certaines de justesse.
Les naturalisations ont augmenté, de quelque 8550 cas en 1990 à 46 700 en 2006. Puis la courbe a fléchi. Pourquoi cette hausse?
La révision de la loi en 1992 a permis la double nationalité. Et la libre circulation des personnes avec l’UE a poussé de nombreux ressortissants de pays hors UE à acquérir un statut plus sûr dans notre pays.
Vous montrez que l’Etat suisse a toujours pris soin de choisir les étrangers qu’il naturalisait et d’écarter ceux qu’il jugeait non intégrés. N’est-ce pas le droit légitime de tout Etat?
Vu de l’Etat dans un monde d’Etats-nations, choisir peut effectivement relever de la logique d’Etat. Mais vu de l’individu qui a la malchance de naître dans un Etat faible ou qui ne peut pas lui offrir de protection, ce n’est ni juste ni équitable.
Propos recueillis par Catherine Bellini, L’Hebdo, no. 8, semaine du 28 février 2013