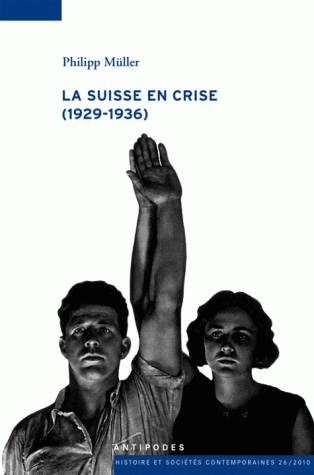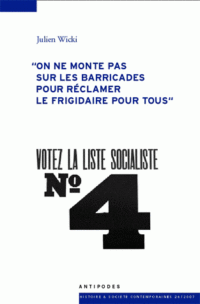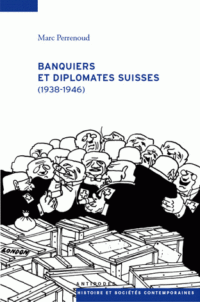La Suisse en crise (1929-1936)
Les politiques monétaire, financière, économique et sociale de l
Müller, Philipp,
2010, 818 pages, 43 €, ISBN:978-2-88901-012-7
2010, 818 pages, 54 chf, 43 €, ISBN 978-2-88901-012-7
Description
La crise économique et financière des années 1930 a profondément marqué la Suisse. Les exportations s’effondrent. Une des huit grandes banques du pays fait faillite. En hiver 1935, plus de 8% de la population active est touchée par le chômage. La pauvreté frappe près d’un habitant sur cinq.
Contrairement à la plupart des pays, la Suisse ne change pas de politique monétaire jusqu’en septembre 1936. La politique du franc fort constitue pour les dirigeants helvétiques l’épine dorsale de leur politique de crise. La politique financière fédérale traduit le souci de la majorité bourgeoise de défendre l’équilibre budgétaire coûte que coûte et d’imposer les charges de la crise sur la majorité populaire. Enfin, les interventions de l’État dans l’économie illustrent la sélectivité de l’action fédérale. D’un côté, on retrouve une injection massive d’argent public par exemple dans les sauvetages bancaires. De l’autre côté, la politique de lutte contre le chômage reste rachitique et discriminatoire. Quant au combat contre la pauvreté, il est inexistant.
Les politiques de crise poursuivies par la Confédération sont donc orientées en fonction des intérêts des dirigeants de l’industrie d’exportation et de la place financière. Le présent ouvrage vise à les mettre en évidence et à en discuter les fondements.
Presse
Dans la Revue historique vaudoise
En contexte de crise économique, les comparaisons historiques avec la Grande Dépression sont devenues un exercice incontournable. La parution de la thèse de doctorat de Philipp Müller, qui porte sur les politiques suisses de lutte contre la récession des années 1930, arrive en ce sens à point nommé. Fruit du dépouillement de quatorze fonds d’archives, complété par un survol exhaustif de la littérature existante sur le sujet et par un travail important de compilation de statistiques, cet ouvrage colossal de plus de 800 pages sort remarquablement de la mêlée. Philipp Müller offre une vision aussi précise que tranchée de la thématique, tout en évitant les écueils de la technicité et du jargon économiques. Décortiquant l’élaboration intérieure de la politique helvétique – au coeur de la « salle des machines de l’État fédéral » – le livre s’inscrit ainsi dans la continuité des travaux de sociologie financière historique de la Suisse, amenés par Jakob Tanner, Cédric Humair et Sébastien Guex, le directeur de thèse de Müller1. À mi-chemin entre les monographies spécialisées et les ouvrages généraux sur la Suisse de l’entre-deux-guerres, ce texte comble une lacune historiographique et saura s’imposer, à n’en pas douter, comme une référence dans un champ de recherche encore en friche.
Le propos central de La Suisse en crise consiste à expliquer l’inertie de la politique économique helvétique durant la Grande Dépression. Alors qu’à l’étranger les années 1930 sont caractérisées par un développement important de l’interventionnisme étatique, à l’instar du New Deal américain, associé souvent à des tournants politiques déterminants, de l’avènement du nazisme à celui du Front populaire, la Confédération helvétique se distingue inversement par un conservatisme rigide. Jusqu’à tard dans la décennie, les milieux dirigeants suisses ne s’écartent en effet pas d’un programme économique orthodoxe qui se centre autour de trois objectifs. Premièrement, la stabilité du franc suisse est défendue coûte que coûte, ce qui implique deuxièmement une politique déflationniste de réduction des salaires pour faire face à la concurrence étrangère et, troisièmement, la limitation du développement de la sphère étatique par l’application de plans d’austérité budgétaire. Durant les premières années de crise, cette orientation libérale précipite certes la chute des exportations, pénalisées par la force de la monnaie, la montée du protectionnisme en Europe et la baisse de la demande extérieure, mais le niveau de l’emploi se contracte encore relativement faiblement en comparaison internationale. Le secteur de la construction, dopé par l’afflux de capitaux européens cherchant refuge en Suisse, connaît même un boom éphémère.
Dès 1932-1933, l’édifice orthodoxe craque. La plupart des grandes banques suisses, en proie à des difficultés considérables sur les marchés extérieurs, sont restructurées, tandis que le chômage dans l’industrie atteint des niveaux inégalés jusqu’alors. En conséquence, l’intervention de l’État s’étend tout de même au cas par cas. La Confédération supporte financièrement les entreprises d’exportation, régule par le biais des accords de clearing les échanges commerciaux avec l’étranger et soutient activement les prix agricoles. La politique sociale reste cependant largement absente de cet « interventionnisme sélectif ». La majorité des salariés ne bénéficie d’aucune assurance vieillesse et le principal instrument de lutte contre le chômage consiste en la restriction de l’emploi de la main-d’oeuvre immigrée. Dans la dernière phase de la crise, entre 1934 et 1936, la politique économique suisse va imploser sous les pressions internes et externes. Sur le plan intérieur, le bloc bourgeois se fissure entre, d’une part, les velléités du patronat de redoubler la déflation et la rigueur budgétaire et, d’autre part, les exigences de son aile paysanne et artisane qui prône un accroissement de l’aide étatique. Les séductions produites par l’idée d’un passage à un modèle corporatiste au sein de la petite bourgeoisie, tout comme le rapprochement entre certaines franges du monde agricole et la gauche, témoigne de cette fragmentation de la droite traditionnelle. Surtout, la défense du franc fort semble constituer de plus en plus un objectif insoutenable et obsolète à mesure que les autres pays abandonnent la parité monétaire. Faisant suite à la dévaluation du franc français, la monnaie suisse est finalement découplée de sa valeur or en septembre 1936, ce qui offre les possibilités d’une reprise timide avant la Seconde Guerre mondiale.
La narration de la dépression de Philipp Müller n’est pas totalement innovante. L’éclatement tardif de la crise en Suisse, le consensus autour de la défense du franc fort ou les interventions étatiques pour secourir les entreprises helvétiques avaient déjà fait auparavant l’objet d’études historiques. Ce n’est pas le moindre intérêt de cette thèse que de regrouper et de superposer les différentes dimensions de la politique de crise en un seul ouvrage. Toutefois, s’appuyant sur une documentation de première main très riche, l’étude de Müller renouvelle aussi l’historiographie helvétique sur plusieurs aspects. Elle présente pour la première fois une analyse contrastée de la politique fiscale des années 1930, qui met en évidence durant la crise l’obsession de l’équilibre budgétaire chez les dirigeants suisses qui n’a d’égale que leur aversion pour l’imposition directe fédérale. Elle réunit des données inédites ou peu accessibles sur un spectre très large de thématiques, qui vont de la réorganisation du paysage industriel à la structure des échanges extérieurs en passant par l’assistance sociale et le chômage. À un niveau plus général, elle questionne habilement les interprétations fondées sur la mentalité pour expliquer l’attachement à l’étalon-or monétaire en Europe dans l’entre-deux-guerres. L’ouvrage démontre d’un côté que, dès 1933, les banques helvétiques n’hésitent pas à spéculer contre le franc suisse, alors que les industries des machines prennent des mesures financières pour parer à l’éventualité d’une dévaluation. De l’autre côté, dans les débats politiques, la défense du franc fort constitue simultanément une arme efficiente en mains de ces mêmes milieux pour justifier les baisses de salaires et les restrictions budgétaires.
Il est vrai que le lecteur de La Suisse en crise sera quelque peu désorienté par le fait que l’ouvrage de Philipp Müller a tendance à s’engouffrer dans trop de pistes, ce qui affaiblit sa ligne argumentative. Il notera parallèlement que la sortie de crise à partir de 1936 est quant à elle survolée en trois courtes pages. Au niveau méthodologique, on pourra aussi objecter que, si la thèse se réclame de la sociologie financière, elle n’offre que très peu d’informations sur le « noyau hégémonique », formé des quelques acteurs politiques, administratifs et patronaux qui régissent la politique économique suisse de l’époque. Enfin, on regrettera que l’auteur n’ait pas plus mis à profit l’abondante littérature étrangère pour questionner la spécificité du cas helvétique, qui semble parfois être plutôt postulée ici que démontrée. À quel point la conduite de l’économie suisse se démarque-t-elle véritablement de celle d’autres petites puissances européennes, comme la Belgique ou les Pays-Bas, qui suivent une politique monétaire similaire au début de la dépression? Mais ces critiques seront rapidement éclipsées par la rigueur scientifique et la richesse interprétative de ce très solide travail d’histoire économique, en résonance avec les cures d’austérité actuelles.
Christophe Farquet, Revue historique vaudoise, 119/2011, pp.339-341
1 Jakob Tanner, Bundeshaushalt, Währung und Kriegswirtschaft. Eine finanzsoziologische Analyse der Schweiz zwischen 1938 und 1953, Zurich: Limmat Verlag, 1986; Cédric Humair, Développement économique et État central (1815-1914). Un siècle de politique douanière suisse au service des élites, Berne: Peter Lang, 2004; Sébastien Guex, La politique monétaire et financière de la Confédération suisse 1900-1920, Lausanne: Payot, 1993; Sébastien Guex, L’argent de l’État. Parcours des finances publiques au XXe siècle, Lausanne: Réalités sociales, 1998.
Discussion avec Philipp Müller
Dans le cadre de la parution de son livre sur la crise des années 30, Philipp Müller nous a accordé un long entretien sur la Suisse, son histoire, sa politique économique et monétaire, et aussi sur sa situation actuelle. Moments choisis.
Quelques mots sur le livre
La discussion s’engage sur la forme du livre, qui est la reprise d’une thèse soutenue à l’Université de Lausanne en 2008. Revendiquant une dimension « artisanale » de l’histoire, Philipp Müller déclare que l’ambition première de son travail était de mettre en évidence les politiques de crise poursuivies par la Confédération et orientées principalement par les intérêts des dirigeants de l’industrie d’exportation et de la place financière. Pour ce faire, il fallait « traiter toutes les dimensions des politiques de crise, de la façon la plus concrète et précise possible » offrant ainsi le premier panorama historique complet de la période et comblant ainsi une vraie lacune historiographique.
Comparaisons et déraisons
L’histoire économique de la Suisse dans les années 1930 doit se comprendre par un élément fondamental, qui est la défense de la stabilité du franc (et le maintien de sa parité avec l’or). Les forces de droite finiront par abandonner celle-ci en septembre 1936, mais elles auront entre-temps cherché à imposer une politique de déflation (baisse des prix et des salaires), évidemment combattue par la gauche.
Si l’économie suisse ne s’effondre pas, n’est-ce pas du fait de son parasitisme envers les autres économies avancées (dû à sa place particulière dans la division internationale du travail), comme nous l’avons vu ces dernières années? Pour Philipp Müller, la comparaison avec la situation actuelle est délicate. Il n’est pas possible par exemple d’identifier les plans de relance des années 1930 à ceux que l’on a connus depuis 2008 et dont la Suisse a en effet très largement profité. Après la crise de 1929, les économies nationales se replient au contraire sur elles-mêmes, y compris en Suisse.
Succès du système suisse
« Le capitalisme suisse marche, et il marche à chaque crise comparativement mieux que dans les autres pays », nous dit l’auteur, ce qui, ajoute-t-il, constitue évidemment « un problème pour la gauche »! Et si ça marche, en tout cas jusqu’aux années 1990, c’est fondamentalement parce que la droite « exporte » le chômage et assure un État social minimal, juste suffisant pour éviter toute révolte populaire. Il s’agit d’un « paternalisme » efficace et générateur de consensus social. C’est par exemple durant la crise des années 1930 que les premiers fondements d’une assurance-chômage sont posés. Le constat est particulièrement vrai aujourd’hui compte tenu de l’évolution qui a eu lieu depuis les années 1970: « »‘État social suisse fonctionne mieux que dans de nombreux pays européens », y compris parmi nos voisins directs.
Dans cette situation, la responsabilité des forces de gauche, Parti socialiste et syndicats en tête, est en définitive limitée. Au travers de ce que Philipp Müller nomme un « interventionnisme sélectif », la droite est en effet capable d’utiliser le pouvoir étatique pour défendre à la fois ses propres intérêts et la paix sociale.
De l’Etat en Suisse
La discussion s’est également concentrée sur la nature de l’État en Suisse. Pour l’auteur, celui-ci bénéficie d’une « autonomie relative » par rapport à l’économie et ne peut être réduit à la mise en uvre directe des intérêts du capital, à ce « comité qui gère les affaires communes de la bourgeoisie » que fustigeait Marx. On affirme ainsi trop rapidement que « l’État n’est que la courroie de transmission politique de ce qui est décidé dans les conseils d’administration, au Vorort et à l’Association suisse des banquiers ». L’un des exemples de cette autonomie serait la politique agricole poursuivie par la confédération dans l’entre-deux-guerres, « politique fortement interventionniste qui contredit l’un des objectifs de la bourgeoisie, à savoir la baisse des prix et des salaires ». N’oublions pas cependant qu’un autre objectif crucial de la bourgeoisie à cette époque était de ne pas s’aliéner la paysannerie, force politique qui deviendrait menaçante si elle en venait à s’allier aux socialistes.
L’État suisse est-il fort ou faible? Notre discussion a fait surgir des divergences de vue sur ce point dont on ne peut rendre compte complètement ici. La question est toutefois fondamentale, car il en découle des conceptions assez opposées de ce que peut être une politique de gauche en Suisse. Si l’Etat est faible, sa conquête est à vrai dire assez secondaire car il restera, quels qu’en soient les administratrices’eurs, l’expression de rapports de force qui le dépassent largement. S’il est fort au contraire, le problème se pose dans l’autre sens, puisque son contrôle permet d’influer significativement sur lesdits rapports de force.
L’histoire suisse
Notre discussion se clôt sur des considérations liées à l’historiographie de gauche en Suisse. Philipp Müller remarque qu’elle a longtemps délaissé les sujets traditionnels, en considérant trop rapidement que « l’État en Suisse n’existe pas » et en se concentrant plutôt sur l’histoire du mouvement ouvrier. C’est principalement grâce aux travaux d’historiens comme Sébastien Guex et Hans Ulrich Jost que la situation change à partir des années 1980. « On a tort de penser que l’État et les politiques de droite ne nous intéressent pas » et de se contenter d’étudier des sujets « de gauche », ajoute-t-il. Les historien·ne·s de gauche en Suisse ont oublié qu’il faut aussi parfois étudier l’histoire des vainqueurs, en particulier lorsque celle-ci n’a jamais été faite, remplacée qu’elle est par une mythologie faite d’images d’Épinal.
Antoine Chollet, Pages de gauche, N°92/octobre 2010
L’intégralité de la discussion entre Philipp Müller, Dan Gallin, Romain Felli et Antoine Chollet se trouve sur le site Pages de gauche.
Sur Histobiblio.com
Les années trente sont marquées en Europe par la progression des extrémismes et concomitamment par l’avènement de nombreux régimes autoritaires. Un des éléments qui explique cette évolution est naturellement le contexte économique et social particulièrement difficile que connaît le continent après que celui-ci a été touché de plein fouet par une sévère crise née en 1929 aux Etats-Unis faisant suite à celle, mondiale elle aussi, du début de la décennie. Pris au dépourvus face à l’ampleur d’un phénomène inédit par bien des aspects, les dirigeants peinent à trouver des réponses efficaces; accentuant ainsi bien involontairement l’instabilité des temps.
Dans les années trente, frappées de plein fouet, les exportations suisses s’effondrent. De plus, dans un pays où le secteur bancaire est traditionnellement un pilier majeur de l’économie nationale et confère à la Suisse une place internationale de premier plan, une des huit grandes banques implantées sur le territoire fait faillite. 8% de la population se retrouve donc au chômage à l’hiver 1935 alors que la pauvreté frappe un habitant sur cinq. Dans ce livre, qui constitue sa thèse de doctorat d’histoire de l’Université de Lausanne, Philipp Müller ne s’attache pas tant à expliquer comment la crise toucha la Suisse et quelles conséquences elle eut sur le pays mais analyse plutôt les politiques monétaires, financières, économiques et sociales menées par la Confédération helvétique pour la circonscrire.
Et le bilan de l’auteur est particulièrement sévère pour les dirigeants du moment. D’abord, la Suisse est en Europe un cas particulier car elle est un des rares pays à ne changer ni de régime ni même d’orientation politique majeure. La Confédération, secouée par la crise, connaît une grande stabilité qui lui a permis de mener une politique homogène au cours de la décennie. En outre, avec la France et les Pays-Bas, la Suisse est la seule à poursuivre jusqu’en septembre 1936 une politique axée sur la défense de la parité-or de sa monnaie (le levier monétaire est à l’époque un des moyens privilégiés d’intervention économique utilisé par les Etats). Pour un pays exportateur comme l’est la Suisse, c’est pénaliser sa compétitivité. C’est que la politique fédérale a surtout le souci de l’équilibre budgétaire du pays, de la défense des intérêts des dirigeants de l’industrie d’exportation et de la préservation de la place financière helvétique. Par conséquent, la Confédération a fait « payer » les effets de la crise à la majorité populaire sur laquelle ont immédiatement reposé les charges induites par la crise économique. En outre, les initiatives de l’Etat, qui a voulu limiter autant que possible son interventionnisme, ont été marquées par une grande sélectivité dans les choix de l’action fédérale. Ainsi, la politique de lutte contre le chômage est restée très modeste alors que celle contre la pauvreté fut simplement inexistante.
Claire et bien menée, cette étude économique reste très accessible et riche d’enseignements.
L’impossible politique déflationniste
L’historien Philipp Müller revient sur la stratégie économique suisse des années 1930. En quoi diffère-t-elle des options choisies aujourd’hui?
Franc fort, menace déflationniste, chômage en hausse…Les ingrédients de la crise des années 1930 rappellent étrangement la situation actuelle. A ceci près que la politique économique d’alors diffère sensiblement de celle d’aujourd’hui.
Sous l’impulsion du conseiller fédéral Jean-Marie Musy-qui se révélera par la suite influencé par l’idéologie nazie, le gouvernement tente d’imposer en 1933 des baisses des prix et des salaires, dans l’espoir de relancer la compétitivité des exportations. Cette approche finit sur un échec devant le peuple, qui rejette la « Lex Musy ». On est loin de la stratégie actuelle de la Banque nationale suisse (BNS), qui tente d’éviter le piège de la déflation, par le maintien des taux au niveau plancher et l’achat massif d’euros.
Auteur d’une thèse sur la Suisse des années 1930, secrétaire général adjoint du Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud, Philipp Müller dresse quelques parallèles entre les deux périodes.
Dans les années 1930, la Suisse refuse de suivre la politique de dévaluation de sa devise, pourtant adoptée par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, qui abandonnent la parité de l’étalon or. Quelles sont les conséquences de cette politique?
Elles sont doubles. Les industries d’exportation souffrent d’une importante perte de compétitivité, avec des différentiels atteignant parfois 30% sur les taux de change par rapport aux parités d’avant la crise. Suite à la dévaluation de la livres, par exemple, les exportations suisses vers la Grande-Bretagne chutent drastiquement en automne 1931.
Quelle est la deuxiéme conséquence?
Grâce au franc fort, la place financière suisse consolide son statut de refuge pour les capitaux. Elle bénéficie d’importants afflux de fonds, en dépit des attaques spéculatives contre la devise.
La situation semble similaire aujourd’hui: les banques enregistrent des entrées de fonds malgré l’érosion du secret bancaire. Cette tendance peut-elle s’inverser?
Ce n’est pas exclu. Dans les années 1930, les fonds ont fini par refluer. la BNS considérait d’ailleurs les entrées de fonds comme un facteur déstabilisant. Ces capitaux volatils n’étaient pas dirigés vers les activités de crédit, mais cherchaient simplement refuge en Suisse.
Face au dilemme du franc fort, la Suisse opte dans les années 1930 pour une politique de déflation. Pourquoi l’approche finit-elle par échouer?
Cette politique contient trop de contradictions pour pouvoir fonctionner. La droite bourgeoise est alors divisée dans ses objectifs. Les associations patronales, le Conseil fédéral et la BNS réclament une baisse du niveau des prix et des salaires pour favoriser la compétitivité. Mais personne n’ose aller au bout de cette logique, pour des raisons politiques. La baisse des prix va contre les intérêts du secteur agricole, qui reste l’allié de la droite.
Ce sont aujourd’hui les associations de consommateurs qui réclament des baisses de prix, pour qu’ils s’adaptent à l’appréciation du franc vis-à-vis de l’euro. Une telle mesure ne risque-t-elle pas justement d’engendrer une spirale déflationniste?
La situation est très différente aujourd’hui, puisqu’il s’agit de défendre le pouvoir d’achat des ménages.
En quoi est-ce si différent?
Le problème des prix survient quand des biens importés entrent en compétition avec des produits suisses. Or l’industrie suisse s’est spécialisée dans des secteurs qui n’ont plus grand-chose à voir avec la consommation intérieure. Une baisse du prix des véhicules Toyota importées par Emil Frey ne pénaliserait en aucun cas nos exportations. Elle serait à l’avantage des consommateurs suisses. Pour le moment, seuls les importateurs augmentent leurs marges grâce au franc fort.
La BNS semble abandonner sa stratégie d’intervention sur le marché pour faire baisser le franc. A-t-elle tort?
La BNS a exprimé sa volonté de ne pas laisser le franc s’apprécier exagérément. Au plan qualitatif, cette stratégie est très différente de l’approche adoptée dans les annêes 1930. D’un point de vue technique, les interventions sur le marché des devises semblent toutefois atteindre des limites. La BNS ne peut pas indéfiniment acheter des euros. Cependant, en termes de destruction d’emplois. la hausse du franc n’a pour le moment pas le même impact que dans les années 1990.
La hausse du franc n’est donc pas condamnée à pénaliser les exportateurs suisses…
Une appréciation durable du franc aurait forcément un impact négatif sur l’industrie d’exportation. D’autres facteurs entrent toutefois en ligne de compte, notamment l’état de la demande extérieure. Par ailleurs, l’impact sera différencié en fonction des profils des entreprises. Certains groupes suisses sont parvenus à développer des positions quasi monopolistiques dans des activités très spécifiques. D’autres ont tablé sur la qualité et la fiabilité de leurs produits, ou sur les services après vente. Enfin, certaines entreprises d’exportation investissent aussi à l’étranger en francs. Le franc fort augmentera aussi leur pouvoir d’achat.
La relance est devenue un réflexe conditionné
Dans les années 1930, le gouvernement suisse adopte une rigueur budgétaire qui n’est pas sans rappeler le discours actuel des pays surendettés. Cette politique se justifiait-elle?
Avec le recul, cette orthodoxie budgétaire paraît à bien des égard exagérée. La Suisse continue à rembourser, en pleine crise des années 1930, les dettes contractées durant la Première guerre mondiale. C’est absurde: non seulement les finances de la Confédération sont extrêmement saines en comparaison internationale, mais la basse conjoncture devrait dicter une hausse des dépenses pour favoriser la relance.
Malgré l’orthodoxie budgétaire d’alors, l’Etat n’hésite pas à se faire interventionniste…
Il intervient même à très grande échelle Pour les sauvetages bancaires des années 1930, la Confédération débloque l’équivalent d’un quart de son budget annuel. Si on fait un parallèle avec 2008, c’est comme si Berne avait déboursé 15 milliards de francs au lieu de 6 milliards pour venir en aide à UBS.
Le secteur financer est-il le seul à bénéficier d’un soutien?
Non, plusieurs secteurs d’exportation sont également concernés. Pour le tourisme, le gouvemement interdit par exemple la construction de nouveaux hôtels, afin de limiter la concurrence. L’horlogerie, de son côté, s’organise en holding et se cartellise. La Suisse ne parviendra toutefois pas à éviter l’effondrement de son industrie textile.
Quelle différence y a-t·il avec les plans de relance actuels de la Confédération?
Les interventions sont aujourd’hui beaucoup plus rapides. Alors que rien n’était entrepris dans les années 1930 pour augmenter les dépenses publiques dans les infrastructures, c’est aujourd’hui un réflexe presque automatique en temps de crise. A une nuance près: si on reconnait l’importance des mesures de relance, l’administration souhaite limiter l’influence des parlementaires dans leur gestion.
Quand on voit l’explosion des déficits publiques de certains pays européens, on peut comprendre…
Il est clair que l’ampleur de certains plans de relance se traduit ensuite par des mesures d’austérité tout aussi massives. Le probléme ne vient toutefois pas du principe de relance, mais du manque de volonté européenne de réguler et de taxer le secteur financier. On semble oublier que les sauvetages qui plombent aujourd’hui les finances publiques ont d’abord servi à sauver des banques.
Propos recueillis par Gaspard Kühn, L’Agefi, 23 juin 2010
La démocratie directe en temps de crise
Y a-t-il des constantes dans le traitement des crises financières en démocratie directe? Note de lecture de la thèse de Philipp Müller La Suisse en crise (1929-1936)
La crise financière de 2008, en quoi se différencie-t-elle de celle des années 30? L’exercice, analogies et différences, est un peu académique. Pour qui a vécu ces deux tremblements de l’économie, aucun raisonnement, théorique, ne supplantera le souvenir, émotionnel: ces files de chômeurs, attendant, publiquement sur la place de la Riponne, la distribution des soupes populaires.
Nonobstant, la comparaison est de nature à éclairer des caractéristiques du comportement helvétique, du fonctionnement des institutions. On se référera au travail de l’historien Philipp Müller, consacré à La Suisse en crise (1929-1936), aux éditions Antipodes, 2010. De cette recherche et mise en perspective, qui colle aux événements monétaires, financiers, économiques et sociaux, nous avons retenu, dans cette note de lecture, l’expérience ouvertement affichée d’une politique de déflation. Est-elle possible, à quel prix, dans un pays de démocratie semi-directe?
Le franc-or
Alors que les deux grandes monnaies ont déjà été dévaluées, la livre sterling en 1931 et le dollar en 1933, les autorités suisses font connaître, mieux, affichent et proclament leur attachement au franc-or. La valeur inchangée du franc suisse est économiquement fondée vu l’importance des réserves en or et du commerce de ce métal. Mais pour justifier cette position sont invoqués aussi des arguments d' »éthique » financière: la Suisse se fait respecter en tenant ses engagements, pas question d’alléger artificiellement ses dettes! L’équilibre du budget, le refus de l’inflation sont la démonstration de la cohérence de cette politique. La défense du franc-or était chargée d’un sens vertueux, celui du respect de la parole donnée.
Mais une monnaie dévaluée rend les exportations plus compétitives. Or, la Suisse est un pays exportateur. Peut-elle se passer de ce stimulant? Oui, répondent les responsables de l’économie, à condition qu’on baisse les prix, que par un effort volontaire on obtienne le même résultat que par une manipulation de la monnaie.
Jean-Marie Musy
La Confédération n’a pas les compétences de fixer l’échelle des salaires. Mais elle est le plus gros employeur du pays (administration et régies). Sous l’impulsion du conseiller fédéral Musy, est décidé un abaissement généralisé des salaires. S’y oppose la gauche politique et syndicale. Le front patronal est fissuré. Le référendum donne un résultat clair. La loi Musy est repoussée par 55% des votants et par la majorité des cantons.
Après un verdict aussi net, on s’attendrait à une réorientation de la politique fédérale. Il n’en est rien. Les affrontements internes au collège sont sanglants. Les conseillers fédéraux s’engagent par écrit à respecter la collégialité. Jean-Marie Musy adresse ultérieurement un programme financier à ses collègues sous forme d’ultimatum, après quoi il démissionnera.
Le Conseil fédéral va donc de l’avant, aiguillonné par une initiative populaire de gauche sur la politique de la crise. Il élabore un plan financier complet: aide aux chômeurs, ressources financières nouvelles-dont l’impôt sur les boissons, notamment le vin, qui soulèvera la résistance des vignerons de Lavaux-, et enfin la réduction des salaires des employés de la Confédération. Comme l’écrit Philipp Müller, « rarement le résultat d’une votation populaire aura été rendu caduc en l’espace de seulement quelques mois » (p.417). Avec l’accord de la majorité du Parlement, le plan sera adopté en vertu du « droit de nécessité », c’est-à-dire soustrait au référendum.
Analogie
Si les circonstances sont différentes, comment ne pas être frappé par le recours au droit d’urgence (art. 185 Cst) utilisé par le Conseil fédéral pour recapitaliser UBS, où même le Parlement fut mis devant un fait accompli?
En 2008 comme en 1933, le Conseil fédéral est persuadé qu’il est en situation légitime en interprétant seul, ou avec le Parlement, l’intérêt général. Mais cette légitimité, il la tient en fait et non en droit de l’accord des responsables de l’économie et de la banque
Quand la politique de déflation aura montré ses limites, la dévaluation décidée en 1936 sera acceptée de la même manière.
La prise en compte de la complexité des intérêts du camp bourgeois (agriculteurs, USAM, Vorort) est remarquablement rendue dans le travail de Philipp Müller. Mais, si l’on introduit une comparaison avec la crise actuelle, une donnée doit particulièrement ressortir, c’est la légitimité que s’octroie le courant de droite dominant, si persuadé d’ incarner les intérêts du peuple suisse qu’il pense, à deux périodes de notre histoire, pouvoir se passer de peuple.
André Gavillet, Domaine public, 7 juillet 2010
Voir aussi:
Une clause d’urgence mieux encadrée
Si les droits populaires représentent un élément central de la démocratie helvétique, ils n’ont jamais fonctionné pleinement en situation de crise. Ainsi, dans les années 30 et durant la guerre, le Parlement a abusé du droit d’urgence pour faire passer sans référendum des lois qui n’étaient ni urgentes ni provisoires. C’est ainsi que furent adoptés l’impôt sur le chiffre d’affaire et l’impôt de défense nationale, ancêtre de l’impôt fédéral direct. De même plusieurs initiatives populaires déposées dans les années 30 et 40 n’ont jamais été soumises au vote populaire.
En réaction à ces abus, plusieurs initiatives sont lancées, notamment par la Ligue vaudoise. En 1949, le peuple et les cantons limitent l’étendue de la clause d’urgence en matière législative et constitutionnelle: dans un tel cas, le texte entre immédiatement en vigueur, mais il peut être contesté par un référendum dans le premier cas et doit être soumis en votation dans le second cas; sauf approbation, il expire après une année.
Pour la recapitalisation d’UBS, le Conseil fédéral a agi seul, en se basant sur les art. 184 al. 3 et 185. al.3 Cst. Pour l’accord avec les Etats-Unis sur la transmission des noms des clients américains d’UBS, un arrêt du Tribunal administratif fédéral a exigé l’approbation du Parlement. Ce dernier, tout comme le Conseil fédéral, a jugé qu’il s’agissait là d’un acte de portée concrète, n’engendrant pas de règles générales et abstraites, donc non susceptible d’être contesté par référendum, conformément à l’art.141 lit. d Cst.
Jean-Daniel Delley, Domaine public, 7 juillet 2010
1929-2008, les banques avant le social
Avec la crise des subprimes, la chute de la Bourse, le sauvetage massif du secteur bancaire et l’explosion du chômage qui a suivi, un grand nombre de commentateurs ont tiré des parallèles avec la crise de 1929. La sortie de l’ouvrage de Philipp Müller sur la crise en Suisse dans les années 1930 permet de mieux connaître cette période et voir que les réticences aux plans de relance ne datent pas d’aujourd’hui.
Avec le krach de 1929, les Bourses s’effondrent et la crise devient mondiale. En Suisse, la crise est tardive et brutale avec 8% de chômage en 1935 et environ 20% de la population à l’assistance sociale. Mais la Suisse n’adopte pas deux mesures fortes: la dévaluation monétaire et des programmes volontaristes. Durant les années 1930, sur trois plans qui définissent la trame du livre de Philipp Müller, il y a une continuité de l’emprise du « bloc bourgeois »-une alliance entre les élites de l’industrie d’exportation, des arts et métiers et de la paysannerie-sur le système politique suisse.
Statut consolidé du franc
Ces élites défendent une politique du franc fort pour maintenir l’attractivité de la place financière suisse et mener à bien une baisse des salaires et des prix pour redevenir compétitifs. Face à l’aggravation de la crise, cette politique de déflation mène à l’impasse et provoque l’hostilité des paysans, artisans et ouvriers. Cela explique en partie qu’il y aura finalement une dévaluation du franc suisse, mesure contre laquelle y compris la gauche s’est pendant longtemps opposée, en septembre 1936.
Politique financière de classe
Le « bloc bourgeois » s’accroche à une politique d’équilibre budgétaire. La Suisse est l’un des très rares pays qui non seulement paient les intérêts de la dette publique mais continuent de rembourser une partie de la dette contractée durant la guerre. Sans cela, l’Etat fédéral suisse se serait retrouvé avec un déficit zéro pendant la crise la plus profonde du XXe siècle! En outre, il tente d’éviter de reconduire une imposition directe progressive fédérale notamment pour les hauts revenus et les grandes fortunes. Conséquence: pendant un an, en 1933, au moment où la crise s’approfondit, la Confédération n’a pas perçu un franc d’impôt fédéral direct!
Interventionnisme sélectif
Le troisième objectif poursuivi est un interventionnisme sélectif renforcé. Des capitaux sont injectés pour des sauvetages bancaires pour près de la moitié du budget annuel de la Confédération. Pour maintenir la paysannerie dans le giron bourgeois, l’Etat subventionne les prix du lait et du blé. Pour les artisans, il accepte des mesures de protection du marché intérieur. Il n’y a par contre aucune volonté d’agir contre la pauvreté. Au contraire, à partir de 1934, des réductions du montant versé aux caisses de chômage sont décidées. Au final, cette politique traduit le souci de la majorité bourgeoise de défendre le secteur bancaire et l’industrie d’exportation, au détriment des classes populaires. Force est de constater que 80 ans plus tard, cela n’a pas vraiment changé.
TROIS QUESTIONS À PHILIPP MÜLLER
L’histoire se répète-t-elle aujourd’hui?
Au niveau de la politique financière, c’est évident. C’est la continuité de la logique de l’équilibre budgétaire et des caisses vides. La réticence à de véritables plans de relance demeure. Par contre, la Banque Nationale Suisse adopte pour l’instant une attitude plus pragmatique pour éviter un franc trop fort.
Le sauvetage de l’UBS est-il une première?
Non, il y a eu un interventionnisme musclé pour sauver les banques, comparable à celui d’aujourd’hui. Mais, à l’époque, la Confédération était devenue actionnaire majoritaire de la Banque Populaire Suisse.
Les tensions sociales étaient-elles plus fortes qu’aujourd’hui?
Oui, avec une assurance chômage et une aide sociale très rachitique et un Etat qui ne faisait rien. La pauvreté et le chômage affamaient les familles ouvrières. Les enfants étaient très touchés. La campagne financée massivement par la droite contre l’initiative de crise de 1935 a donc beaucoup polarisé.
Yves Sancey, m-magazine, N°6-7, juin-juillet 2010, p. 15