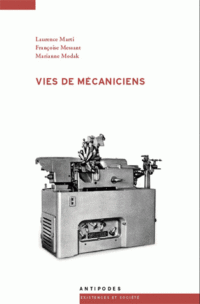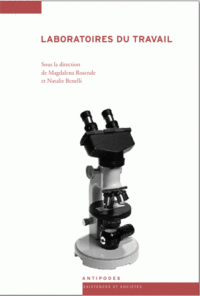Cachez ce travail que je ne saurais voir
Ethnographies du travail du sexe
Dahinden, Janine, Hertz, Ellen, Lieber, Marylène,
2010, 228 pages, 23 €, ISBN:978-2-88901-019-6
Les métiers du sexe sont faits de tâches, de techniques et de savoir-faire, comme tout travail. Or, la qualification de « travail » soulève des réticences et des oppositions qui empêchent d’approfondir l’analyse empirique, théorique et militante d’une question pourtant centrale pour les études genre et pour les mouvements féministes dans le monde entier.
À la lumière de plusieurs études empiriques et ethnographiques, cet ouvrage a comme objectif de contribuer à ouvrir la boîte noire du « travail du sexe » et de rendre compte d’activités que, bien souvent, nous faisons mine de connaître sans pour autant comprendre ni les tâches qui les composent réellement, ni les rapports sociaux qui les structurent.
Description
Les métiers du sexe sont faits de tâches, de techniques et de savoir-faire, comme tout travail. Or, la qualification de « travail » soulève des réticences et des oppositions qui empêchent d’approfondir l’analyse empirique, théorique et militante d’une question pourtant centrale pour les études genre et pour les mouvements féministes dans le monde entier.
À la lumière de plusieurs études empiriques et ethnographiques, cet ouvrage a comme objectif de contribuer à ouvrir la boîte noire du « travail du sexe » et de rendre compte d’activités que, bien souvent, nous faisons mine de connaître sans pour autant comprendre ni les tâches qui les composent réellement, ni les rapports sociaux qui les structurent.
Table des matières
- Introduction (Marylène Lieber, Ellen Hertz et Janine Dahinden)
- Usages et pertinences de l’ethnographie pour la sociologie de la prostitution (Lilian Mathieu)
- Les « traditionnelles » du Bois de Vincennes, une ethnographie du travail sexuel (Malika Amaouche)
- « Le faire » sans « en être », le dilemme identitaire des prostituées chinoises à Paris (Marylène Lieber et Florence Lévy)
- Qu’entendons-nous par travail? Réflexions autour du débat sur le statut de la prostitution (Pascale Absi)
- La mise en image des fantasmes. Ethnographie de la production pornographique (Mathieu Trachman)
- La prostitution c’est plus de temps au téléphone qu’au lit! (Alice Sala)
- Les compétences circulatoires des danseuses de cabaret extra-européennes (Romaric Thiévent)
- Emergences d’affects et sexualités dans les chambres d’hôtels de prostitution (Marina França)
- « Les hommes en Suisse sont tous pédés » Approche ethnographique critique des théories sur le langage et l’hégémonie (Loïse Haenni)
- La complexité de l’échange: réflexions à l’issue du colloque de Neuchâtel (Paola Tabet)
Presse
Dans la revue Anthropologie et Sociétés
Dans l’excellente introduction dressant notamment un bon bilan des recherches, les directrices scientifi ques de l’ouvrage ne s’appesantissent pas sur la prostitution comme catégorie. Elles se concentrent sur un autre aspect des choses en considérant la prostitution comme travail et en soumettant cette thèse à l’épreuve de neuf enquêtes de terrain dont la plupart sont riches d’enseignement. Les recherches ont été réalisées aussi bien en Suisse et en France qu’en Bolivie et au Brésil, dans des contextes variés, depuis les maisons closes et les salons de massage constituant les services les plus institués jusqu’aux formes les plus labiles que représentent les « marcheuses » de Chine du Nord en situation illégale à Paris. Toutes les études décrivent des activités de femmes, à part l’enquête sur les travestis en Suisse (Loïse Haenni, chap. 9).
Anodine à y regarder de trop loin, l’idée de travail du sexe constitue pourtant un « tournant théorique », comme le note Paola Tabet dans le chapitre conclusif (p. 190). Il implique en effet de centrer le regard sur les tâches, les savoir-faire, les compétences et les techniques que demandent ces activités; de même que sur les codes et les postures professionnelles face au monde engagées par elles, sur un marché structuré par des rapports de pouvoir (p. 7). Ce n’est pas un hasard si le travail du sexe présente beaucoup de similarités avec les métiers de soins à la personne (care) car il mobilise de la même façon des ressources personnelles perçues comme féminines et, de ce fait, naturalisées et rendues invisibles. Malgré des efforts de professionnalisation mis en évidence par la plupart des enquêtes, deux recherches montrent au contraire le brouillage des frontières entre domaines public et privé, s’exprimant sur les plan affectif et sexuel (Marylène Lieber et Florence Lévy, chap. 3; et Marina Franca, chap. 8); brouillage typique des métiers féminins sous-qualifi és où le travail se présente comme une extension de l’activité domestique.
Les études de cas montrent bien comment les savoir-faire font l’objet d’apprentissages. Qu’on lise pour s’en convaincre la description parfois cocasse que nous livre Mathieu Trachman (chap. 5) des techniques du corps mobilisées par les acteurs pour répondre aux impératifs des scripts du cinéma porno. Autre savoir-faire acquis par l’expérience personnelle ou transmis par les collègues, celui du « travail de l’émotion ». Celui-ci consiste, dans sa version la plus commune, à trouver un savant équilibre entre passer le moins de temps possible avec le client tout en obtenant le maximum d’argent et en lui donnant envie de revenir. Dans sa version plus exigeante, il s’agit de cultiver une « girl friend attitude » qui implique une gestion sophistiquée du carnet d’adresses, de la frontière privé/public et des différentes touches émotionnelles de la relation au client.
L’approche par le travail a l’avantage d’ouvrir les frontières de l’analyse hors des limites qu’impliquent les prises de position misérabiliste ou triomphaliste, la première voyant dans 2 Compte rendu non thématique la prostitution un esclavage abject devant être interdit et la seconde une formidable liberté.
À l’encontre de la position misérabiliste, on peut opposer le degré d’agency de K., véritable chef d’entreprise individuelle travaillant dans un salon de massage érotique suisse (Alice Sala, chap. 6). Quant à la position triomphaliste, elle est contredite par l’exemple des prostituées boliviennes qui « moralisent » l’argent qu’elles gagnent en revendiquant son utilisation pour l’entretien de la famille, seule condition pour qu’elles ne considèrent pas elles-mêmes leur activité comme « vicieuse » (Pascale Absi, chap. 4). Les enquêtes montrent finalement des actrices mal placées sur le marché du travail, qui ont choisi la prostitution par comparaison avec d’autres activités. D’énormes contraintes pèsent sur elles et toutes s’efforcent de développer des marges de manoeuvre en même temps que de dégager des bénéfi ces financiers.
Le levier militant de cette prise de position théorique sur le travail du sexe est efficace: il arrime la prostitution dans le continuum des « échanges économico-sexuels » dont la forme la plus légitime est le mariage; un concept proposé par Paola Tabet il y a plus de vingt ans.
Mais l’intérêt de l’ouvrage dépasse la seule étude du commerce du sexe car il ouvre plus largement sur des questions telles que: « qu’est-ce que le travail des femmes? », « qu’est-ce que le travail en général? » et même « qu’est-ce que le sexe? », comme le dit Paola Tabet en proposant de nouvelles orientations de recherche dans le chapitre conclusif. Cet ouvrage conjugue finalement tous les ingrédients de la réussite scientifique et militante, ce qui n’est pas si commun. Il aurait par contre certainement gagné à traiter plus profondément la question méthodologique qui va moins de soi qu’il n’y paraît.
Anne-Yvonne Guillou, Anthropologie et Sociétés, vol. 34, 2010
Référence:
Tabet Paola, 1987, « Du don au tarif. Les relations sexuelles contre compensation », Les Temps modernes, 490: 1-53.
Dans La nouvelle revue du travail
« Le ‘plus vieux métier du monde’ n’a été étudié sous l’angle du « travail » que de manière remarquablement timide » (p.10). Dévoiler la réalité de ces « métiers du sexe » comme travail, alors qu’elle est encore largement occultée – y compris par les sciences sociales: tel est l’objet de ce livre. Il résulte d’un colloque tenu à Neuchâtel en janvier 2008. Cachées, ces activités ont pourtant une dimension massive, ce que l’approche économique reconnaît à sa manière quand elle en parle comme « industrie du sexe ». C’est-à-dire, selon un article récemment publié sur la question, « non seulement la prostitution ou le trafic d’êtres humains à des fins sexuelles […] (mais aussi) la pornographie, la commercialisation de produits destinés aux adultes, les clubs de striptease, le tourisme sexuel, le cybersexe. Selon les pays, ces activités peuvent être légales ou illégales et, en ce dernier cas, renvoient à des catégories plus larges, mais souvent floues de marché noir, d’économie souterraine ou encore d’économie de l’ombre […]. Près de 250 millions de personnes seraient consommatrices des biens et services produits par ces industries dont le chiffre d’affaires représenterait près de 100 milliards de dollars selon des sources américaines se rapportant à l’année 2006, et se serait multiplié par 6 en 20 ans. En comparaison, et pour la même période, le chiffre d’affaires de Microsoft s’élevait à 44,8 milliards de dollars… « .1
Sur un total de onze, huit chapitres du livre présentent autant de résultats d’enquêtes sur des activités et des contextes très variés de production de services sexuels. Trois autres contributions sont à dominante théorique et épistémologique, mais le chapitre de Pascale Absi sur les maisons closes en Bolivie comporte également d’importants développements théoriques. Avant de présenter les lignes de force de ces quatre contributions plus générales, signalons que les situations empiriques présentées dans le livre se situent en Amérique latine (Brésil, Bolivie, Colombie) et en Europe (Suisse et France): maisons closes en Bolivie (Pascale Absi); prostituées « traditionnelles » en camionnettes du Bois de Vincennes (Malika Amouche); rues et bordels de Belo Horizonte au Brésil (Marina França); salons de massages érotiques en Suisse (Alice Sala); migrantes venues du Nord de la Chine à Paris (Lieber et Lévy); organisations des déplacements des danseuses de cabaret en Suisse (Romaric Thiévent): travestis brésiliens en Suisse (Loïse Haenni); tournages de films pornographiques en France (Mathieu Trachman). L’ensemble est une somme de grande qualité qui intéressera quiconque réfléchit à ce qu’est le travail, et ne néglige aucune des situations sociales limites qui permettent d’en renouveler l’approche.
Les quatre contributions les plus transversales prennent de front les questions suivantes: pourquoi traiter du « travail du sexe » reste-t-il si difficile dans l’espace politique et académique? Dans quelle mesure appréhender ces activités comme « travail du sexe » en éclaire-t-il les réalités, tout en portant un éclairage plus large à la fois sur le travail et sur les rapports sociaux de sexe?
Les coordinatrices du livre sont parties de la nécessité de sortir d’un champ de discussion très polémique et très polarisé entre deux points de vue: la prostitution comme forme extrême d’exploitation, excluant son approche comme travail; ou, au contraire, comme activité remettant en cause les rapports d’exploitation et traduisant une certaine liberté via sa qualité de travail rémunéré. On sait que ces deux postures divisent profondément le mouvement féministe, alors que certaines luttes ou associations de prostituées – certaines étant explicitement rattachées au mouvement syndical – demandent, comme le fait d’ailleurs également l’OIT, leur reconnaissance en tant que « travailleuses du sexe », et revendiquent donc les droits sociaux associés au statut de travailleur.
Dans la présentation générale du livre, les trois éditrices se demandent d’abord comment rendre compte de la quasi-absence d’approche de la prostitution comme travail. Certes ce sont des activités illégales pour lesquelles l’accès au « terrain » est difficile, mais d’autres activités « informelles » ou « souterraines » ont été bien mieux explorées. Par ailleurs, on assiste à une légalisation de la prostitution dans de nombreux pays. Mais une légalisation qui ne lève pas le stigmate qui lui est associé ni n’éradique ses formes clandestines: les migrantes en situation irrégulière sont nombreuses dans les segments les plus précaires de ces activités. Pour autant, faut-il réduire les prostituées au statut de marionnettes, entièrement victimes de leur sort, privées de toute marge de manœuvre sur leur destin ? Plus fondamentalement, les auteures expliquent le refoulement du travail sexuel par le « biais misogyne », lequel fait du « sexe » une affaire de nature pour le seul genre féminin. S’il s’agit d’une activité rémunérée, la science économique devrait sans hésitation aucune l’inclure dans son objet. Mais y fait obstacle la force des représentations populaires, pour lesquelles c’est justement la présence de l’argent dans le contexte d’activités sexuelles qui est un impensé, voire un impensable. Or, si l’on reprend l’ensemble des critères définissant « le travail », dans son sens ordinaire et quotidien, a priori un seul d’entre eux pose un problème, fort significatif au demeurant: celui de la « dépense d’énergie » (physique ou mentale). En effet, ce critère se heurte à la représentation sexiste fondamentale des femmes comme passives dans l’acte sexuel. Pour le reste, c’est précisément le fait que l’activité prostitutionnelle a toutes les caractéristiques d’un travail rémunéré, mais pratiqué dans la sphère que le sens commun perçoit comme la sphère même de l’intimité et de la gratuité, qu’elle « viole alors une des normes fondamentales des rapports sociaux de sexe dominants » (p.19). Le système de genre exige la « gratuité » des « vrais » rapports sexuels au service d’un seul homme. En l’absence d’égalité économique et sociale entre les sexes, le mariage n’est que l’un des pôles d’un « continuum économico-sexuel »2, dont l’autre est la prostitution.
Rompre avec cet impensé ouvre donc la possibilité d’études ethnographiques – impliquant une pratique de présence « périphérique » – qui montrent la grande diversité des réalités du travail de sexe au sein d’un éventail bien plus ouvert que celui des deux pôles identifiés plus haut. Parmi les points forts et convergents de ces études, on relève: la hiérarchisation sociale des activités; l’importance des tâches non sexuelles, ainsi que des compétences à acquérir pour réaliser ces dernières; et donc le rôle des capacités d’action des personnes, qui se réduisent rarement au statut de pures victimes… même s’il s’agit toujours d’activités « choisies » sous forte contrainte: « Si des femmes choisissent de devenir et de rester prostituées, celles-ci ont rarement l’alternative entre avocate, professeure, ou pute » (Alice Sala, p.135). On ajoutera un autre critère parfois utilisé par des militantes abolitionnistes pour désigner le caractère stigmatisant et contraint de cette activité: aucune prostituée ne souhaite voir sa propre fille emprunter cette voie professionnelle.
En dehors de la présentation du livre par ses éditrices, trois autres contributions ont une ambition plus transversale. Celle de Lilian Mathieu, qui reprend certaines conclusions de son travail pionnier pour ce qui est de la France, La condition prostituée, Textuel, 2007. Il insiste sur son double enjeu, de classe – les femmes concernées sont issues des milieux sociaux les plus modestes – et de genre – la vente de services sexuels est condamnée parce qu’elle remet en cause la dépendance matérielle des femmes à l’égard des hommes. On doit ensuite à Pascale Absi, puis à Paola Tabet les deux autres réflexions les plus transversales de l’ouvrage.
Pascale Absi s’appuie sur une ethnographie des maisons closes en Bolivie pour montrer qu’au-delà de la plasticité des représentations qu’ont les prostituées de leur activité, sa réalité est bien plus proche de celle « des vendeuses sur les marchés boliviens que les membre d’un club de sport ou d’une association citoyenne » (p.96). L’anthropologue est donc en droit d’utiliser la catégorie de « travail du sexe » pour désigner une réalité qui n’est pas pensée sous cette catégorie par les prostituées. Mais elle prend soin de préciser que « démontrer qu’il existe une construction qui est conforme aux représentations classiques du travail […] n’implique pas nécessairement de militer pour la professionnalisation juridique de la profession » (p.100).
Un point fort et commun à l’ensemble des contributions du livre porte sur l’ensemble des stratégies et des tactiques construites par les travailleurs du sexe afin de mettre à distance le stigmate, de séparer la prestation de services sexuels de la sphère des relations intimes ou amoureuses, de maîtriser autant que faire se peut le choix des clients et des prestations, d’optimiser le rapport entre temps et rémunération des actes. Autant de traits que l’on retrouve effectivement dans la condition sociale et les pratiques professionnelles d’autres travailleurs.
Paola Tabet tire quelques conclusions du colloque en s’arrêtant sur deux de ses enjeux théoriques. Le premier est celui de la dé-naturalisation des activités économiques liées au sexe que permet leur conceptualisation comme travail, puisqu’elle rend visibles – de même que pour le travail domestique – les compétences et apprentissages spécifiques qu’elles supposent. En tant que pourvoyeur de ressources financières moins médiocres que celles des autres activités qui forment l’horizon de leurs possibles, ce travail permet d’échapper, d’une certaine manière, à l’emprise des hommes, père ou mari. Telle femme entièrement dépendante économiquement de son mari n’accepte de relations sexuelles avec lui que par obligation, par contrat moral. Telle autre, qui subvient à ses besoins, est en position de refuser les relations sexuelles non souhaitées. Appréhender ces activités comme travail permet également de dévoiler l’importance du travail émotionnel qui conditionne, comme dans d’autres activités de service, mais de manière plus radicale, la non-identification totale avec le travail.
Le second est un retour sur le concept d’échange économico-sexuel, initialement proposé par l’auteure, pour penser le fait que « toute forme de relation sexuelle comporte une compensation de la part de l’homme pour le service sexuel fourni par la femme », et que les formes sociales en varient, interdisant une définition universelle – et non relationnelle – de ce qu’est la prostitution et la prostituée: il y a un continuum allant du mariage à la prostitution. L’axe théorique se déplace alors vers « le lien organique […] entre la gestion de la sexualité, la division sexuelle du travail, et l’accès inégal aux ressources » (p.200). Dans nos sociétés, les inégalités de genre sont légitimées par une vision différentialiste qui naturalise une supériorité des besoins sexuels chez les hommes, et qui interdit de saisir cette continuité allant du mariage à la prostitution dans les échanges économico-sexuels. Le fait que la prostitution masculine – marginale numériquement, et encore peu étudiée – soit nettement moins stigmatisée que la prostitution féminine indique clairement combien cette dernière est révélatrice du système de domination de genre et de sa reproduction.
Sans doute que les transformations sociales contemporaines, dans ce domaine comme dans tant d’autres, sont porteuses de nombreux paradoxes et de bien des contradictions. Le creusement des inégalités à l’échelle mondiale suscite des flux migratoires prenant parfois la forme de trafics d’êtres humains. Mais les évolutions des formes légitimes de sexualité et des rapports sociaux de sexe ne sont pas sans remettre en question le noyau différentialiste qui légitime la domination masculine. Nombreuses sont donc les voies ouvertes à ce champ de recherche prometteur, à l’heure où les débats sont relancés en France autour des manières de combattre la prostitution – via, par exemple, la pénalisation des clients, comme c’est déjà le cas en Suède… Parmi ces voies, une mise en perspective comparative internationale serait des plus précieuses.
Paul Bouffartigue, La nouvelle revue du travail [En ligne], 3|2013, mis en ligne le 30 octobre 2013, URL: http://nrt.revues.org/1189
Notes
1. Blanca Jiménez García, « Les industries du sexe: une économie en pleine expansion », Les clés du social, http://www.clesdusocial.com/, 24 Juillet 2013.
2. Paola Tabet, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, L’Harmattan, 2004.
Dans la revue Sociologie du travail
Cet ouvrage trouve son origine dans un colloque organisé en janvier 2008 à l’université de Neuchâtel et se focalise sur la description des activités rémunérées d’hommes prostitués travestis, de danseuses de cabaret, de prostituées « de luxe » en Suisse, de prostituées au Brésil ou et d’acteurs et d’actrices de films pornographiques. Il explore simultanément les activités annexes, explicitement rémunérées: travail émotionnel (maintien du lien avec les « habitués »), travail d’établissement de normes collectives (dans le Bois de Vincennes), travail de mise en congruence des fantasmes masculins (tels qu’imaginés par les metteurs en scène) et des dispositions possibles des corps sur les lieux de tournage.
La description de la place marginale qu’occupe le travail du sexe dans la sociologie du travail est l’objet de l’introduction de l’ouvrage. Il s’agit bien là de travail (parce que ces activités impliquent des compétences et des savoir-faire, des formes de rémunération et des techniques du corps, etc.), et d’autant plus dans le contexte régulationniste des différents cantons de la Confédération helvétique qui insère ces activités dans un réseau de lois et de réglementations. Mais les directrices de l’ouvrage insistent sur la variété des formes que peut prendre ce travail, ainsi que sur leur invisibilisation théorique. L’on a, certes, face à nous des activités ne disposant pas de dispositifs autonomes d’objectivation, des activités principalement féminines, souvent naturalisées et illégitimes, sinon illégales, et qui, le plus souvent, sont embrassées par les recherches de sciences sociales sous l’angle « des questions morales et philosophiques ».
Le projet de l’ouvrage est alors de proposer quelques réponses à la question « comment comprendre le travail dans le ‘travail du sexe' » (p.10), réponses apportées par des enquêtes ethnographiques. Réalisées dans des contextes et des lieux variés, celles-ci n’apportent pas de réponse univoque, mais s’inscrivent toutes dans une démarche « qui reconnaît que le travail du sexe peut être une forme d’oppression et d’exploitation tout en soulignant qu’il peut être le lieu de stratégies et d’options » (p.9).
Les multiples perspectives individuelles développées dans les huit contributions ethnographiques sont bien éclairées par deux autres contributions synthétiques: le premier chapitre, écrit par Lilian Mathieu, ainsi que le dernier, par Paola Tabet, proposent deux perspectives sensiblement différentes, présentes à un titre ou à un autre dans les travaux empiriques.
L. Mathieu revient sur l’utilité du recours à l’ethnographie, méthode qu’il a utilisée pour ses études sur la prostitution et qui permet une « théorisation à partir des données de terrain » (p.39). Il pose, à la fin du chapitre, l’un des axes de l’ouvrage: il n’y a « pas de césure nette entre la sexualité vénale et d’autres activités de l’économie, tant légale qu’informelle », il y a au contraire un continuum. Cet axe se perçoit dans certaines contributions: celle de Romaric Thiévent, bien que portant explicitement sur les « compétences circulatoires » des danseuses de cabaret – et décrivant la marge de liberté dont elles disposent grâce à ces compétences -, nous informe aussi du rôle que jouent les managers, agents et autres intermédiaires qui placent ces danseuses auprès des patrons des cabarets.
La contribution d’Alice Sala (qui fut réceptionniste d’une prostituée auto-entrepreneuse, en Suisse) et celle de Mathieu Trachman (sur les tournages de films pornographiques) montrent une économie légale, bien qu’illégitime. Dans ce cadre, comme le montre la contribution de Marylène Lieber et Florence Lévy, le « choix » éventuel du travail du sexe se comprend en relation avec « l’ensemble des activités rémunérées possibles » pour la classe de personnes considérée.
La conclusion de l’ouvrage, par Paola Tabet, propose la prise en compte d’un autre continuum: il ne s’agit plus du continuum de situation sur le marché du travail – entre sexualité vénale et autres activités rémunérées -, mais d’un continuum économique qui se déploie entre le pôle des transactions intimes les plus légitimes – le mariage – et celui de la rétribution financière explicite d’activités sexuelles – la prostitution. P. Tabet, rappelons-le, place sur ce continuum de l' »échange économico-sexuel » toute forme de relation sexuelle comportant une compensation de la part de l’homme pour le service fourni par la femme (p.199).
Sur ce continuum de relation entre partenaires s’inscrivent des situations variées qui font de la sexualité féminine un objet de transactions. Une partie des contributions (celles d’A. Sala, de M. Franca, de L. Haenni) s’ordonnent autour de ce continuum, en montrant ce que le travail du sexe emprunte au pôle opposé. L’étude porte, par exemple, sur le « travail émotionnel », l’usage des fantasmes masculins (tels qu’imaginés par les metteurs en scène) et des dispositions possibles des corps sur les lieux de tournage.
La description de la place marginale qu’occupe le travail du sexe dans la sociologie du travail est l’objet de l’introduction de l’ouvrage. Il s’agit bien là de travail (parce que ces activités impliquent des compétences et des savoir-faire, des formes de rémunération et des techniques du corps, etc.), et d’autant plus dans le contexte régulationniste des différents cantons de la Confédération helvétique qui insère ces activités dans un réseau de lois et de réglementations. Mais les directrices de l’ouvrage insistent sur la variété des formes que peut prendre ce travail, ainsi que sur leur invisibilisation théorique. L’on a, certes, face à nous des activités ne disposant pas de dispositifs autonomes d’objectivation, des activités principalement féminines, souvent naturalisées et illégitimes, sinon illégales, et qui, le plus souvent, sont embrassées par les recherches de sciences sociales sous l’angle « des questions morales et philosophiques ».
Le projet de l’ouvrage est alors de proposer quelques réponses à la question « comment comprendre le travail dans le ‘travail du sexe' » (p.10), réponses apportées par des enquêtes ethnographiques. Réalisées dans des contextes et des lieux variés, celles-ci n’apportent pas de réponse univoque, mais s’inscrivent toutes dans une démarche « qui reconnaît que le travail du sexe peut être une forme d’oppression et d’exploitation tout en soulignant qu’il peut être le lieu de stratégies et d’options » (p.9).
Les multiples perspectives individuelles développées dans les huit contributions ethnographiques sont bien éclairées par deux autres contributions synthétiques: le premier chapitre, écrit par Lilian Mathieu, ainsi que le dernier, par Paola Tabet, proposent deux perspectives sensiblement différentes, présentes à un titre ou à un autre dans les travaux empiriques.
L. Mathieu revient sur l’utilité du recours à l’ethnographie, méthode qu’il a utilisée pour ses études sur la prostitution et qui permet une « théorisation à partir des données de terrain » (p.39). Il pose, à la fin du chapitre, l’un des axes de l’ouvrage: il n’y a « pas de césure nette entre la sexualité vénale et d’autres activités de l’économie, tant légale qu’informelle », il y a au contraire un continuum. Cet axe se perçoit dans certaines contributions: celle de Romaric Thiévent, bien que portant explicitement sur les « compétences circulatoires » des danseuses de cabaret – et décrivant la marge de liberté dont elles disposent grâce à ces compétences -, nous informe aussi du rôle que jouent les managers, agents et autres intermédiaires qui placent ces danseuses auprès des patrons des cabarets.
La contribution d’Alice Sala (qui fut réceptionniste d’une prostituée auto-entrepreneuse, en Suisse) et celle de Mathieu Trachman (sur les tournages de films pornographiques) montrent une économie légale, bien qu’illégitime. Dans ce cadre, comme le montre la contribution de Marylène Lieber et Florence Lévy, le « choix » éventuel du travail du sexe se comprend en relation avec « l’ensemble des activités rémunérées possibles » pour la classe de personnes considérée.
La conclusion de l’ouvrage, par Paola Tabet, propose la prise en compte d’un autre continuum: il ne s’agit plus du continuum de situation sur le marché du travail – entre sexualité vénale et autres activités rémunérées -, mais d’un continuum économique qui se déploie entre le pôle des transactions intimes les plus légitimes – le mariage – et celui de la rétribution financière explicite d’activités sexuelles – la prostitution. P. Tabet, rappelons-le, place sur ce continuum de l' »échange économico-sexuel » toute forme de relation sexuelle comportant une compensation de la part de l’homme pour le service fourni par la femme (p.199).
Sur ce continuum de relation entre partenaires s’inscrivent des situations variées qui font de la sexualité féminine un objet de transactions. Une partie des contributions (celles d’A. Sala, de M. Franca, de L. Haenni) s’ordonnent autour de ce continuum, en montrant ce que le travail du sexe emprunte au pôle opposé. L’étude porte, par exemple, sur le « travail émotionnel », l’usage des émotions dans le travail, le « travail relationnel »: dans ce cadre, ce sont certains interdits qui fixent l’espace de la « vie privée ». A. Sala, en se centrant sur les usages du temps (la prostitution est un métier d’attente) montre comment maintenir le contact avec les clients, par téléphone et SMS, permet d’associer certaines relations avec des habitués à des « girlfriend experiences » où les partenaires ne sont « ni interchangeables, ni exclusifs » (p.129) et où la relation ne s’éteint pas une fois la rémunération versée.
Ces deux continuums ont pour effet de rapprocher l’étude du travail du sexe à la fois de la sociologie du travail « classique » et de la sociologie de la vie privée (que ce soit celle de la famille, du mariage ou de la sexualité légitime).
Certaines contributions proposent d’autres importations conceptuelles. Signalons-en une, qui tente le transfert vers la sociologie du travail d’une notion développée par des sociologues de la sexualité. M. Trachman choisit d’appuyer son texte sur la notion de « script », à l’origine forgée par John Gagnon et William Simon: le « script pornographique n’est pas simplement le scénario du film mais le schème par rapport auquel [il] est conçu » (p.102). Ainsi « une certaine image du consommateur détermine la production pornographique » (p.108): l’organisation du travail sur le tournage est déterminée par les représentations jugées nécessaires pour aboutir à un film pornographique. Cette notion présente l’intérêt de faire tenir ensemble des analyses externalistes (prenant en compte l’organisation matérielle des tournages) et internalistes (insistant sur le récit ou l’esthétique du film), sans évacuer la dimension sexuelle et masturbatoire. Le script « organise le tournage », structure la coordination de l’équipe mobilisée, mais dépend des « fantasmes » masculins (ou de ce que les pornographes imaginent être ces fantasmes).
Au total, l’ouvrage dévoile sans tartufferie ni angélisme « ce travail que je ne saurais voir ». Il tente d’organiser une rencontre autour d’un objet profondément investi par des luttes morales, entre les habitudes de recherche importées de la sociologie du travail et celles issues de la sociologie de la sexualité. La richesse de la bibliographie (anglophone et francophone, regroupée en fin d’ouvrage) montre que cette rencontre a déjà une petite histoire et vient d’ailleurs nuancer le diagnostic d’invisibilité: ce travail « que l’on ne saurait voir », la sociologie, et la sociologie du travail, commencent sérieusement à le regarder.
Baptiste Coulmont, Sociologie du travail, no. 55/2013, pp.113-115
Dans la Revue française de science politique
Dans Cachez ce travail que je ne saurais voir, il s’agit d’analyser des activités liées au sexe au prisme de la catégorie de travail; partant du constat de l’extrême diversité des conditions et modalités d’exercice, les auteurs mobilisent la notion de travail pour dévoiler de nouveaux aspects de la sexualité vénale. […]
À partir d’une lecture « ethnographique et féministe de la notion de travail », l’ouvrage collectif rend visible certaines dimensions du travail du sexe habituellement invisibilisées par les discours académiques et scientifiques. Le travail du sexe est ainsi généralement appréhendé en tant que déviance ou comme problème de santé publique. Certaines représentations dominantes font obstacle à une appréhension holiste, notamment l’idée d’une sexualité féminine naturelle, passive, ainsi que l’antinomie présumée entre intimité et transaction économique. À rebours de ces positions, les contributions de l’ouvrage mettent en exergue de nouveaux aspects des transactions sexuelles et l’imbrication des rapports de pouvoir dont elles procèdent.
C’est après ces propos introductifs sur la perspective épistémologique retenue que l’on passe à la petite dizaine de contributions qui font le corps de l’ouvrage. Les terrains sont très variés: rôle de l’ethnographie dans les travaux sur la prostitution, ethnographie de prostituées du bois de Vincennes à Paris, trajectoires des prostituées chinoises à Paris, ethnographie de prostituées des classes populaires en Bolivie, contribution sur la production de films pornographiques, étude de cas d’une prostituée suisse, trajectoires circulatoires des danseuses de cabaret en Suisse, émergence d’affects entre clients et prostituées issues des classes populaires à Belo Horizonte au Brésil, ethnographie de travesties brésiliennes travaillant en Suisse.
L’ouvrage souligne la polysémie de la notion de travail et l’utilisation qui en est faite s’avère très heuristique. Confrontant les définitions du travail élaborées par la théorie économique classique et les politiques publiques d’une part, avec celles du sens commun d’autre part, Pascale Absi propose une « appréhension anthropologique du débat sur la professionnalisation ». Son ethnographie met en évidence « ce qui fait métier » pour les prostituées de Bolivie issues des classes populaires, les rites professionnels et les ressorts de la construction des identités. Elle invite donc à distinguer la « demande de droits sociaux » de la professionnalisation de fait.
Envisager la prostitution comme un travail permet aussi d’en révéler des aspects méconnus. Loïse Haenni évoque ainsi le cas de travestis brésiliens travaillant en Suisse, d’apparence féminine. Alors qu’ils se disent homosexuels assumés et revendiquent un rôle sexuel passif dans leur vie privée, leur travail consiste le plus souvent à adopter un rôle actif puisque de nombreux clients demandent à être sodomisés. À ce titre, ils sont méprisés des autres travestis qui les qualifient entre eux de « sales pédés ». Certaines contribution portent davantage sur les « règles du métier ». Lilian Mathieu appelle à ce propos à une certaine prudence dans l’interprétation. Il souligne que les règles existent avant tout comme des ressources discursives, mobilisées de façon stratégique mais rarement respectées. Le rapport aux règles du métier est au centre de la contribution de Marina França. À partir d’une ethnographie des activités prostitutionnelles de femmes de classes populaires dans la zone bohème de Belo Horizonte, elle montre comment les frontières du professionnel et du privé s’interpénètrent dans les relations que les prostituées nouent avec certains clients. L’appréciation qualitative de l’activité prostitutionnelle varie aussi, comme le montre Malika Amaouche dans son ethnographie de la prostitution dans le bois de Vincennes. Après avoir mis en évidence les modalités concrètes de régulation de l’activité, ses modes d’organisation individuelle et collective, et les règles qui en régissent les conduites, elle montre la grande variabilité qui existe dans l’appréciation qualitative que les femmes font de leur activité.
Le travail sexuel comporte aussi d’autres dimensions, non sexuelles. Alice Sala décrit ainsi les multiples compétences affectives que déploie une prostituée suisse. Elle doit notamment gérer finement les appels téléphoniques: allécher mais ne pas trop s’exposer, appâter sans fournir de prestation gratuite de « sexe au téléphone ». À certains clients, cette femme offre la Girl Friend Experience: il s’agit de vendre l’ensemble du rêve de la femme parfaite, au-delà de la simple prestation sexuelle. L’éclairage sur la perception de cette prestation par les clients montre comment ils l’attribuent à une inclinaison naturelle, à un « feeling« . Un autre type de compétence, liée à la capacité de gérer ses déplacements, est abordé par Romaric Thiévent. À partir d’une analyse des trajectoires circulatoires et pendulaires des danseuses de cabaret en Suisse, il montre que la mobilité – à la fois entre les différents cabarets où elles travaillent et entre deux ou plusieurs espaces nationaux – est un élément central de leur activité. D’autres chapitres concourent à montrer la part non sexuelle du travail du sexe. Mathieu Trachman décrit ainsi les nombreuses activités requises par le travail de mise en scène de l’hétérosexualité dans la production d’un film pornographique: gestion collective de l’intimité, techniques du corps et artifices pour se conformer au script pornographique. L’ensemble de ces actions vise à créer l’illusion de l’authenticité, laquelle demeure un objectif central de la filière.
Une autre contribution importante de cet ouvrage est l’attention portée à « prendre en compte, sur un terrain donné, la spécificité de l’organisation du commerce sexuel en relation avec la vie probable des femmes en dehors ». Réenchâsser de la sorte le travail sexuel permet de se prémunir, selon P. Absi, de l’exercice d’une certaine « violence interprétative » qui consiste à analyser l’expérience des prostituées uniquement au prisme de leur activité sexuelle. Il est tout à fait essentiel de considérer les autres facettes de leur vie sociale, tant pour éviter ce redoublement de violence symbolique que pour élaborer une analyse de leurs modes d’insertion dans la société. C’est avec ce souci que Marylène Lieber et Florence Lévy mettent au jour le faisceau de discriminations dans lequel sont prises des prostituées chinoises à Paris: discriminées en tant que femmes du Nord de la Chine au sein de la communauté chinoise, en tant que femmes sur le marché du travail communautaire déjà saturé et dominé par les hommes, et enfin en tant que sans-papiers cantonnées au travail illégal. Leurs opportunités se trouvent de la sorte particulièrement contraintes, et la prostitution est alors conçue comme une activité temporaire dans leur trajectoire de migration.
L’ouvrage développe également une réflexion sur le rapport entre prostitution et travail, entendu comme matrice principale de l’intégration sociale dans les sociétés occidentales via les droits qui lui sont attachés. L. Mathieu propose d’appréhender la prostitution comme une figure de la désaffiliation, au sens où Robert Castel1 l’a développé. Cet usage de la notion invite à penser les configurations singulières du travail sexuel et ses rapports avec les structures du travail en général. Mais l’affiliation se joue aussi dans le devenir des revenus engrangés dans l’activité prostitutionnelle, comme le montre P. Absi. Si les revenus sont réinjectés dans les circuits de la circulation monétaire morale (éducation des enfants, entraide intrafamiliale, etc.), la prostitution est reconnue comme travail. Dans le cas contraire, elle est disqualifiée et renvoyée au « vice ». […]
Julie Castro, Revue française de science politique, vol. 61 no. 5, 2011, pp.968-970
1. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995
Dans Travail, genre et sociétés
« Cachez ce travail que je ne saurais voir ». Ethnographies du travail du sexe est un ouvrage original à plus d’un titre, tant par sa forme que par son contenu. Bien qu’il soit né à la suite d’un colloque qui s’est tenu en 2008 à l’Université de Neuchâtel, il ne saurait se réduire à la simple publication des actes de ce colloque qui n’en constitue, en réalité, que le point de départ.
Première originalité, l’ouvrage se présente en effet comme une synthèse à la fois théorique et empirique sur les métiers du sexe, en contrevenant à un certain nombre de présupposés: en premier lieu, celui qui vise à exclure de l’univers de la prostitution les notions de travail et de marché. D’entrée de jeu, les codirectrices de cette synthèse rappellent que la prostitution correspond à un champ professionnel avec ses codes, ses statuts sociaux, ses qualifications, son marché, le tout structuré par des rapports de production et donc de pouvoir. Dès lors, l’ouvrage fait le pari d’analyser l’univers prostitutionnel, avec cette hypothèse forte en trame de fond, tout en l’éclairant par des analyses à la fois empiriques et théoriques.
Seconde originalité, comme l’indique le sous-titre, les travaux recensés s’inscrivent tous dans une perspective ethnographique. Cette posture méthodologique, délibérément affichée dès l’introduction, a pour but de corriger et nuancer un « moralisme rapide » (p.8) ou un « empirisme naïf » s’agissant de la prostitution. La position morale la plus partagée, notamment dans les milieux militant, académique et médiatique, consisterait, d’une part, à dire que les activités du sexe renvoient à une exploitation extrême qui exclut la notion même de « travail », tandis que, d’autre part, un discours opposé tiendrait la prostitution comme une forme d’autonomie et de liberté qui l’éloignerait tout autant du travail. Or, ces deux positions tranchées et contradictoires empêcheraient de voir qu’il existe en réalité une diversité de pratiques et de stratégies nuançant ces deux approches et permettant de replacer le travail au centre des activités du sexe. Dans ce contexte, les auteures plaident pour une approche qui, sans nier aucune de ses positions – exploitation extrême ou autonomie-, s’intéresserait à l’articulation de l’une à l’autre. En d’autres termes, l’ouvrage s’emploie à montrer que si le travail du sexe « peut être une forme d’oppression et d’exploitation […] il peut également être le lieu de stratégies et d’options, voire de libertés individuelles » (p. 9), sans que cela soit contradictoire.
L’hypothèse forte du livre consiste donc à revenir sur l’impossibilité ou la difficulté, en sciences sociales, à considérer le travail du sexe comme un « travail », en se demandant comment expliquer ce « biais scientifique ». Ce biais est-il lié à la nature même des métiers ou du champ professionnel étudiés et au fait qu’il s’agisse plus souvent d’emplois féminins ou s’explique-il par un tabou entourant le sexe dans nos sociétés occidentales? Ou encore, la difficulté à analyser la prostitution comme un « travail » viendrait-elle d’une difficulté méthodologique à entrer sur le terrain et à conceptualiser l’activité prostitutionnelle? À cet endroit, la perspective résolument interactionniste se révèle éclairante et n’est pas sans rappeler la démarche d’Everett C. Hughes et de ses étudiants de l’Université de Chicago, dès les années 1930. Rappelons combien ces derniers avaient alors choqué les acteurs intellectuels, politiques et médiatiques dominants, par leur remise en cause de la définition légale et légitime de la « profession ». Leur travail de comparaison parut à l’époque extrêmement iconoclaste, en ce qu’il mettait en regard la profession de médecin, d’avocat, de prêtre et celle de prostituée, de concierge, d’infirmière. La perspective ethnographique adoptée dans l’ouvrage dirigé par Marylène Lieber, Janine Dahinden et Ellen Hertz peut, dans un premier temps, paraître tout aussi iconoclaste.
Il s’agit, troisième point original, dès l’introduction, de déconstruire l’histoire de la recherche en sciences sociales sur la prostitution, remettant en question son inscription dans une sociologie et une histoire de la déviance. Ensuite, il s’agit de revenir à l’évidence des faits, sans craindre le ridicule ni l’ironie: le travail du sexe est pour sa très grande part un travail de « femmes ». Pourquoi ne pas le reconnaître comme un travail, à l’instar du travail domestique? Or, à partir de cette évidence et au-delà du tabou qu’elle représente (les métiers du sexe sont très largement des métiers de femmes), une telle perspective permet une analyse critique essentielle montrant que « l’étude des métiers du sexe sous l’angle du travail se heurte […] à des représentations collectives faisant du « sexe » une affaire de nature pour un seul des deux sexes » (p.16). Les auteures font ici référence au stigmate associé aux prostituées féminines, rarement aux hommes prostitués; concernant ces derniers, le stigmate est subverti, soit qu’on dévalorise certains de ces hommes en les assimilant aux images de la féminité, soit qu’on les valorise sous le registre de la maîtrise sexuelle.
En outre, paradoxalement, alors que les économistes définissent le travail comme toute activité faisant l’objet d’une rémunération sur un marché, les représentations populaires semblent dénier à la prostitution ce statut économique du fait précisement de la transaction qu’elle représente sur ou au sujet du corps. C’est à cet impensé, à cette résistance dans l’ordre des représentations collectives, que s’attaque rigoureusement l’ouvrage. Si les éditrices évoquent le caractère « holistique » de la prostitution, c’est pour montrer qu’il existe, dans le processus inégalitaire, un continuum entre le marché du travail en général et le statut des femmes dans la prostitution en particulier. Dans cette perspective, l’accent est mis, dans les différents chapitres et thèmes abordés, sur les notions de compétences, de savoir et de savoir-faire, visant à montrer ce continuum.
Il est évident qu’une recherche sur la prostitution, Lilian Mathieu l’avait déjà souligné [2001]1, comporte des difficultés méthodologiques d’accès au terrain et de constitution des données. Si l’approche ethnographique, consistant dans les différents travaux presentés à restituer des observations et des entretiens, est apparue comme la meilleure méthodologie d’enquête dans ce contexte, elle n’a pas été pour autant sans obstacles ni difficultés. Le fait de travailler sur des personnes stigmatisées, pour certaines en situation irrégulière au regard de la loi, a rendu délicat le travail de terrain. Certains, parmi les chercheurs ayant contribué à l’ouvrage, ont adopté comme méthode complémentaire l’observation participante en se faisant passer, qui les hommes pour des clients, afin de mieux approcher les enquêtées, qui les femmes pour des danseuses sur table, sans aller jusqu’aux rapports sexuels payants, afin de mieux appréhender le double point de vue des prostituées et des clients. Une telle méthodologie n’est pas sans présenter des risques et des dangers et l’on ne peut que saluer de tels témoignages qui illustrent de manière magistrale cet équilibre fragile décrit par Norbert Elias entre « engagement et distanciation » [1993]2.
Plus concrètement, l’ouvrage s’organise en dix chapitres, en plus d’une introduction très problématisée et argumentée. II est difficile de rendre compte, dans le détail, de chaque chapitre car le plan d’ensemble ne paraît pas suivre un ordre logique. En effet, et c’est peut-être là une des critiques très mineures que l’on pourrait adresser à l’ouvrage: de prime abord, l’on a un peu de mal à se retrouver dans la succession des chapitres qui constituent autant d’éclairages différents sur la prostitution: en termes d’organisation de ce champ (du téléphone rose à la pornographie cinématographique), en termes de zones géographiques couvertes par les auteurs dans une grande diversité. Les chapitres ethnographiques restituent une part de méthodologie, tandis que les deux chapitres à orientation plus théorique (celui de Lilian Mathieu et celui de Pascale Absi) s’appuient également sur une expérience de terrain. Sans prétendre à l’exhaustivité, évoquons quelques-uns des moments forts de cette lecture. Le premier chapitre méthodologique, assume par Lilian Mathieu, traite de la méthode ethnographique, de ses usages et de sa pertinence pour constituer une « sociologie de la prostitution »; l’auteur dresse une « défense et illustration » de cette méthodologie particulière, notamment par l’observation directe et participante (dans des réseaux associatifs permettant une lente immersion et familiarisation avec le terrain, ses acteurs et actrices). Si cette posture méthodologique a l’avantage d’éviter certains biais rencontrés lors d’entretiens de recherche formalisés, elle comporte également des limites et contraintes en termes d’hypothèses, de dispositifs de recueils de données, etc. Au-delà de l’aspect méthodologique, l’intérêt de ce premier chapitre réside dans ce qu’il contribue à montrer: la prostitution ne constitue pas un phénomène « à part », mais elle participe au contraire d’un processus de désaffiliation, sans césure nette entre l’activité formelle et informelle, les contraintes sociales générales (payer une chambre d’hôtel, par exemple) et les contraintes du métier. Le chapitre de Pascale Absi traite du débat relatif à la notion de travail s’agissant de la prostitution à partir des maisons closes boliviennes, débat qui oblige à réfléchir au statut de la prostitution et à la définition du travail, en particulier du travail des femmes. Entre les deux, se succèdent plusieurs enquêtes ethnographiques: sur les prostituées « traditionnelles » dans les camionnettes du Bois de Vincennes (Malika Amaouche), sur le flou identitaire des prostituées chinoises qui refusent d’en « être » tout en pratiquant la prostitution (Marylène Lieber et Florence Lévy), sur la prostitution par téléphone (Alice Sala), sur les danseuses de cabaret (Romaric Thiévent), sur la production pornographique (Mathieu Trachman). Marina Franca s’attache à montrer les frontières mouvantes entre affects et sexualité dans les chambres d’hôtels de prostitution, tandis que Loïse Haenn s’intéresse, en Suisse, aux travestis brésiliens (ou bichas) dans leurs interactions avec leurs clients hommes en mettant en évidence les logiques de retournement de pouvoir et d’hégémonie par les bichas par le truchement du langage.
Le chapitre conclusif de Paola Tabet s’avère tout aussi important que l’introduction car il fait la synthèse entre les différents terrains ethnographiques autour de la notion de travail. Les compétences des actrices de films pornographiques analysées par Mathieu Trachman et celles des prostituées des maisons closes boliviennes étudiées par Pascale Absi ne semblent pas très éloignées des « techniques du corps et, plus encore, de la gestion de l’émotion, indispensable à tout travail relationnel » (p.190). En outre, la conclusion insiste sur plusieurs enjeux, comme la mondialisation de la prostitution et la nécessité d’adopter une approche multidisciplinaire et transnationale; mais aussi l’importance qu’il y aurait à décentrer le débat en s’intéressant non seulement aux prostituées, mais également aux hommes impliqués aux différents niveaux du processus. Enfin, la notion de frontières apparaît décisive pour comprendre et mieux analyser le fait prostitutionnel: frontière non seulement géographique, comme on l’a dit avec la question de la mondialisation et des réseaux prostitutionnels, mais frontière entre travail et hors-travail, entre famille et société, entre la sexualité légitime et illégitime. Tels sont quelques-uns des thèmes rappelés dans cette partie conclusive, qui précède une bibliographie extrêmement diversifiée et très complète sur la question.
Tania Angeloff, Travail, genre et sociétés no. 26, novembre 2011, pp.236-239
1 Lilian Mathieu, 2001, Mobilisations et prostituées, Paris, Belin.
2 Norbert Elias, 1993 [1983], Engagement et distanciation, Paris, Fayard.
« Elle met en scène une relation d’exclusivité »
Immersion. Pour son travail de mémoire, l’ethnologue neuchâteloise Alice Sala a travaillé six mois comme secrétaire d’une prostituée genevoise. Sa spécialité: la « girlfriend experience ».
Le Temps: K., la prostituée genevoise que vous avez côtoyée, passe les trois quarts de son temps à se constituer une clientèle et à la fidéliser. Du point de vue du résultat commercial, comment s’y retrouve-t-elle?
Alice Sala: K. cherche les « bons » clients. Elle minimise ainsi le risque de rendez-vous manqués, très haut avec les clients de passage, et aussi celui des mauvaises rencontres. Elle mise sur la qualité – plus chère – plutôt que sur la quantité, exactement comme le restaurateur qui propose peu de tables et une cuisine soignée plutôt que du steak-frites à la chaîne. Cela lui demande un plus grand investissement – parler et écouter, dit-elle, est plus fatigant que d’offrir une prestation sexuelle. Mais c’est une stratégie commerciale qui lui assure un revenu de base régulier. C’est aussi ce qui lui procure le plus de satisfaction professionnelle.
– On est impressionné par son savoir-faire en matière de marketing. Sort-elle d’une « business school »? Quelle est sa formation?
– Elle a fait un apprentissage d’esthéticienne, mais, comme cela arrive souvent, elle s’est mariée, a fait des enfants et n’a jamais pratiqué. Lorsqu’elle s’est retrouvée mère célibataire, elle a opté pour le travail du sexe, qui lui garantissait un bon revenu et la possibilité d’être indépendante, notamment des services sociaux. A partir de là, elle a développé un grand savoir-faire. Un des buts de ma recherche était de le documenter: les compétences d’une prostituée ne sont pas innées!
– Ce qui est paradoxal, c’est que plus les clients la paient cher, moins ils sont prêts à reconnaître le « plus » qu’elle leur propose comme le fruit d’un travail.
– Oui, c’est le paradoxe. K. offre des prestations sexuelles qu’elle qualifie d' »irréprochables » et qui sont le fruit de sa maîtrise et de son expérience. Mais lorsqu’on lit les commentaires de ses clients sur les forums spécialisés, on constate qu’ils ne reconnaissent ni l’une ni l’autre. Pour eux, ce que K. a de plus que les autres, c’est qu’elle prend plaisir à faire ce qu’elle fait. Dans leur vision des choses, une expérience est réussie avec une prostituée lorsqu’il y a « feeling », c’est-à-dire quelque chose qui ne se commande pas. Cela revient, en somme, à nier ses compétences.
– Qu’est-ce qui, concrètement, fait la différence entre la visite chez une prostituée et ce qu’on appelle sur les forums la « session GFE » (girlfriend experience)?
– La « girlfriend experience » est un théâtre où se met en scène une relation d’exclusivité. Les deux partenaires savent que ce n’est pas vrai, mais ils font comme si. La prestation de la prostituée comprend du sexuel et du relationnel, mais ce qui fait la différence, c’est le relationnel. Concrètement, elle offre de l’écoute, de la conversation, elle passe du temps à répondre aux SMS ou aux coups de fil. Elle entretient l’idée d’une relation spéciale entre une prostituée unique et un client exceptionnel. Elle se présente comme une bonne copine très belle et très sexuelle, une sorte de maîtresse idéale qui offre les avantages de la polygamie sans ses inconvénients: jamais, en effet, elle ne téléphonera chez un client ou cherchera de quelque manière que ce soit à s’imposer dans sa vie.
– Lui arrive-t-il d’être tentée de croire à une vraie relation comme Chelsea dans le film The Girlfriend Experience?
– Non. Cela arrive peut-être à d’autres, mais pour K., les choses sont claires. Elle a un ami, des enfants, son appartement, son indépendance, et ne cherche pas à être « sauvée » par le gentil client comme dans les contes de fées de la prostitution. En revanche, elle a décliné des propositions de clients qui voulaient « la sortir de là ».
– En somme, c’est une femme épanouie qui a choisi un métier comme un autre?
– On peut dire que K. a choisi ce travail dans la mesure où elle n’est pas une toxicomane ni une esclave sexuelle sous la coupe d’un maquereau. Mais elle n’a pas choisi de devenir prostituée plutôt qu’avocate ou médecin: cela reste un choix par défaut. Par ailleurs, si la prostitution est aujourd’hui légale en Suisse, elle reste très stigmatisée. Imaginez que c’est votre gagne-pain: allez-vous l’annoncer tranquillement, par exemple, aux profs de vos enfants? De fait, même les membres de la famille de K. ignorent la nature de son activité. Elle mène une double vie, avec deux numéros de téléphone, deux adresses et tout le reste. C’est certainement ce qui lui pèse le plus. En matière de « normalisation » du métier, on est encore loin du compte. K. est une femme épanouie, mais dans quelle mesure le doit-elle à son travail? D’ailleurs: combien de personnes au monde tirent leur épanouissement de leur travail? C’est une chose très rare. Peut-être un luxe de journaliste ou d’anthropologue
Ethnologues du pavé
Depuis quelques années, des ethnologues pratiquent l’immersion descriptive dans le quotidien des travailleuses et des travailleurs du sexe. En 2008, un certain nombre d’entre eux participaient au colloque international « Cachez ce travail que je ne saurais voir », organisé par l’Université de Neuchâtel. Les exemples ci-dessous sont tirés du livre qui en est issu (Editions Antipodes, Lausanne, 2010).
Chez les « traditionnelles » du Bois de Vincennes.Les « traditionnelles » se nomment ainsi par opposition aux prostituées migrantes qui exercent sous contrainte, note Malika Amaouche. Elles sont indépendantes et pratiquent dans des camionnettes garées en bordure du Bois. Les unes laissent la place aux « à-côtés » relationnels et visent la fidélisation du client: « l’habitué » est sécurisant. D’autres au contraire s’en méfient: toutes ses amies assassinées l’ont été par un habitué, note l’une d’elles. Une autre encore remarque qu’une fellation dure le temps d’une chanson: plus long, c’est trop. Les clients « de couleur » ou « d’origine maghrébine » sont volontiers snobés: ces hommes, expliquent les « traditionnelles », « ne respectent pas la femme. »
Chez les Brésiliennes de Belo Horizonte.C’est en travaillant pour une ONG que Marina França a trouvé ses entrées dans un hôtel de passe de cette ville du sud-est brésilien. Les mères célibataires y sont nombreuses. Malgré le caractère « comme bas de gamme » de l’établissement – jusqu’à 30 passes par jour de 15 minutes maximum -, nombre de prostituées fidélisent des « réguliers » et décrivent une limite floue entre vie privée et vie professionnelle. Certaines étaient des maîtresses d’hommes mariés avant de travailler là. Ce qui plaide pour la thèse, très populaire chez les chercheurs, d’un « continuum d’échanges économico-sexuels » qui comprendrait, à un bout, le mariage et, à l’autre, la prostitution, tous deux étant des options de survie pour les femmes.
Chez les travestis genevois.Loïse Haenni, qui a passé de longues heures dans l’appartement d’une travestie à Genève, raconte comment les « bichas » brésiliennes retournent la stigmatisation dont elles sont l’objet contre leurs clients: le fait qu’ils aiment se faire pénétrer tout en faisant « semblant d’être des hommes » fait d’eux des « sales pédés » à leurs yeux. Elles-mêmes, au contraire, « assument pleinement leur (homo)-sexualité » en affirmant aimer les hommes et en assumant, en privé, un rôle sexuel féminin. Entre les « bichas » et les clients qu’elles couvrent de leur mépris, la mise à distance émotionnelle est maximale.
Anna Lietti, Le Temps, 8 octobre 2011
Dans Sciences humaines
La production scientifique sur la prostitution et les activités sexuelles tarifées est abondante. Mais il est plus rare que les chercheurs les considèrent comme un travail. Les contributions réunies ici, tirées d’un colloque tenu en 2008, ont en commun d’essayer de décrire les activités de ces travailleurs (prostituées, acteurs et réalisateurs de porno, danseuses de cabaret ), activités qui, pour être liées au sexe, ne sont pas toujours sexuelles. Alice Pala (sic), qui a travaillé comme secrétaire pour une prostituée suisse, montre ainsi l’importance de la relation téléphonique pour attirer le client. Romaric Thiévent souligne, lui, qu’être danseuse de cabaret, c’est aussi savoir faire boire les hommes tout en restant maître de la situation
Mais la force principale de ce recueil est sans doute de mettre en évidence la diversité des compétences et des situations de ces travailleurs du sexe qui, s’ils n’échappent pas toujours à la domination et au stigmate, sont loin d’être toujours des exploités ou des esclaves. Au-delà de leur valeur documentaire, ces enquêtes sont une invitation bienvenue à complexifier notre regard sur les liens entre sexe, intimité et argent.
Xavier Molénat, Sciences humaines, n°221, 2010, p. 62
Impact économique de la prostitution
Alors qu’il est question de revoir l’âge légal de la prostitution, l’analyse deson impact économique s’avère nécessaire. Au-delà des débats moraux.
L’âge de la prostitution en Suisse pourrait être réajusté à 18 ans, mesure qui n’a que trop tardé à être adoptée. L’institutionnalisation de cette pratique dans le paysage économique et social ouvre un champ de réflexion économique considérable. En effet, le chiffre d’affaires global annuel que représente la prostitution en Suisse atteindrait d’après nos calculs (1) entre 3 et 6 milliards de francs. En faisant l’hypothèse que 80% des jeunes femmes sont d’origine étrangère, cela représente des transferts de l’ordre de 2,5 à 5 milliards de francs vers les pays d’origine.
Les recettes fiscales de la Confédération liées à ces activités sont difficiles à déterminer, le ratio entre pratiques déclarées et non déclarées restant à estimer, la répartition des clubs, principaux lieuxde pratique légale, donne toutefois une idée de la répartition du chiffre d’affaires légal et donc des perceptions fiscales possibles.
L’impact économique et social pour les pays recevant ces transferts, pour l’essentiel en Europe de l’Est, est à étudier avec attention. Les motivations (2) des prostituées étrangères est déterminant pour bien comprendre la nature des transferts et la criticité de ces derniers-ainsi que les conséquences sociales qui y sont attachées. En effet, à l’exception de deux propriétaires-gérantes de club de Genève et de Zurich, qui était elles-mêmes prostituées, aucune n’a déclaré exercer ce métier par choix. Certaines propriétaires de clubs étaient d’anciennes prostituées qui avaient monté leur affaire mais avaient stoppé l’exercice direct de la profession. Seules deux personnes interrogées pratiquaient le métier depuis plus de cinq ans.
Il s’agit donc avant tout d’une option de dernier recours pour faire face à des situations de détresse. 40% d’entre elles évoquent la nécessité de soutenir une famille, souvent du fait d’un divorce ou d’accidents de la vie (l’une d’entre elles évoquant le soutien de parents incapables de travailler). Les autres motivations peuvent êtreplus variées. Certaines pratiquantes espèrent ainsi trouver un mari qui les ferait rester en Suisse, sur le modèle de certaines célébrités (environ une sur dix). Une minorité significative explique avoir été mariée à des Suisses: un divorce, une absence d’expérience sur place et de qualifications reconnues les laisserait sans alternatives viables.
Toutefois, 20% évoquent la préparation de leur futur, et investissent (souvent dans leur pays d’origine) dans des biens immobiliers qu’elles louent. Ainsi, Iliana (3) dispose, à 26 ans, de quatre appartements à Kiev qu’elle loue et compte augmenter encore ce quota. Avant de prendre sa retraite à 35 ans, Ela avait acheté au cours de ses 13 années de pratique huit appartements à Varsovie et Cracovie, qu’elle loue elle aussi. Une estimation approximative de ses gains totaux sur 13 ans s’élève à 2,3 millions. Ceci est confirmé par une autre prostituée d’un club huppé de Zürich qui déclare gagner « plus de 120’000 francs par an ».
D’autres sont très clairement en dépendance face à des drogues plus ou moins dures. Si toutes nient y avoir recours, beaucoupd éclarent que leurs collègues sont accro à la cocaïne. Les personnes interrogées estiment ainsi qu’entre 70 et 90% d’entre elles fume, boit, et/ou utilise des drogues douces ou dures. Les sources d’approvisionnement varient entre certains clients et des fournisseurs extérieurs pour ces dernières. Le plus difficile à chiffrer est sans doute les conséquences psychologiques et sociales à long terme. L’ensemble des prostituées interrogées déclaraient être désocialisées au moins localement. Beaucoup n’avaient pour interlocuteurs que leurs collègues, souvent dans un contexte de concurrence commerciale, ou leurs clients auprès desquels elles doivent jouer un rôle permanent. La stigmatisation très forte associée à la prostitution risque d’inciter les rapatriées à cacher leurs souffrances. L’expérience du véritable apartheid qu’ont ainsi vécules les « femmes de réconfort » (prostituées forcées) coréennes des soldats japonais après la Seconde Guerre mondiale démontre que cette expérience est relativement universelle. L’ensemble des pratiquantes (immigrées ou non) déclare préserver une barrière stricte entre travail et vie sociale au pays, afin de réintégrer la norme et le cadre d’origine plus aisément. Le fait est que l’exercice de la profession laissera des traces: le « retour » est impossible en tant que tel. Une grande majorité d’entre elles déclare ainsi se défier des hommes auxquels elles ne font plus confiance. Beaucoup avouent avoir perdu certains repères, notamment quant à l’argent, à la valeur du travail face à l’argent facile de la prostitution, à ce que signifie avoir des enfants ou des projets à long terme.
Ce seront ces conséquences que les pays d’origine de ces travailleuses immigrées devront affronter à moyen terme. Le coût est difficile à chiffrer. En effet, les thérapies psychiques sont lourdes et coûteuses et leur efficacité très variable, notamment lorsque la personne sombre dans l’addiction ou bien la dépression. S’agissant de mères de famille actuelles ou futures, des dégâts sociaux considérables sont à envisager.
(1) Détail du calcul: entre 16000 (source: polices cantonales / Sonntag) et 25000 (source: Tampep) prostituées actives sur le territoire helvétique. Durée d’ouverture des maisons closes: 12h en moyenne. Prix moyen des passes (tous services confondus): 150 francs par tranche de trente minutes en moyenne, dont 60% revient aux prostituées. Durée de pratique mensuelle: 3 semaines en moyenne. Taux de rotation journalier des clients par prostituée: entre 12 et 18.
(2) Sur la base de 21 entretiens réalisés dans la région de Zurich et Genève entre 2008 et 2010, en clubs et maisons closes avec des pratiquantesl égales.
(3) Les noms et les lieux ont été mo-difiés.
LE CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL ANNUEL DE LA PROSTITUTION EN SUISSE PEUT ÊTRE ESTIMÉ ENTRE 3 ET 6 MILLIARDS DE FRANCS.
Réunis sous le titre Cachez ce travail que je ne saurais voir. Ethnographies du travail du sexe, dix articles issus d’un réçent colloque organisé par la Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS) et l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel viennent d’être publiés aux Editions Antipodes. L’ouvrage se penche sur le travail des métiers du sexe et rend compte des tâches qui le composent et des rapports sociaux qui le structurent.
Les études empiriques et ethnographiques réunies dans ce volume veulent enrichir les débats sur la prostitution et plus largement sur les activités économiques liées au sexe. Quelles que soient les (nombreuses) difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées, elles possèdent de véritables savoir-faire, qui sont le fruit d’un apprentissage non ou peu reconnu et sont le reflet de compétences acquises selon diverses modalités.
Comme pour tout autre travail rémunéré, il existe ainsi un marché structuré par des rapports de pouvoir qui bénéficie du travail de qui et sous quelles conditions. Les différentes formes du travail du sexe représentent ainsi un ensemble d’activités régies par des logiques collectives, comme le montre Lilian Mathieu dans une contribution d’ordre théorique: en considérant le travail du sexe comme un espace social à part entière, il devient possible de rendre compte des processus historiques d’inclusion, d’exclusion et de hiérarchie à l’oeuvre.
Par ailleurs, au-delà de l’activité sexuelle « en soi », le travail du sexe est le fruit d’autres activités méconnues. L’étude des tâches qui ponctuent les journées d’une prostituée pratiquant légalement son métier dans un salon en Suisse romande permet à Alice Sala d’affirmer que les principales activités d’une prosituée sont loin d’être sexuelles. Le téléphone portable et la messagerie sms s’avèrent être, en effet, des instruments centraux à la bonne économie de l’activité prostitutionnelle de salon. Il s’agit d’attirer de nouveaux clients, en se présentant comme sexy sans pour autant satisfaire d’emblée le client potentiel par téléphone ou par sms. Dans le même ordre d’idées, dans son étude sur les danseuses de cabaret, Romaric Thievent montre qu’il existe une autre série de compétences qui sont liées au travail du sexe qu’il dénomme les « compétences circulatoires ». Dans ce monde hautement transnational qu’est l’industrie des cabarets, les danseuses étudiées tentent de développer des stratégies de mobilité et des savoir-faire spécifiques dans le but de tirer un maximum de profit de leurs séjours en Suisse tout en minimisant les risques d’abus et d’exploitationt qui y sont liés.
Cyril Demaria, L’Agefi, 18 mai 2010
Loin des idées reçues, une étude scrute le quotidien des travailleurs du sexe
Dix chapitres issus d’un colloque qui s’est tenu à l’université de Neuchâtel en 2008 constituent une publication qui sort ces jours-ci.
Les métiers du sexe ne se réduisent pas à une passe. Loin des clichés, des chercheurs se sont penchés sur les réalités des personnes qui les exercent, en Suisse romande notamment. Le résultat de ces recherches vient d’être publié.
Sous le titre Cachez ce travail que je ne saurais voir. Ethnographie du travail du sexe, le livre regroupe dix articles issus d’un colloque tenu en 2008 à l’université de Neuchâtel (Unine). Le but était de voir à quoi ressemblent concrètement ces métiers, explique Alice Sala, auteure d’un des chapitres et collaboratrice à l’institut d’ethnologie de l’Unine.
L’ethnologue s’est immergée durant six mois dans le quotidien d’un salon de massage de Suisse romande. Une femme, pratiquant la prostitution légalement, seule et en indépendante, a été d’accord de l’engager comme téléphoniste et réceptionniste. Dans un salon, la présence d’une réceptionniste « augmente le standing », précise Alice Sala. « Accessoirement, c’est aussi le moyen de renforcer la sécurité. »
De son « poste d’observation privilégié », la chercheuse a constaté que la prostituée consacre une bonne partie de sa journée à gérer son carnet d’adresses, filtrer les appels, recruter de nouveaux clients et les fidéliser. Loin d’attendre passivement, la prostituée met en uvre des compétences de marketing et de relations publiques, relève l’ethnologue.
Sur environ neuf heures de travail, trois au maximum sont consacrées aux rapports sexuels, note la chercheuse. En dehors de ce temps, les clients fidèles bénéficient d’un « service à la clientèle » personnalisé, notamment par l’envoi de mots doux par sms, « un peu comme une maîtresse », explique la chercheuse.
Très sollicitée, la prostituée a appris à identifier les profils des personnes qui lui téléphonent. Elle repérera le timide qui prend rendez-vous mais ne vient pas, ou l’adepte du téléphone rose qui veut se satisfaire à bon compte.
« La prostitution est un choix par défaut », souligne Alice Sala. La femme dont elle a partagé le quotidien n’est pas forcée de se prostituer par un proxénète. « Mais elle n’a pas non plus choisi entre prostituée et avocate », illustre la chercheuse.
Femme au foyer avec une formation d’esthéticienne, divorcée, la trentaine, elle a cherché un métier qui lui permet de gagner assez pour nourrir ses enfants sans dépendre de l’aide sociale et en étant autonome. Selon Alice Sala, « sans rouler sur l’or, elle s’en sort financièrement ».
ATS, paru dans Le Courrier, 6 mai 2010
Alice Sala: « Une prostituée écoute, négocie et fait jouir »
Une chercheuse en anthropologie a travaillé six mois comme réceptionniste dans un salon de massage. Elle a étudié les compétences que développe une péripatéticienne.
Le travail d’une prostituée, c’est quoi? Dans la jungle des fantasmes, des a priori et des préjugés, Alice Sala, anthropologue, a tenté d’y voir clair. Pour cela, elle a travaillé six mois comme réceptionniste dans un salon de massage. Bien vite, elle a réalisé que le travail de péripatéticienne demandait beaucoup plus de subtilité que de se coucher et d’écarter les jambes. Le résultat de son travail, effectué dans le cadre d’une recherche à l’Université de Neuchâtel, vient d’être publié dans un livre qui regroupe dix articles se penchant sur le plus vieux métier du monde (lire encadré).
Selon votre étude, les relations sexuelles ne sont qu’une petite partie du travail de la prostituée. En quoi consistent les autres facettes du métier?
Il y a de nombreuses formes de prostitution et mon étude n’en concerne qu’une. Celle d’une femme pratiquant la prostitution légalement, seule et en indépendante dans un salon de massage. Ce que j’ai découvert, c’est que sur une journée de travail de 8 à 10 heures, trois heures au maximum sont consacrées aux rapports sexuels. Il y a au maximum 5 clients par jour, en général plutôt entre deux et quatre. Le reste du temps, la personne chez qui je travaillais utilisait son téléphone pour fidéliser ses clients et offrir un suivi aux clients fixes qui le souhaitaient.
C’est-à-dire?
Elle effectue la mise en scène d’une relation d’amour. Elle envoie des SMS, prend des nouvelles. Il faut être une très bonne actrice. Ce sont des rapports qui sont beaucoup basés sur la communication. Cette personne joue le rôle d’une maîtresse sans les contre-indications de la voir débarquer dans la vie des hommes. C’est un des aspects que la prostituée chez laquelle je travaillais préfère. Mais c’est aussi le plus fatigant, car c’est celui qui demande le plus d’engagement. Dans ces conditions, les hommes livrent leurs secrets et leurs faiblesses à une confidente et amie. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il y a de tout parmi les clients. Des jeunes, des vieux, des moches, des beaux, des célibataires, des hommes mariés.
Y a-t-il d’autres compétences que les prostituées développent?
Il faut pouvoir reconnaître le client potentiel parmi tous ceux qui appellent. Il y a les timides qui ne viendront pas, ceux que ça excite d’appeler une prostituée et qui recherchent du téléphone rose à bas coût. Il faut également des talents de négociatrice pour fixer un prix et le faire respecter.
Et en ce qui concerne le sexe?
Une prostituée doit connaître les hommes et leurs préférences. Il faut qu’elle identifie ce qui amènera le client le plus rapidement à l’orgasme, l’élément qui conclut la rencontre. Les clients ne restent jamais plus d’une demi-heure, mais il faut qu’ils aient l’impression d’être le centre de toutes les attentions. Elle doit faire croire qu’elle n’est pas pressée par le temps et que l’homme maîtrise la situation alors que c’est elle qui dicte le rythme.
Comment avez-vous réussi à vous faire engager comme réceptionniste dans un salon de massage?
J’ai téléphoné aux salons dont les numéros se trouvaient dans les journaux pour savoir si les personnes qui y travaillaient étaient d’accord de répondre à un questionnaire. Lorsque je me suis rendue auprès d’une prostituée qui était d’accord de participer, nous avons discuté durant des heures. Nous nous sommes tout de suite bien entendues et elle a accepté que je travaille pour elle. Avoir une réceptionniste augmente le standing d’un salon et évite de perdre des clients lorsque l’un d’eux appelle et qu’on est déjà occupée avec un autre.
Votre regard sur la prostitution a-t-il changé?
Oui. Une des plus grandes révélations a été que les prostituées ne sont pas des personnes si différentes que ça de nous. La première fois que je me suis rendue au salon et qu’une superbe blonde m’a ouvert, j’étais intimidée. Et puis j’ai vite réalisé que nous avions beaucoup plus de points communs que de différences.
Parlant de la femme chez qui vous avez travaillé, vous dites que la prostitution était un choix par défaut. Qu’est-ce à dire?
Il y a une partie des prostituées qui font cela sans être sous le contrôle d’un proxénète et sans être toxico- dépendante. Mais s’engager dans une activité stigmatisante n’est jamais un choix. Il y a des contraintes économiques, c’est une solution pour se sortir de situation de détresse. La prostituée dont je parle est une mère de famille divorcée qui fait cela pour nourrir ses enfants sans dépendre de l’aide sociale. Cela lui permet de s’en sortir sans rouler sur l’or.
Un mot pour décrire le monde de la prostitution?
C’est une vie dure. Pas forcément parce que les prostituées sont des victimes offertes aux fantasmes débridés des hommes, mais parce que c’est une activité stigmatisante dont on ne peut parler à personne. Il faut avoir une énorme confiance en soi pour supporter cette double vie qui est un des éléments les plus lourds de cette profession.
Ce que l’étude neuchâteloise a démontré
Malgré toutes les difficultés auxquelles les personnes qui se prostituent sont confrontées, elles possèdent de véritables savoir-faire. C’est ce qu’un colloque organisé par la Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS) et l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel a démontré. Les recherches viennent d’être publiées dans un ouvrage intitulé Cachez ce travail que je ne saurai voir. Ethnographies du travail du sexe. Une étude démontre comment les prostituées chinoises de Paris ont élaboré un système de justification qui leur permet de vendre leurs charmes sans pour autant se considérer comme des professionnelles du sexe.
Un autre volet est celui des émotions. Un travail montre comment les travestis brésiliens travaillant en Suisse parviennent à séparer investissements affectifs et activités économiques. A l’inverse, une autre recherche montre comment les prostituées des hôtels de Belo Horizonte, au Brésil, basculent dans des histoires d’amour cherchant à sortir de la prostitution grâce à une relation de couple stable. Conscients que leurs travaux ne changeront pas les rapports de pouvoir, les chercheurs espèrent que cela permettra de mettre en cause la vision schématique et manichéenne du travail du sexe.