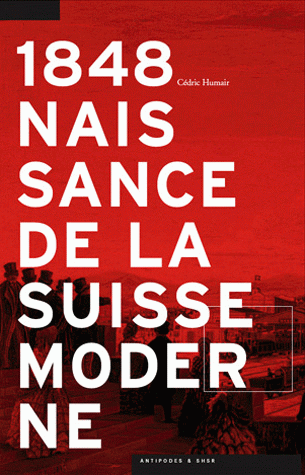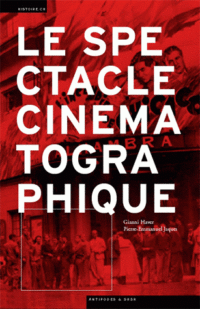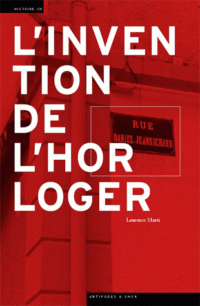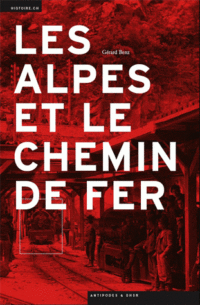1848. Naissance de la Suisse moderne
Humair, Cédric,
2009, 167 pages, 16 €, ISBN:978-2-88901-034-9
En 1847, la guerre civile du Sonderbund a déchiré la Suisse et menacé son existence politique. A l’instar de la guerre de Sécession, qui aura lieu une décennie plus tard aux Etats-Unis, ce conflit oppose deux blocs de cantons qui ne parviennent plus à concilier leurs intérêts au sein de la Confédération. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes du litige et pourquoi n’a-t-on pas réussi à le régler par le dialogue? De ce conflit a émergé la Suisse moderne. Sur quelles bases le nouvel Etat fédéral de 1848 a-t-il été établi? En quoi a-t-il joué un rôle fondamental dans le devenir de la Suisse?
Description
En 1847, la guerre civile du Sonderbund a déchiré la Suisse et menacé son existence politique. A l’instar de la guerre de Sécession, qui aura lieu une décennie plus tard aux Etats-Unis, ce conflit oppose deux blocs de cantons qui ne parviennent plus à concilier leurs intérêts au sein de la Confédération. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes du litige et pourquoi n’a-t-on pas réussi à le régler par le dialogue? De ce conflit a émergé la Suisse moderne. Sur quelles bases le nouvel Etat fédéral de 1848 a-t-il été établi? En quoi a-t-il joué un rôle fondamental dans le devenir de la Suisse?
Presse
Dans la Revue d’histoire du XIXe siècle
En Suisse, l’historiographie reste plutôt discrète sur une période qui a pourtant marquée très fortement l’histoire de l’émergence de la Suisse comme État-nation. La création en 1848 de la Confédération helvétique comme État moderne avait été précédée par une courte guerre civile, le conflit du Sonderbund, qui a opposé libéraux et conservateurs. La gestion de cette guerre, qui n’a pas abouti à l’écrasement des vaincus, a laissé des traces et contribué au conservatisme helvétique ultérieur. L’ouvrage de Cédric Humair est donc particulièrement bienvenu, même si sa taille ne lui permet pas de traiter de manière exhaustive tous les aspects qu’une solide monographie aurait permis de prendre en compte.
La perspective de l’auteur nous est annoncée d’emblée et se retrouve effectivement au fil des pages. Il s’agit d’abord d’examiner les différentes impulsions économiques, politiques, culturelles ou religieuses qui ont concouru à l’édification de cet État helvétique moderne. Pour ce faire, il est montré que les affrontements entre les deux camps, modernes et conservateurs, révèlent une complexité d’intérêts divergents et une myriade d’attitudes: ainsi des contradictions internes sont-elles mises à jour, aussi bien pour des conservateurs qui ressentaient le besoin d’une certaine modernisation économique du pays dont ils allaient pouvoir profiter eux aussi que pour des libéraux-radicaux qui ne voulaient pas aller trop loin et prenaient garde d’associer leurs adversaires aux réformes engagées. En réalité, c’est donc bien une multitude de conflits et d’intérêts divergents qui a traversé toutes les strates de la bourgeoisie suisse en fonction de ses secteurs d’activité économique dans une période d’apparente hégémonie politique du Parti radical.
L’auteur nous montre alors que la Suisse moderne a en quelque sorte été le produit d’une double ambivalence: celle d’une société nouvelle qui allait chercher son inspiration et ses principes fondamentaux dans le passé, avec par exemple une Constitution qui s’ouvrait à la démocratie, mais qui fondait en même temps la citoyenneté sur la commune d’origine; celle aussi d’une classe dirigeante qui a édifié en un temps record les structures centralisées dont l’économie avait besoin pour se développer, notamment en matière de monnaie commune, de transport et de communication, tout en prenant soin de bien limiter cette centralisation au strict nécessaire. Sur la scène internationale, cette même classe dirigeante a mené une politique de neutralité à géométrie variable et le pragmatisme avec lequel le régime radical a géré le dossier délicat de l’asile a permis à la Confédération helvétique de renouer petit à petit avec la plupart des grandes puissances européennes qui voyaient d’un très mauvais oeil ce régime qui était le seul à avoir débouché sur un changement durable en 1848. Ainsi, au-delà des discours patriotiques, cette Suisse radicale est parvenue à relier son économie à celles des autres nations européennes à la faveur de divers traités d’amitié et d’échanges. En quelques décennies, la classe dirigeante a ainsi assuré les conditions d’un décollage économique. Mais le régime politique qui s’est mis en place était tout sauf audacieux et les confrontations sociales plutôt fortes.
L’essai de Cédric Humair met donc en évidence les nécessités économiques qui inspirèrent à l’époque les démarches politiques du régime radical et des élites du pays. Il ne s’y enferme pas, mais il évite ainsi les écueils d’une approche seulement culturelle de l’affirmation de l’idée d’État-nation. Il donne ainsi à voir la création de l’État fédéral par ceux qui l’ont fait. Il se montre par contre plus discret sur les populations ouvrières, les marginaux, les troubles de subsistance ou les premières luttes syndicales. Il n’évoque par exemple ni les grèves des années 1860, ni les causes de la première loi fédérale sur les fabriques. S’il mentionne la création de la Société patriotique du Grütli, qui préfigure le Parti socialiste, il n’en raconte pas le rôle dans la longue genèse du mouvement ouvrier. Cependant, ce livre d’histoire ne porte pas sur l’ensemble du XIXe siècle. Il ne pouvait pas aborder tous ces aspects. Il se focalise en priorité sur les actions et les contradictions d’une classe dirigeante qui a à la fois déclenché et circonscrit la modernisation de la société helvétique. Ainsi ne nous impose-t-il pas une histoire édifiante et mythique, qui confonde les faits et les légendes pour nous faire apprécier la Suisse telle qu’elle est devenue.
L’analyse historique de la création de l’État fédéral moderne que développe Cédric Humair nous aide au contraire à éclairer les spécificités du régime issu de 1848 et les limites de son caractère progressiste. Il dresse le portrait d’une classe dirigeante et de ses initiatives qui se trouvent à l’origine de l’affirmation de la place financière et de la puissance économique de la Suisse du XXe siècle.
Charles Heimberg, Revue d’histoire du XIXe siècle, no. 45, 2/2012, pp.216-217
1849: l’envol de l’Etat fédéral
Avec l’unification des douanes, l’économie gagne en compétitivité
Si 1848 a marqué la naissance politique d’une Suisse moderne, 1849 et les années suivantes modifient en profondeur l’économie du pays. Dès les années 1840, la crise économique est bien présente avec notamment une industrie du coton qui connaît de très grandes difficultés. Pour l’historien Cédric Humair, « les élites de cette industrie de pointe sont convaincues de la nécessité de centraliser certaines compétences pour faire face à la concurrence ».
Avant 1848, comme le rappelait le penseur politique Alexis de Tocqueville, « il y a des cantons, il n’y a pas de Suisse ». Les barrières douanières cantonales empêchent la construction de chemins de fer et la conclusion de traités de commerce vitaux pour l’industrie d’exportation. Il règne une véritable anarchie au niveau de l’argent: de multiples monnaies cantonales et étrangères ont cours. Côté communications, de gros problèmes également.
« Il existe alors dix-sept systèmes différents, rappelle Cédric Humair, et il coûte plus cher d’envoyer une lettre de Genève à Romanshorn que de Romanshorn à Istanbul. La Suisse a aussi pris beaucoup de retard dans l’établissement d’un réseau de télégraphie électrique. Le télégraphe est bien présent à l’étranger dès les années 1830. Aucune véritable tentative de l’installer ici avant 1850. »
La victoire des radicaux en 1848 permet un transfert rapide des compétences des cantons à la Confédération, mais pas sans tensions politiques. Pour certains cantons, les douanes sont une ressource financière vitale, pour construire des routes, notamment. Pour les convaincre d’unifier, il faut donc les indemniser. Avec le nouvel Etat fédéral, le marché du travail se trouve amélioré par la liberté d’établissement, appliqué toutefois avec quelques restrictions.
Le franc l’emporte sur le florin
L’année 1850 voit la création d’une monnaie unique. Le franc et le système décimal l’emportent sur le florin et son système non décimal. La bataille a été âpre et la balance finit par pencher pour le franc grâce au milieu international du commerce installé à Bâle, à Genève et en partie à Zurich. Les cantons du sud du pays, le Tessin et le Valais, tiennent également pour le système décimal, qui est en vigueur dans le Piémont voisin. « Les partisans du florin allemand se trouvent en Suisse orientale; ils parlent de déclaration de guerre et tentent d’imposer un système monétaire mixte. En vain. »
Sur le plan de l’éducation, les catholiques refusent un système de formation produisant des élites laïques et libérales. Une Université fédérale est prévue à Zurich, une Ecole polytechnique en Suisse romande. Le projet capotera. « A l’époque, souligne Cédric Humair, Genève et les fédéralistes vaudois se tirent une balle dans le pied. » La seule école fédérale, le Polytechnicum, s’installe finalement à Zurich en 1855.
Routes et écoles resteront aussi dans le giron des cantons. Il en sera de même pour les chemins de fer qui ne deviendront fédéraux qu’en 1898. Car tous les cantons, désavantagés par le projet de réseau fédéral en croix, choisiront de privilégier les chemins de fer privés.
Dernier bastion démocratique
Quant aux relations internationales, la Suisse, afin de survivre et pour éviter une intervention internationale, adopte un profil bas. L’étouffement de toutes les révolutions européennes de 1848 fait en effet de la Suisse le dernier bastion démocratique et libéral.
Le conseiller fédéral vaudois Henri Druey se montre, pour sa part, favorable à la sortie de la neutralité. « En 1848, explique Cédric Humair, Druey est le fer de lance des radicaux de gauche qui souhaitent exporter la révolution suisse en aidant les Italiens à se libérer des Autrichiens. Il milite aussi pour que la Suisse gagne un accès à la mer afin de recevoir plus facilement l’aide de ses alliés britanniques et américains. »
Sous l’influence des milieux économiques, qui, à bien des égards, ont été les grands architectes de cette révolution, la Suisse campera néanmoins sur une très prudente neutralité.
Philippe Dumartheray, 24 Heures, 6 mai 2012
Dans la Revue historique vaudoise
La lecture de ce petit livre de l’excellente collection Histoire.ch est une vraie délectation. Dans la droite ligne de l’intelligent questionnement inauguré par la Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses (1982-1983), Cédric Humair montre avec force que l’État fédéral de 1848 est en large contradiction avec l’image traditionnelle de la Suisse présentée comme une Willensnation établie sur la seule base de la volonté politique de tous ses membres. Cet état fédéral nouveau est d’une part le résultat d’une guerre civile fratricide entre cantons, imposé par les armes à la partie conservatrice de la population; d’autre part il résulte d’un processus de longue durée « où s’entremêlent les dimensions économique, sociale, politique et culturelle ». L’auteur montre comment l’avènement de la nouvelle législation fédérale entre 1848 et 1857 (moment de stabilisation du nouvel état fédéral, après résolution de la crise de Neuchâtel) « a fortement contribué au processus d’industrialisation ». Il souligne par de nombreux exemples le caractère massif de la nouvelle intervention étatique: « marché unique, monnaie unique, libre circulation de la main-d’oeuvre, décloisonnement des systèmes de transport et de communication », soulignant que la Suisse a accompli alors « en une décennie ce que l’Europe n’avait pas achevé en un demi-siècle ».
Entre rupture et lente transformation, la Suisse issue de 1848 laisse cependant volontairement place à une importante dimension fédéraliste, permettant aux cantons de « bénéficier de réponses politiques
conformes à leurs intérêts économiques différenciés », une latitude à géométrie variable, puisque la possibilité de réviser partiellement la Constitution, introduite en 1891, laisse une marge de manoeuvre en faveur d’un renforcement de l’état central.
L’auteur souligne l’exceptionnelle longévité et stabilité du système né en 1848, qui a donné à la Suisse une image positive au plan international, favorisant l’afflux de capitaux étrangers. À tel point qu’à la fin du XIXe siècle, la Suisse compte au nombre des cinq pays les plus riches en terme de produit intérieur brut.
Il montre également que « le profil bas adopté par la politique extérieure suisse entre dans une stratégie de longue durée de la bourgeoisie suisse: accorder la priorité à la défense des intérêts économiques plutôt qu’au positionnement politique de la Confédération ». Il en voit pour preuve, en particulier, le développement d’un intense réseau consulaire à travers le monde.
Seul regret: la dimension sociale de cette construction de l’État confédéral nouveau est très marginalement abordée par l’auteur, qu’on serait heureux de voir aborder un jour cet aspect des choses.
Olivier Pavillon, Revue historique vaudoise, 119/2011, pp.337-338
Dans Traverse
Ab den 1830er-Jahren polarisierte die aufstrebende Regenerationsbewegung die verschiedenen Wirtschaftsregionen weiter bis schliesslich der Konflikt, der in den 1840er-Jahren wegen der Jesuitenfrage und dem Aargauer Klosterstreit konfessionell aufgeladen wurde, 1847 zum Bürgerkrieg und 1848 zur Gründung des schweizerischen Bundesstaats unter der Federführung des siegreichen, liberalen Lagers führte.
Schweizer Franken in Umlauf. Allerdings braucht es mehr als nur wirtschaftliche Kräfte, um einen Bürgerkrieg auszulösen. Weitere gesellschaftliche und kulturelle Aspekte müssten in Betracht gezogen werden. Unter den Zehntausenden, die das Heer der Eidgenossen im Sonderbundskrieg ausmachten, befanden sich wohl nur wenige Soldaten, die für den politischen und wirtschaftlichen Liberalismus ihr Leben aufs Spiel setzten. Das tägliche Brot und die Unterordnung in etablierte soziale Hierarchien bestimmten viel eher das Verhalten der Soldaten. Auch wenn Humair derartige Aspekte kaum aufgreift, füllt sein Fokus auf wirtschaftliche Fragen eine wichtige Lücke (auch in der deutschsprachigen Literatur).
Dans la Revue suisse d’histoire
Der Lausanner Historiker Cédric Humair, der mit seiner Dissertation über die schweizerische Zollpolitik von 1815 bis 1914 einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Schweiz vorgelegt hatte, gibt nun in einer kleinen Schrift eine prägnante Analyse der Entstehung des Bundesstaates von 1848. Als zeitliche Begrenzung hat Humair 1815 (Ende der napoleonischen Ära) und 1857 (Beilegung des Neuenburger Handels und Konsolidierung des Bundesstaates) gewählt. Er vertritt die Ansicht, dass die Schaffung des Bundesstaates nur in der Perspektive einer langfristigen Entwicklung richtig erfasst werden kann. ln einem ersten Teil geht Humair den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der Zeit von 1815 bis 1847 nach, wobei er insbesondere auf die zunehmenden Spannungen hinweist, die sich zwischen dem aufkommenden Wirtschaftsbürgertum und den traditionellen Eliten bildeten. Der zweite, an Umfang etwas grössere, Teil handelt vom Umschwung 1847/48 und von den ersten Massnahmen, die den neuen Bundesstaat festigten und die Leitplanken für die weitere Entwicklung vorgaben.
Humair erfasst in differenzierter Weise die wirtschaftliche Dynamik und die daraus hervorgehenden gesellschaftspolitischen Gruppierungen. So kommt beispielsweise der 1843 gegründete Schweizerische Gewerbsverein mit seinem « Monatblatt » häufig zur Sprache. Insgesamt ergibt sich ein interessantes Bild der neuen gesellschaftlichen und politischen Kräfte, die sich schliesslich im Bundesstaat zusammenfanden. Der konfliktreichen politischen Vorgeschichte der Bundesstaatsgründung wird ebenfalls gebührend Beachtung geschenkt. Didaktisch geschickt stellt Humair dann im zweiten Teil den Sonderbundskrieg, das neue politische System und den ersten Bundesrat vor. Er analysiert geschickt die politischen Kräfteverhältnisse und geht dabei auch auf die Defizite der demokratischen Ordnung ein, in der nicht nur die Juden diskriminiert und die Frauen ausgeschlossen waren, sondern auch schätzungsweise einem Sechstel der männlichen Bevölkerung als sozial Unterständige das Stimmrecht verweigert wurde.
Die ersten grossen Geschäfte des Bundes, die Schaffung des Schweizer Frankens, die Zollvereinheitlichung, die Eisenbahnpolitik sowie die Gründung der eidgenössischen Post und des Telegraphen werden genau analysiert und auf ihre Bedeutung für die künftige Entwicklung der Schweiz hinterfragt. Humair geht zu Recht eingehend auf diese Aspekte ein, so dass auch dem mit der Geschichte wenig vertrauten Leser die Errungenschaften des jungen Bundesstaates klar werden. Ein kurzer Blick auf die Verhandlungskultur der eidgenössischen Räte hätte diesem ansonsten reichen Kapitel möglicherweise noch den letzten Schliff gegeben.
Das zweitletzte Kapitel ist der Lage der Schweiz im internationalen Umfeld gewidmet. Neben den bekannten aussenpolitischen Konflikten mit den der neuen Schweiz feindlich gesinnten Nachbarn erläutert Humair auch eingehend die ersten Handels- und Freundschaftsverträge. Man hätte vielleicht auf die Verhandlungen, die zum Handelsvertrag mit Sardinien führten, etwas näher eingehen können – sie liefern nämlich ein gutes Beispiel, wie die privaten Interessen schon damals die Aussenbeziehungen dominierten.
Gewiss, es ist schon viel zur Geschichte der Bundesstaatsgründung geschrieben worden, und 1998, anlässlich des 150. Jubiläums, war erneut eine grosse Zahl von kleinen Studien vorgelegt worden. Doch Überblicksdarstellungen, die auf relativ wenig Seiten das Wesentliche nicht nur zusammenzufassen, sondern auch in erklärende Perspektiven zu stellen vermögen, sind immer noch selten. Cédric Humair hat hier eine Lücke gefüllt und der Vorgeschichte und den ersten Jahren des Bundesstaates eine treffende Darstellung gewidmet, wobei er mit gut ausgewählten Quellenzitaten eine grosse Nähe zum Geschehen schafft.
Hans Ulrich Jost, Revue suisse d’histoire vol. 60, 2010, N°3, pp.377-378
Dans Le cartable de Clio:
Depuis la Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses en 1982, peu de choses avaient été proposées en français sur les dynamiques du siècle qui a vu la naissance de la Suisse moderne. À contre-courant d’un récit lisse, cet ouvrage remarquable offre une relecture très fine de cette histoire mouvementée. Ce livre ne comble pas seulement un vide historiographique évident, son style accessible fera le bonheur des collégien·ne·s et enseignant·e·s qui sauront profiter des documents mis à disposition en annexe et faciles à utiliser en classe.
Articulé en deux temps, avant et après le tournant des années 1847-1848, l’ouvrage de Cédric Humair, historien à l’Université et à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, présente une histoire complexe de la mise en place de l’État fédéral. Point nodal, la guerre du Sonderbund, souvent banalisée par les manuels d’histoire, devient ici le centre d’une analyse aux multiples facettes.
Dans la première partie, l’auteur utilise la guerre civile de 1847 comme un prisme problématique: « Comment un tel conflit a failli déchirer la Suisse et menacer son existence politique? Quelles sont les causes du litige et pourquoi n’a-t-on pas réussi à le régler par le dialogue? » Afin de répondre à ces questions, Cédric Humair entrecroise avec brio les évolutions économiques, sociales, politiques ou encore religieuses et culturelles. La trame complexe qu’il dévoile nous offre une interprétation synthétique et d’une grande clarté.
L’historien précise l’usage polysémique de la notion de « bourgeoisie ». Sans la définir uniquement sous l’angle des droits politiques, l’auteur adopte une présentation sociale qui oppose les bourgeois aux élites accrochées au pouvoir, des « forces de mouvement » luttant contre les « forces de conservation ». Grâce à sa description minutieuse, le lecteur perçoit les dynamiques sociales et économiques qui laissent apparaître une nouvelle classe sociale très hétérogène qui s’enrichit et réclame une participation au pouvoir. Une histoire des idées complète le tableau des forces qui s’affrontent au milieu du XIXe siècle. À ce titre, nous avons beaucoup apprécié les pages consacrées aux différentes composantes de la famille libérale, à l’origine du « parti-État » radical.
L’État fédéral de 1848 émerge à la suite d’une guerre civile qui permet aux libéraux-radicaux un coup de force politique. Cédric Humair ne défend pas l’idée d’une révolution radicale. En effet, il n’y a pas de mouvement populaire soutenant la Constitution et son adoption par le peuple après son imposition par les élites libérales est pour le moins contradictoire. De plus, les « forces de conservation » ne sont pas étouffées totalement. Au contraire, elles continuent à jouer un rôle prépondérant au Conseil des États, deuxième Chambre de la nouvelle Assemblée fédérale. Cette lecture permet ainsi de s’extraire de la « version officielle radicale » qui décrit 1848 comme une victoire des « forces progressistes sur la réaction catholique ».
Dans la seconde partie de son ouvrage, l’auteur analyse les réalisations du nouvel État fédéral de 1848. Mobilisés pour favoriser les conditions-cadres du développement économique, la création du franc, l’unification douanière, le déploiement des postes et des chemins de fer sont réalisés en un temps record grâce à une intense coopération entre élites politiques et groupes économiques.
Pourtant, cette collaboration connaît quelques ratés: un projet innovateur de chemins de fer fédéraux échoue et l’option d’une université fédérale n’arrive pas à s’imposer, à l’exception de l’École polytechnique de Zurich. Les droits politiques (réservés uniquement aux hommes, en Suisse comme dans les autres pays de l’époque) de certaines catégories sont toujours restreints: les citoyens de confession juive sont mis au ban de la nation jusqu’en 1866, comme plusieurs franges flottantes de la population (vagabonds, ouvriers itinérants, pauvres).
Nonobstant ces écueils, la Suisse se situe à la pointe de l’ouverture démocratique. Si le « Printemps des peuples » éclate en 1848, les mouvements libéraux qui essaiment en Europe ne connaissent aucun succès dans l’immédiat. Si la Suisse radicale apparaît donc comme « révolutionnaire » et « république sur » de la jeune fédération américaine, c’est bien en contraste avec cette Europe encore sous le joug des monarchies.
« Navire amiral de la Suisse moderne », la mise en place de l’État fédéral en 1848 doit s’adapter au contexte exacerbé par les nationalismes et les impérialismes de la fin du XIXe siècle. L’auteur ne néglige pas la perspective internationale, clé de voûte d’une interprétation complexe de l’histoire nationale. Le rapprochement avec l’Allemagne et le profil bas adopté par la politique extérieure helvétique dessinent deux lignes de force de la Suisse moderne. En privilégiant l’expansion économique au lieu de la grande politique, la bourgeoisie poursuit en quelque sorte l’uvre des entrepreneurs du mercenariat: profiter du statut de neutre pour faire des affaires tous azimuts. Le résultat final dépassera toutes les attentes: vers 1900, la « petite » Suisse entre dans le club fermé des cinq pays les plus riches du monde.
Dominique Dirlewanger, Le cartable de Clio, 10, 2010
Dans les Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier
1848, enfin! En effet, cette période si intéressante de l’histoire helvétique et européenne reste peu étudiée dans l’historiographie francophone de la Suisse, C’est dire si l’ouvrage de Cédric Humair est bienvenu, même si sa taille ne lui permet pas de traiter complétement tous les aspects qu’une monographie plus exhaustive aurait pris en compte.
L’ouvrage est toutefois à la hauteur de ce qui est annoncé dans son introduction. Il intègre bien les différentes impulsions économiques, politiques, culturelles ou religieuses qui ont concouru à l’édification de l’État helvétique moderne. Il nous rend compte de la confrontation à cette époque d’un camp de la conservation et d’un camp du changement; mais aussi des contradictions internes à chacun des deux camps dans la mesure où il pouvait arriver à des conservateurs de ressentir le besoin d’une modernisation économique du pays pour leurs propres affaires; alors que dans le camp radical-libéral tout a été entrepris pour ménager les vaincus du Sonderbund et développer un fédéralisme qui laissait vraiment la part belle au conservatisme. En outre, d’autres conflits et d’autres divergences d’intérêts traversent les milieux bourgeois en fonction des différents mondes de production qui cohabitent dans l’espace helvétique.
La Suisse moderne est ainsi le produit d’une double ambivalence. Celle d’une part d’une société nouvelle qui va chercher son inspiration et ses principes fondamentaux dans le passé, avec par exemple une Constitution qui s’ouvre à la démocratie, mais qui fonde la citoyenneté sur la commune d’origine Celle d’autre part d’une classe dirigeante qui édifie en un temps record les structures centralisées dont l’économie a besoin pour se développer, notamment en matière de monnaie, de transport et de communication, tout en s’efforçant de limiter cette centralisation au strict nécessaire. Au plan international, une politique de neutralité à géométrie variable et le pragmatisme avec lequel le régime radical gère le dossier délicat de l’asile permettent à la Confédération de renouer petit à petit avec la plupart des grandes puissances européennes qui voyaient d’un très mauvais il ses avancées démocratiques. Ainsi, à la faveur de divers traités d’amitié et d’échanges, elle parvient à relier son économie à celles des autres nations. En quelques décennies, la bourgeoisie suisse parvient donc à assurer un décollage économique. Mais le régime politique qui se met en place est moins audacieux et les confrontations sociales sont plutôt fortes.
Dans un article polémique paru dans Le Temps du 9 janvier 2010, renforcé trois jours plus tard par une critique analogue d’Olivier Meuwly, Joëlle Kuntz s’en prend à cet ouvrage qui n’examinerait que le seul point de vue des élites bourgeoises en réduisant son analyse à la seule dimension économique de la période. Mettre en évidence les nécessités économiques qui inspirent une démarche politique n’est pourtant pas s’y enfermer. Quant à l’évocation de la bourgeoisie, ce petit essai montre en effet la création de l’Etat fédéral par ceux qui l’ont faite. Il ne dit donc pas grand-chose du peuple, des marginaux, des troubles de subsistance, des premiers syndicats ouvriers. Il n’évoque ni les grèves des années 1860, ni les causes de la première loi fédérale sur les fabriques. S’il mentionne la création de la Société patriotique du Grutli, il ne raconte pas le rôle de cette société ouvrière et patriotique dans l’émergence ultérieure du socialisme suisse. Mais ce livre d’histoire ne porte pas sur l’ensemble du XIXe siècle. II ne pouvait pas aborder tous ces aspects. C’est donc lui faire un procès d’intentions injustifié que de le lui reprocher. Il donne sunout à voir les actions et les contradictions d’une classe dirigeante qui a à la fois déclenché et circonscrit la modernisation de la société helvétique. Et au moins ne nous impose-t-il pas, comme l’auraient apparemment souhaité ses critiques, une histoire édifiante et mythique de cette période dans le seul but de nous faire apprécier la Suisse telle qu’elle est devenue.
L’analyse historique de la création de l’État fédéral moderne que développe Cédric Humair nous aide au contraire â éclairer les spécificités du régime issu de 1848 et les limites de son caractère progressiste. Il donne à voir les mécanismes par lesquels la classe dirigeante de ce petit État complexe a su concilier son conservatisme sociétal et son esprit d’initiative en matière économique, et les faire valoir comme des vertus cardinales au cur de la construction d’un sentiment national. Il nous permet aussi de mettre en perspective, et ainsi de mieux comprendre, l’histoire ultérieure du mouvement ouvrier en Suisse, et en particulier les limites de son affirmation autonome au plan culturel, ainsi que le poids de son intégration dans les rouages de l’État et de l’idéologie dominante.
Charles Heimberg, Cahiers de l’AEHMO, 26 (Justice sociale, justice de classe?), 2010, pp. 150-151
Cédric Humair: « 1848 contredit l’image que l’on a voulu donner de la Suisse »
Au XIXe siècle, la Suisse moderne se crée grâce à une dynamique d’élites et à une politique d’apaisement.
Enseignant à l’Université de Lausanne, l’historien Cédric Humair décrypte les logiques qui sous-tendent la création de l’Etat fédéral. Auteur d’un passionnant ouvrage de vulgarisation sur le sujet (1848, Naissance de la Suisse moderne, Ed. Antipodes, 2009), il revient sur les idées fortes de son travail.
Comment la Suisse s’est-elle inventée une fête nationale?
A la fin du XIXe siècle, on récupère un pacte de 1291, découvert vers 1760, pour en faire le texte fondateur de la Confédération. Avec le 600e anniversaire de celle-ci en 1891, les autorités imaginent une commémoration à titre unique.
Pourquoi?
Avec cette fête nationale, on copie les pays qui nous entourent. C’est intéressant, car le Conseil fédéral réagit à la pression des Suisses de l’étranger qui réclament d’avoir l’équivalent d’un 14 Juillet ou de la Fête du Kaiser. Au final, le 1er Août s’instaure seulement de façon régulière dès 1899.
Ce n’était qu’une fête pour les Suisses de l’étranger?
Non, bien entendu. En 1891, la Suisse se trouve en pleine crise d’identité nationale et elle sort d’une période de marasme économique. Le manque de cohésion nationale est flagrant. De plus, le mouvement ouvrier se structure, des grèves ont lieu. Avec l’invention du 1er Août, les élites jouent sur la fibre nationaliste pour rassembler la population.
N’est-ce pas paradoxal de renvoyer à 1291, alors que la Suisse moderne se forge en 1848…
Les mythes historiques sont là pour donner du sens à la communauté. A cet égard, 1848 est peu utilisable à l’échelle nationale du fait que l’on met en scène une guerre civile. Pour en faire un événement qui réunit, qui donne sens à la nationalité, ce n’est pas envisageable… 1848 est plutôt le mythe fondateur des radicaux.
D’où le désintérêt des historiens à propos de la création de l’Etat fédéral en 1848?
A nouveau, il faut tenir compte du problème de la signification de 1848. D’autant que la Suisse s’est construite sur cette idée de consensus qui est devenue si prégnante au cours du XXe siècle. 1848 contredit l’image que l’on a construite et donnée de la Suisse. Autant pour ses habitants que pour ceux qui nous regardaient de l’extérieur. Mais, certes, l’historiographie sur le sujet reste lacunaire, peu critique et focalisée sur une histoire politique et constitutionnelle.
Ce que vous critiquez…
L’aspect économique a été négligé. Or, il faut mettre en relation les strates religieuses, culturelles, politiques, sociales et économiques pour comprendre l’événement.
A quoi songez-vous?
Il est étonnant de voir que des questions aussi cruciales que la création d’une monnaie unique, notre franc, ne font pas encore l’objet d’un ouvrage de synthèse.
Dans ce cas-ci, quelle est votre lecture de 1848?
Il y a deux éléments primordiaux. D’abord, la création d’un réel Etat central avec transfert de compétences cantonales vers la Confédération. Ici, la dimension économique joue à plein. On crée un marché commun où les marchandises circulent sans entrave. Suit la création du franc, même si d’autres monnaies étrangères continuent à être utilisées. Enfin, d’importantes infrastructures propices au développement capitaliste du pays sont instaurées. Les réseaux de chemins de fer et de télégraphes prennent ainsi leur essor. Ce qui se passe entre 1848 et 1855 est comparable à ce que l’Union européenne a réalisé sur plusieurs décennies.
Et le second élément?
Politiquement, c’est l’instauration d’un Etat libéral et démocratique tel qu’on le connaît aujourd’hui, basé sur un Conseil fédéral, un Parlement avec deux Chambres et le Tribunal fédéral. Des institutions complétées par des articles octroyant de nouveaux droits et libertés aux citoyens. Ceux-ci peuvent désormais s’établir dans d’autres cantons. Avant 1848, chaque canton fonctionnait comme un petit Etat et traitait les autres Suisses comme des étrangers. C’est la naissance d’une véritable nation suisse.
Comment expliquer la vitesse de toutes ces réformes après une phase de guerre civile?
Cela ne se fait pas sans problèmes et des tensions surgissent, comme à Fribourg ou à Lucerne où on impose un pouvoir radical par la force. Des tensions qui sont réactivées avec le Kulturkampf dans les années 1870. En dépit de la permanence des divisions entre cantons libéraux radicaux et conservateurs, on peut dire que la gestion de l’aprèsconflit du Sonderbund par les vainqueurs permet d’éviter une guérilla ou une opposition frontale des conservateurs dans la durée.
Pouvez-vous préciser?
D’abord, on limite la centralisation pour ne pas heurter les convictions fédéralistes des catholiques conservateurs. Les routes ou les écoles restent aux cantons. Ensuite, des gestes d’apaisement sont faits vers les vaincus. Par exemple, on remet une partie de la dette de guerre afin de soulager les finances des cantons défaits. Le général Dufour est emblématique de cette politique d’apaisement. Dès le conflit, il donne des ordres aux troupes fédérales de respecter la population des cantons adverses. Pour éviter de susciter la haine.
La population, on l’entend peu dans vos mots. Faites-vous un récit des élites?
Il faut se replacer dans la Suisse de cette époque. Les partis politiques de masse organisés à l’échelle nationale n’existent pas. Par contre, il y a des réseaux d’élites qui développent des dynamiques socioéconomiques autour d’un lieu fort: les associations qui émergent dans la première partie du XIXe siècle. Les grandes fêtes nationales de chant ou de tir servent à mobiliser une population plus large, mais qui reste relativement aisée. Les moyens de transport sont encore chers et moins de 10% de la population a accès à la mobilité de loisir. Clairement, le moteur politique qui conduit à 1848 tient de la dynamique d’élites, même si les protagonistes cherchent à mobiliser la population.
Quel exemple illustrerait le mieux le bouleversement de 1848 et les logiques que vous décrivez?
Peut-être la création, en 1855, de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).
C’est-à-dire?
Des années durant, un intense débat sur la formation supérieure a lieu. A l’origine, on pensait au consensus suivant: attribuer la capitale politique à Berne, fonder une université fédérale à Zurich et une école polytechnique en Suisse romande. La dernière réforme relève d’enjeux économiques importants. Avec l’industrialisation et l’installation de réseaux techniques, il y a nécessité d’implanter enfin une formation d’ingénieurs en Suisse. Le schéma est toutefois brouillé par une coalition de fédéralistes romands et de catholiques conservateurs qui refusent la centralisation. Ces élites ne veulent pas être fondues dans un moule national alémanique et libéral radical. L’université fédérale passe à la trappe, ne reste que les universités cantonales et l’Ecole polytechnique fédérale qui sera implantée à Zurich.
Propos recueillis par Yves Steiner, L’Hebdo, 28 juillet 2010
Dans la Revue suisse de sciences politiques
« Des provinces indépendantes ou à peine fédérées, ayant des intérêts, des lois, des gouvernements, des tarifs douaniers différents, ont été rassemblées, pêle-mêle, et fondues en une seule nation, sous un seul gouvernement, sous une seule loi, avec un seul intérêt national de classe derrière un seul cordon douanier ».
Est-ce un hasard si ces lignes du Manifeste communiste et la création d’un Etat centralisé en Suisse datent de la même année? Marx et Engels ne décrivent-ils pas, en quelques mots, le processus historique qu’ont connu les cantons suisses dans la première moitié du 19e siècle? C’est l’approche qu’explore un ouvrage sur les origines de l’Etat suisse et sur sa création en 1848, paru aux éditions Antipodes. Ecrit par Cédric Humair (Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne), c’est une parution bienvenue pour quiconque s’intéresse au système politique suisse, tout d’abord parce qu’elle comble un vide de la littérature, que l’auteur relève lui-même, et ensuit parce qu’elle permet de répondre à quelques questions importantes quant aux origines de l’Etat fédéral. Les événements de 1848 ont principalement été étudiés lors des différentes commémorations, en 1948 et 1998 par exemple, mais n’ont guère fait l’objet d’études synthétiques. Humair se propose donc, dans ce petit ouvrage, de reprendre et de résumer les éléments déjà disponibles dans la littérature historiographique sur ces événements, d’établir une périodisation permettant de mieux comprendre le « moment 1848 », et de donner quelques clefs de lecture novatrices quant à la création et au développement subséquent de l’Etat central en Suisse.
Humair, c’est là son premier mérite, replace 1848 dans une période qui va de 1815, chute de l’Helvétique et rétablissement approximatif de l’Ancien Régime, à 1857, résolution de « l’Affaire de Neuchâtel » et stabilisation de l’Etat fédéral. Cette périodisation élargie permet évidemment de comprendre la création de ce dernier dans une perspective plus large, et tout particulièrement en lien avec les mutations économiques fondamentales que connaît la Suisse (comme la plupart des pays européens) dans la première moitié du 19e siècle: passage de la propriété de la terre des mains des élites à celles des agriculteurs, forte augmentation du trafic des marchandises et des personnes, extension des activités industrielles (pp.36-37). Les années qui suivent la ratification de la Constitution fédérale permettent quant à elles de montrer l’établissement progressif (et parfois conflictuel) de cet appareil d’Etat centralisé que les élites économiques appelaient de leurs vux depuis plusieurs décennies, à la fois pour garantir des conditions-cadres favorables au développement de l’économie et pour défendre leurs intérêts sur le plan international.
Le cadre d’analyse fondamental du livre est la division du territoire suisse en plusieurs « mondes de production », que Humair a déjà analysés dans des travaux antérieurs. Ils sont au nombre de quatre (p.15): la Suisse occidentale marchande (marchands et banquiers de Genève, Neuchâtel et Bâle, spécialisés dans l’import-export et tournés vers l’étranger), la Suisse agricole (des propriétaires terriens produisant pour le marché intérieur ou l’exportation, situés pour la plupart en Suisse centrale et méridionale), la région zurichoise (de grandes industries dont la production est destinée au marché intérieur) et la Suisse orientale industrielle (une industrie tournée vers l’exportation). Ces quatre mondes seront en conflit ou trouveront des intérêts communs durant tout le 19e siècle, la grande division portant sur la nécessité de créer un Etat centralisé à même de garantir un marché intérieur unifié, d’établir un cordon douanier unique, de défendre les intérêts de la place économique à l’étranger, d’assurer l’approvisionnement énergétique (notamment en charbon) et de construire les infrastructures nécessaires au développement de l’économie (à commencer par les chemins de fer et les postes). L’histoire suisse du 19e siècle est alors réinterprétée à la lumière de ces divisions, qui expliquent à la fois la défense sourcilleuse de l’autonomie cantonale par les régions de Suisse centrale, soucieuses de conserver les lucratifs péages établis sur les routes traversant les Alpes et inquiètes d’éventuelles mesures protectionnistes qui mettraient en danger leurs exportations, et les appels à l’unité nationale de la part des grands industriels zurichois, souhaitant voir l’apparition d’un véritable marché intérieur unifié sur lequel ils puissent s’appuyer pour mettre leurs entreprises à l’abri de l’instabilité chronique de la structure politique créée par le Pacte de 1815. En ce sens, la guerre du Sonderbund de 1847 n’est pas lue comme la dernière guerre de religion qui ensanglante le territoire suisse, mais bien davantage comme l’expression d’intérêts économiques divergents, voire de l’opposition de deux modèles distincts de production (comparable en cela au processus qui a conduit à la Guerre de Sécession aux Etats-Unis). L’habillage idéologique qui entoure les positions des uns et des autres passe dès lors au second plan, même s’il a des effets incontestables. Humair en rappelle d’ailleurs quelques éléments importants comme l’établissement d’un système politique garantissant un suffrage masculin presque universel (unique en Europe) et le respect des principales libertés individuelles. L’auteur signale également que, après les échecs des révolutions de 1848 partout ailleurs en Europe, la Suisse est pendant plusieurs années une exception politique continentale, qui ne doit sa survie qu’à une fréquente intervention diplomatique anglaise visant à dissuader la France, la Prusse ou l’Autriche, selon les circonstances, d’intervenir contre la Suisse (la Grande-Bretagne étant soucieuse de maintenir l’équilibre des forces entre les puissances continentales tel qu’il a été arrêté au Congrès de Vienne).
Ce livre est précieux pour plusieurs raisons. Il convie tout d’abord à une lecture économique des faits historiques, suffisamment rare dans l’historiographie suisse pour être saluée et tout à fait éclairante s’agissant de la période considérée. Cette lecture permet en même temps de s’extraire de la pesante histoire officielle « radicale », présentant 1848 et la Constitution fédérale comme une victoire des forces « progressistes » sur la « réaction » catholique et féodale. Humair permet d’interpréter ce conflit de manière plus fine et, sans doute, plus conforme aux rapports de force de l’époque. Ensuite, Humair replace ce moment de « l’histoire suisse » dans l’histoire européenne, en rappelant notamment que, à quelques reprises, il s’en est fallu de peu que les puissances voisines ne mettent fin à cette incongruité politique que représentait alors la Suisse. Enfin, 1848. Naissance de la Suisse moderne établit une fois de plus que la Suisse, comme entité politique pertinente, n’existe pas avant cette date, et offre ainsi une contradiction bienvenue aux réécritures nationalistes de l’histoire suisse faisant remonter les origines du pays à 1648, 1498, 1315 ou 1291, quand il ne s’agit pas des Helvètes et de Divico! De ce point de vue, et Humair le souligne, 1848, tout en représentant une continuité par rapport aux structures économiques qui se mettent en place dès le début du siècle, marque aussi une rupture, matérialisée par la création d’un appareil d’Etat jusqu’alors inexistant (cf. p.131).
1848. Naissance de la Suisse moderne n’étant qu’une introduction au problème, il serait oiseux de lui opposer des oublis ou des éléments insuffisamment développés. À cet égard, signalons simplement que la constitution d’une identité nationale est assez largement laissée de côté (pas totalement toutefois, cf. pp.52-56), le même traitement étant réservé au contexte idéologique en général. Humair, en bon « réaliste », considère que les idées viennent pour l’essentiel justifier, sinon camoufler, des positions matérielles. Le lecteur intéressé par ces aspects pourra cependant se tourner vers d’autres ouvrages, et la prise en compte du nationalisme suisse aurait de toute manière nécessité une périodisation différente. Une critique peut-être plus pertinente pourrait cependant être opposée à Humair. Il semble que sa soigneuse description des différents « mondes » de l’économie suisse laisse en quelques rares endroits la place à une entité cohérente qui prend alternativement le nom « d’ élites » et de « bourgeoisie ». L’analyse fine de ces quatre « mondes » et de leurs conflits laisse alors la place à une mécanique un peu sommaire, dans laquelle le nouvel Etat central répond aux « besoins » de cette bourgeoisie, suit ses « stratégies » et en est « l’ instrument ». Le mérite du livre avait été de montrer que, précisément, il y a d’importantes dissensions au sein de ces élites, qui doivent d’ailleurs périodiquement s’appuyer sur les populations pour faire passer leurs politiques. Mieux vaut donc conclure en disant que la création de la Suisse moderne a été le résultat (en partie contingent comme Humair le montre aussi) de forces divergentes et que sa construction baroque est dans une large mesure le produit de ces divergences. Pour celles et ceux qui travaillent sur la politique suisse, qu’il s’agisse de ses institutions ou de sa sociologie, le livre de Humair apportera sans doute quantité d’informations intéressantes. Il fait notamment apparaître la grande continuité de ce système politique tout au long des 160 ans de son existence, et donc l’intérêt d’étudier ses débuts pour pouvoir en comprendre le fonctionnement actuel. Ainsi, pour rendre compte de certaines de ses articulations, ainsi que de certaines de ses singularités, il n’est pas inutile de se replonger dans les années qui ont entouré 1848 et l’adoption de la première constitution fédérale. Les spécialistes savent que les caractéristiques d’un moment constituant révèlent toujours quelque chose du fonctionnement normal de la constitution qui y est créée; 1848. Naissance de la Suisse moderne en apporte une preuve de plus.
L’Etat du deal permanent
Un livre raconte l’émergence d’une Suisse moderne en 1848. Les libéraux-radicaux défendaient alors leurs intérêts en mobilisant l’Etat. Captivant.
Les origines de la Confédération autrement. C’est ce que propose l’historien Cédric Humair, chargé de cours à l’Université de Lausanne, dans un ouvrage qui sort en librairie ces jours-ci. Un essai de vulgarisation qui évite les mythes colportés dans l’historiographie sur 1848, date de la création de l’Etat fédéral.
Non, le conflit du Sonderbund n’a pas été un conflit religieux, mais une lutte entre une Suisse du dynamisme économique, celle des libéraux-radicaux, et une Suisse de la vieille aristocratie arc-boutée sur le pouvoir de l’Eglise. La première vaincra, mais n’étouffera pas la seconde comme le montre la création du si conservateur Conseil des Etats au Parlement. Isolée dans une Europe réactionnaire, cette Suisse libérale illustre la mobilisation massive de l’Etat au service de l’économie. Pour créer le franc, unifier les douanes, bâtir un réseau postal. Tout cela, en un temps record. Mais aussi au prix de tractations constantes au sein des élites bourgeoises et de leurs représentants au sein du Conseil fédéral.
Yves Steiner, L’Hebdo, 10 décembre 2009
Sur Arcinfo.ch
Que 1848 marque la naissance de la Suisse moderne n’est contesté par presque personne. Reste à comprendre l’événement. Enfant de Saint-Imier, l’historien Cédric Humair, tente, dans un ouvrage tout récemment paru -précisément intitulé « 1848, naissance de la Suisse moderne »- la synthèse entre les dimensions politique, économique, sociale et culturelle de la création de l’Etat fédéral, tel qu’on le connaît encore aujourd’hui. Une démarche qui va, selon lui, à l’encontre d’une tendance « à segmenter les approches, qui limite la compréhension ».
« Longtemps, l’historiographie a montré la guerre du Sonderbund (réd: la guerre civile de 1847 d’où à émergé la Suisse moderne) comme un conflit religieux. D’autres se sont uniquement focalisés sur l’avènement de la bourgeoisie ou l’opposition entre libéralisme et conservatisme », explique Cédric Humair. Ses propres travaux, notamment sa thèse, publiée en 2004, ont permis de poser un regard neuf sur la question. Et mis en exergue sa dimension économique:
« Sans l’Etat fédéral, le processus de développement économique aurait été freiné », affirme-t-il. A l’instar de celui des chemins de fer: « Comment imaginer les énormes investissements consentis dans un climat d’instabilité politique, voire de guerre civile larvée? Ou avec les carcans que représentaient les frontières cantonales? Ou des Etats incapables de se mettre d’accord sur les tracés? » C’est l’Etat fédéral de 1848 qui a donné des conditions-cadres à cet épanouissement.
Socialement, c’est la bourgeoisie qui pousse à la création de l’Etat libéral. Les « Bundesbarone », comme les appellent les historiens, qui « concentrent énormément de pouvoirs entre leurs mains. Ils sont engagés en politique, mais aussi dans les domaines économique et militaire », relève l’historien de Saint-Imier. Conséquence: une stabilité politique sur le long terme. Donc, des conditions très favorables à l’épanouissement de l’industrie et du système bancaire. Et c’est essentiellement grâce à sa force économique que la Suisse moderne, loin d’être une grande puissance en 1848, se renforce progressivement dans le concert international.
Pour Cédric Humair, la compréhension de 1848 peut apporter des clés de lecture à la situation actuelle: « Dans les deux cas, le contexte politique et économique a évolué très rapidement. Mais les institutions, elles, n’ont pas suivi le rythme. Résultat, leur capacité à résoudre les problèmes de la société devient problématique. On ressent alors le besoin de faire évoluer ces institutions. »
Mais comment? « Moins on tient compte de ces évolutions, plus le risque s’accroît d’arriver à des situations où les choses deviennent radicales et violentes. » En 1847, il a fallu une guerre civile pour qu’on en arrive à redéfinir un régime plus en phase avec le contexte. Et au début du XXIe siècle? « La flexibilité du système introduit en 1848 a longtemps fait merveille. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il s’est rigidifié et manque de capacité d’adaptation. Le danger qui nous guette: devoir agir sous la contrainte extérieure. »
SDX, arcinfo.ch , 10.12.2009
La Suisse de 1848, sans vous et sans moi
Il y a peu d’ouvrages sur la création de la Suisse moderne en 1848. Tout se passe comme si ce moment restait mal aimé. La première Constitution est certes un objet de révérence. Mais si les années de passage entre un régime de cantons souverains et un régime fédéral sont présentes dans la mémoire publique, elles ne suscitent pas la curiosité d’où surgiraient les questionnements et réexamens. La division culturelle du pays y est peut-être pour quelque chose. Il est possible aussi que l’identification à un canton fasse encore obstacle à l’émergence d’une passion historienne pour le national. On ne peut exclure que le cantonalisme dont voulaient se débarrasser les radicaux de 1848 se soit vengé en snobant par le silence la mémoire du mouvement de centralisation.
Toujours est-il que l’absence de travail documentaire, intellectuel, politique sur 1848 pèse sur les débats d’aujourd’hui. En période de crise, quand la démocratie directe a des tendances au dérapage, quand le Parlement semble hésiter sur ses prérogatives et le Conseil fédéral sur son rôle, il serait utile de pouvoir réinterpréter l’esprit des institutions en sachant mieux ce que les fondateurs ont voulu faire, pourquoi et comment ils l’ont fait.
Dans cet état de manque, la publication par les Editions Antipodes du livre de Cédric Humair 1848, Naissance de la Suisse moderne est donc une initiative heureuse. L’historien, chargé d’enseignement à l’Université de Lausanne et à l’EPFL, reprend la description des deux événements de la Suisse du XIXe siècle, la guerre civile puis la mise en place de l’Etat fédéral.
En spécialiste de l’industrialisation suisse, Cédric Humair mesure tout le poids des fabriques et des banques dans la modernisation du pays. Il a certes une tendance à tirer la couverture à lui : tout pour l’électricité, rien que par l’électricité. Mais l’aspect discutable de son livre est ailleurs: les seuls acteurs qu’il pose sur la scène de 1848 sont « les élites », « les classes dirigeantes », « la bourgeoisie », toutes occupées à donner à la Suisse les « conditions-cadres » les plus aptes à servir leurs intérêts. Un « monde de production » nouveau, celui de l’industrie et de la finance, supplante à ce moment-là les « mondes de production » plus anciens, agriculture, négoce, artisanat, occupant entièrement le champ économique, politique et culturel, notamment par sa maîtrise de l’édition et de la communication. Ce « monde de production » a des besoins que l’ancien n’avait pas. Ses bénéficiaires les satisfont avec la nouvelle Constitution. Le tour est joué.
L’auteur admire jusque dans sa conclusion le génie politique qu’il prête aux classes dirigeantes: « La forte composante fédéraliste du nouvel Etat est le résultat d’une stratégie délibérément poursuivie par la bourgeoisie suisse : laisser un maximum de compétence aux cantons afin que les différents mondes de production puissent bénéficier de réponses politiques conformes à leurs intérêts différenciés. La centralisation est ainsi limitée aux domaines de compétence jugés indispensables par les élites au pouvoir. »
Il n’est pas absurde de rappeler que la démocratie parlementaire a été inventée par la classe bourgeoise. Le répéter de façon aussi dogmatique dans un livre d’aujourd’hui a un effet: si les lecteurs ne se reconnaissent pas d’appartenance à cette « bourgeoisie », l’affaire de 1848 n’est plus la leur, les circonstances de la création de la Suisse moderne ne les concernent pas. Si, par contre, ils en ont contre cette « bourgeoisie », le livre de Humair justifie leur mépris de la démocratie parlementaire créée par elle et pour elle.
La gauche suisse n’est vraiment chez elle dans l’histoire nationale qu’à partir de la toute fin du XIXe siècle et surtout depuis la grève de 1918. Elle n’a pas, contrairement à la France ou à l’Italie, de repères communs fondateurs de caractère national avant le tournant du siècle. Mais si, comme on pourrait le croire en lisant Humair, ce grand moment de liberté et de reconnaissance des droits de l’individu représenté par 1848 ne lui appartient pas à elle aussi; si, derrière chacun des sept radicaux élus au Conseil fédéral en décembre 1848, il manque la part jouée par le peuple citoyen, la société, les artistes, les savants, les individus suisses autonomes, la pensée historique de gauche ne pourra pas se renouveler. Sans ce renouvellement, elle perdra et son énergie et sa place.
Vues par Humair, les idées de 1848 sont des « idéologies », les projets d’organisation du pays des « structures », les groupes humains des bataillons au service de la bourgeoisie ou de la main-d’uvre bon marché exploitée par elle. La machine tourne dans ses conditions-cadres. Elle n’a pas besoin de vos ancêtres ni des miens. Dommage pour vous et pour moi.
L’Etat de 1848 réduit à un instrument de l’hégémonie bourgeoise
Olivier Meuwly, historien, n’adhère pas à la thèse d’un ouvrage récent selon laquelle les élites ont créé l’Etat fédéral pour servir leurs intérêts économiques et insiste sur l’autonomie du politique
Le libéralisme économique n’a-t-il vraiment pas besoin de l’Etat pour se développer? Celui-ci n’est-il qu’un mal nécessaire qu’il s’agit de convoquer seulement lorsque quelques rouages se grippent? Et inversement, l’Etat n’est-il que le jouet des élites libérales, l’instrument de leur hégémonie?
Ces questions sont particulièrement actuelles mais elles hantent notre histoire nationale au moins depuis la fondation de la Suisse moderne, en 1848. C’est le mérite de l’ouvrage publié par Cédric Humair que de le rappeler, en replaçant ces questionnements dans leur perspective historique. Son étude se concentre ainsi sur le problème de l’autonomie du politique par rapport aux intérêts économiques et de la prédominance éventuelle de ces derniers.
La thèse que défend l’auteur est limpide: la naissance de l’Etat fédéral obéit clairement aux intérêts économiques de la bourgeoisie libérale-radicale, malgré les avancées sensibles qu’offre la Constitution de 1848 tant sur le plan démocratique que sur celui de l’efficacité et de la stabilité institutionnelle de l’Etat central. Le processus législatif destiné à mettre en uvre les principes constitutionnels devait en définitive permettre à l’Etat de faciliter l’encadrement d’une économie qui attendait ce coup de pouce pour achever son déploiement.
Tout en reconnaissant les multiples dimensions du libéralisme suisse qui a présidé, surtout dans sa dimension radicale, aux opérations de réforme de la structure politique suisse, l’historien lausannois en vient ainsi à nier une authentique autonomie du politique. Il préfère subordonner les choix des responsables politiques à leurs intérêts économiques, omniprésents. Même l’idéal patriotique n’apparaît que comme le paravent d’une réflexion en quête de compromis économiques entre les différentes régions du pays, et se voit dépossédé de toute valeur propre.
Cette approche n’est-elle qu’un reflet du conflit classique entre une doxa libérale nimbée d’individualisme et une vulgate marxiste obsédée par le déterminisme économique? Entre un libéralisme enclin à préserver le potentiel d’action de l’individu contre les contraintes économiques pures et un marxisme prompt à privilégier les objectifs économiques, au détriment d’autres intérêts, moins matériels?
En réalité, cet antagonisme, classique, dévoile les contradictions qui obèrent les deux visions de la société rappelées ci-dessus. En se plongeant dans la construction de l’Etat fédéral moderne, le libéral découvrira que l’Etat a toujours été important pour ses visées économiques, comme organisateur d’un cadre général qui ne pourra fonctionner que sous une autorité d’ordre politique. L’Etat n’est donc pas seulement un gêneur qui opprime la liberté d’entreprendre, mais contribue aussi à son plein développement. Les perspectives que peuvent ouvrir, dans certains cas, les fameux partenariats public/privé font d’eux les héritiers de l’association capitalisme-Etat qui a pu s’honorer de plusieurs succès au XIXe siècle.
Symétriquement, le marxiste se heurte à une économie dont il ne cesse de déplorer les dérives capitalistes, mais qu’il ne peut s’empêcher de fixer comme moteur unique de la vie sociale. L’intérêt économique apparaît dès lors comme l’objectif cardinal, seul à même d’aimanter l’action humaine. Mais si cette réalité vaut pour les élites bourgeoises, qui ne dit qu’elle n’aspire pas également les énergies des autres classes sociales? De fait, le révisionnisme socialiste de la fin du XIXe siècle avait bien dû constater que les travailleurs, loin de se passionner pour la lutte des classes, ambitionnaient surtout d’améliorer leur propre situation économique
On ne peut nier que la science historique a en effet trop longtemps négligé la logique économique dans des décisions trop hâtivement attribuées à des motifs strictement politiques. Mais l’histoire, et l’actualité qui en découle, ne se meut pas selon un plan unique, qu’il soit à visée économique ou autre. L’histoire répond à des causes toujours multiples, ce que nombre d’historiens ont déjà mis en évidence.
Truisme de le rappeler? Pas si sûr. On voit aujourd’hui que nombre de décisions, populaires mais pas seulement, échappent à la rationalité économique et se soumettent à des idéaux plus ou moins généreux, en tout cas pas réductibles à un économisme «bourgeois» ou à un «humanisme» de gauche. Lire l’histoire à travers des lunettes vissées sur le pendule économique risque d’occulter d’autres paramètres essentiels, pour saisir le présent.
L’examen du binôme politique/économie et de la pondération de chacun de ces éléments ne propose pas que des clés à la compréhension de l’histoire, mais aussi des éclairages sur le développement très actuel des sociétés occidentales. Lui seul permet de saisir la variété des chocs contradictoires que toute histoire nationale doit surmonter. C’est tout particulièrement vrai pour cette Suisse, grande économiquement et petite politiquement!