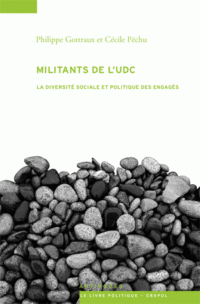Devenirs policiers
Une socialisation professionnelle en contrastes
Pichonnaz, David,
2017, 248 pages, 29 CHF, 23 €, ISBN:978-2-88901-108-7
La profession policière cristallise des débats fondamentaux à propos de la vie en démocratie: quelle place donner à l’usage de la contrainte dans la régulation des rapports sociaux? Sommes-nous toutes et tous égaux devant la mise en application de la loi? Les membres de la force publique doivent dès lors faire face à des dilemmes complexes, découlant de l’opposition entre leurs missions de service social et leur rôle de « bras armé de l’État ». Il n’est donc pas étonnant qu’ils donnent des réponses variées aux choix se présentant à eux dans leur travail quotidien. C’est sur ces contrastes que ce livre se penche.
Description
La profession policière cristallise des débats fondamentaux à propos de la vie en démocratie: quelle place donner à l’usage de la contrainte dans la régulation des rapports sociaux? Sommes-nous toutes et tous égaux devant la mise en application de la loi? Les membres de la force publique doivent dès lors faire face à des dilemmes complexes, découlant de l’opposition entre leurs missions de service social et leur rôle de « bras armé de l’État ». Il n’est donc pas étonnant qu’ils donnent des réponses variées aux choix se présentant à eux dans leur travail quotidien. C’est sur ces contrastes que ce livre se penche.
L’étude indique que la profession policière est traversée de débats et de tensions à propos de la meilleure manière de pratiquer le métier, qui s’expriment par des contradictions dans la formation délivrée aux nouvelles recrues. Les conceptions du métier de ces dernières, même après quelques années de pratique, sont d’ailleurs fortement variées. Les jeunes policières et policiers réagissent de manière contrastée à leur formation et leurs premières années de pratique, en fonction leurs parcours antérieurs, en particulier leurs trajectoires sociales et leur socialisation de genre.
Dans le monde policier, les manières traditionnelles de l’exercer se trouvent mises en question par des policiers que l’on peut qualifier de « réformateurs ». Ils ont pour projet de changer la police, se servant de la formation comme outil de réforme. Ces acteurs défendent une vision large des objectifs et compétences des policières et des policiers, rapprochant la profession de la figure du « régulateur social », davantage que du « justicier ». Dans leur perspective, la police ne doit pas uniquement se concentrer sur l’usage de la coercition et de la contrainte. Ils promeuvent au contraire des compétences alternatives relevant de la persuasion, la négociation ou la médiation, ainsi qu’un rapport de proximité avec la population. Certains défendent auprès des nouvelles recrues une attitude de résistance vis-à-vis de leurs supérieurs directs.
Grâce à des séjours répétés effectués au sein d’une école de police, l’auteur montre que les efforts des réformateurs pour enseigner des modèles policiers renouvelés se trouvent face à de nombreux obstacles. D’abord, la présence d’autres formateurs enseignant des modèles professionnels largement plus traditionnalistes. En outre, la place centrale accordée à la violence dans les exercices pratiques contribue à diffuser, auprès des recrues policières, une image des citoyennes et des citoyens comme étant hostiles et menaçants. Les compétences « relationnelles », qui soutiennent le projet réformateur, sont en outre délégitimées par différentes caractéristiques du dispositif de formation, telle que le rôle central joué par les unités d’intervention spéciales dans l’enseignement ou l’ambiguïté des prescriptions relatives à l’usage de la force qui sont enseignées.
Enfin, l’ouvrage s’intéresse de manière approfondie aux recrues, que le chercheur a suivies lors de leur formation puis dans leurs premières années de pratique. L’étude établit que les parcours antérieurs à l’entrée dans la profession façonnent largement la manière dont elles se saisissent des modèles contradictoires auxquels elles sont confrontées. L’analyse de leurs parcours individuels, mis en lien avec leurs rapports au métier, permet en effet d’explorer l’impact prépondérant qu’exerce leur passé sur leurs manières contrastées de devenir policières et policiers. Les déconvenues et pertes de statut expérimentées antérieurement constituent en particulier un terrain propice au développement d’une pratique du métier centrée sur la coercition, d’un sentiment de distance vis-à-vis de la population et d’une vision négative de la société. Par ailleurs, les policiers hommes adhérant le plus aux définitions viriles de leur masculinité manifestent une plus grande attraction pour la détection des infractions et pour l’usage de la contrainte physique, ainsi qu’une préférence pour les alternatives coercitives.
L’ouvrage étudie donc les constructions différenciées de l’habitus professionnel des jeunes policières et policiers. Il s’intéresse à la manière dont des dispositions sociales acquises avant l’entrée dans le métier contribuent à expliquer l’adhésion des nouvelles recrues, ou au contraire leurs résistances, à la doxa policière. Il s’agit ainsi de montrer que le processus de socialisation professionnelle façonne les individus de manière différenciée selon leurs trajectoires antérieures.
Table des matières
Introduction
- Prolonger les travaux sur la socialisation policière
– Le paradigme de la « culture policière » et ses défauts
– Approcher la socialisation par l’habitus: éviter les pièges de la « culture »
– L’habitus antérieur: des dispositions sociales « importées dans la police - La doxa professionnelle: un concept complémentaire à celui d’habitus
– La définition légale de la police
– Le community policing: une hétérodoxie radicale - Comment appréhender sociologiquement l’objet « police »?
- Un groupe professionnel comme les autres?
– Le débat autour de la centralité de la violence
– La police, un sous-champ au sein du champ administratif - Données d’enquête
- Structure de l’ouvrage
Comment travaille le « bon » ou la « bonne » policière?
- La remise en cause du coeur de la doxa professionnelle
– Un métier « relationnel »?
– Hiérarchiser les tâches et les moyens d’action - « Méchants » ou « zigotos »? L’enjeu du rapport à l’autre
- Conformisme et capacité de discernement: l’enjeu de l’autonomie réflexive
- Pessimisme social et rapports aux migrations: l’enjeu de la vision du monde
- Conclusion
La formation comme outil de réforme? Les obstacles de la violence et de la militarité
- La nouvelle formation policière: un modèle atypique et hybride
– Une formation atypique
– Des savoirs importés pour changer la police: les matières « réformatrices » - La mise à la marge des matières réformatrices
– Un plan d’études dominé par les matières traditionnelles
– La force symbolique des spécialistes de la violence - La violence au coeur de la formation
– La méfiance, effet indésirable de la violence
– Des corps intouchables? - L’encadrement officiel de la force policière: des prescriptions ambiguës
– La « parole » comme « arme »: un concept ambigu
– S’imposer sans agresser: un impensé de la formation
– Enseigner la transgression des prescriptions officielles? - Discipline et esprit de corps: la militarité de la formation policière
– Les contradictions entre discipline et non-conformisme
– L’esprit de corps et le culte du secret: une association impensée - Conclusion
Combattre les « méchants »? Trajectoires sociales et investissement politico-moral dans le métier
- Le prestige d’un métier singulier et de la « lutte contre la délinquance »
– Un rapport à l’autre fondé sur une distinction sociale et morale
– « Nous » contre les « délinquants »
– « Faire la morale » pour répondre au « laxisme judiciaire »
– Résister aux prescriptions scolaires pour appartenir au groupe - Parler « d’égal à égal avec les justiciables: une réussite sociale fondée sur du capital scolaire ou social
– Une ascension sociale antérieure: le rôle du capital scolaire
– Une ascension sociale antérieure: le rôle du capital social - Conclusion
Goût pour le pouvoir et rapport à la violence. Le poids de la socialisation de genre
- Masculinité virile et orthodoxie policière: le goût du pouvoir
- Socialisation féminine et masculinité moins virile: la relation au centre?
- Violence et agressivité: deux caractéristiques masculines
- Masculinité virile et habitus hétérodoxe: des aspirations atypiques
- Conclusion
Devenir pessimiste, raciste et autoritariste? L’impact du métier sur les visions du monde des recrues
- Un ordre social menacé?
- Les ressorts du pessimisme policier
- Qui menace l’ordre social?
- La racialisation des comportements délinquants
– Police et migrant·e·s: entre soupçon professionnel et rejet sociétal
– Le « profilage racial » comme une évidence
– Des recrues racistes? - Comment rétablir l’ordre?
- Rapports différenciés aux solutions répressives
– « Justice laxiste » et insatisfactions professionnelles
– Se préoccuper ou non de « ce qui se passe après » - Conclusion
Presse
David Pichonnaz est invité dans l’émission « Tribu » pour parler de Devenirs policiers (RTS, 2 juin 2017). Ecouter l’émission
Emission « Quinze minutes » sur la RTS 1, 13 mai 2017, sur les deux écoles de police romandes, avec David Pichonnaz à la minute 11:20. Ecouter l’émission
David Pichonnaz est invité par Nicole Duparc dans l’émission Versus-Penser, RTS 2, 10 mai 2017. Ecouter l’émission
Dans la revue Sociologie
Dans le contexte des débats sur les finalités et les moyens de l’activité policière, réengagés suite à la récente inflexion des politiques publiques françaises de sécurité, la parution de l’ouvrage de David Pichonnaz est particulièrement bienvenue. En effet, son analyse des initiatives – limitées – de réforme de la formation initiale des policiers suisses, donne à réfléchir sur la mise en place d’une « police de la sécurité du quotidien ». L’auteur identifie les obstacles au changement au sein du dispositif de formation et les résistances que lui opposent les recrues, façonnées par leurs dispositions et leurs expériences antérieures. L’intérêt de cet ouvrage cependant ne se réduit pas à l’écho singulier qu’il trouve dans l’actualité politique et médiatique. Il est aussi d’offrir une vision claire et articulée de l’entrée dans le métier de policier, en rompant avec une approche monolithique de l’habitus professionnel.
Dans l’introduction de l’ouvrage, l’auteur propose une discussion serrée de la littérature produite sur la socialisation professionnelle des policiers avant de présenter un cadre théorique pour l’analyse de ce processus. David Pichonnaz utilise les outils conceptuels développés par Pierre Bourdieu (habitus, doxa, champ), pour trois grandes raisons. Premièrement, dépasser le paradigme de la « culture professionnelle », habituellement convoqué dans l’analyse de la police. Deuxièmement, éclairer les points aveugles des études consacrées à la socialisation policière qui négligent trop souvent le rôle des trajectoires antérieures des recrues. Troisièmement, combler les apories des travaux de sociologie des professions et de la police, qui n’inscrivent pas suffisamment ce « sous-champ au sein du champ administratif » (p. 31) pour interroger les pratiques et les principes de classement policiers.
À cet ensemble de propositions stimulantes vient s’ajouter une méthode originale, présentée par l’auteur comme un angle mort des analyses de la socialisation policière, consistant à « déterminer ce qui permet, dans une trajectoire individuelle, d’expliquer l’acquisition (ou la non-acquisition) de certaines dispositions » (p. 21). Les divers enjeux de la réflexion étant posés, David Pichonnaz décrit, outre le contexte suisse de leur application, son solide dispositif d’enquête – également bien détaillé dans une annexe méthodologique. Sa recherche repose sur l’étude approfondie de l’Académie de Police de Savatan à la fin des années 2000. L’auteur y a observé, de manière intermittente, les enseignements dispensés durant toute la formation d’une cohorte de nouvelles recrues. Il a également consulté et analysé des documents officiels (plan d’études cadre, manuels de formation, programme des examens) qui encadrent les contenus de formation. Il a distribué un questionnaire à l’intégralité de la cohorte et réalisé des entretiens avec des formateurs et avec des élèves « à la fin de leur formation et durant leurs deux premières années de pratique » (p. 34). Un questionnaire adressé aux élèves du centre de formation de Genève, auquel se sont ajoutés des entretiens, ont apporté des matériaux supplémentaires permettant de mieux assurer les résultats.
Les deux premiers chapitres de l’ouvrage mettent « en contexte le processus d’entrée dans le métier » (p. 34). Dans le premier, l’auteur analyse les luttes de définition de l’excellence professionnelle qui structurent l’espace de la formation policière suisse, suite à sa refonte. Le programme de formation s’est non seulement uniformisé, mais il donne également de l’importance à des compétences relationnelles (ouverture, proximité, respect de l’usager) portées et défendues par des acteurs qui, au sein de la profession, cherchent à remettre en cause la doxa policière, c’est-à-dire les manières « traditionnelles » de pratiquer le métier. Après avoir pris soin d’en rappeler les principales caractéristiques, David Pichonnaz décrit les prises de position que cette doxa suscite. Pour cela, il construit deux pôles: d’un côté, les formateurs orthodoxes qui la défendent, de l’autre, les hétérodoxes qui la remettent en cause en promouvant « un rapport à la population fondé sur la proximité et l’ouverture d’esprit, et [en] valoris[a]nt les compétences réflexives et la capacité de discernement des policières et des policiers » (p. 13). Selon l’auteur, les enjeux de ces divisions se cristallisent autour de la hiérarchie des finalités et des moyens de l’activité policière mais aussi autour de ses « valeurs ». Schématiquement, les orthodoxes prônent la lutte contre le crime, valorisent la coercition et la distance sociale avec les « clients », tandis que les réformateurs, qualifiées d’hétérodoxes par l’auteur, placent au cœur du métier de policier la lutte contre les infractions mineures, la négociation et vantent les mérites de la proximité avec les usagers et les auteurs d’infraction. Pour comprendre l’issue des luttes entre ces deux modèles, David Pichonnaz identifie, dans le deuxième chapitre, les principaux obstacles aux ambitions réformatrices portées par les courants hétérodoxes au sein de la profession. Si un certain nombre de savoirs dont l’objectif officiel est de transformer les pratiques professionnelles ont été introduits dans la formation sous la forme de nouvelles matières (psychologie, éthique, droits humains, police de proximité), l’auteur constate qu’elles sont fortement marginalisées (faible dotation horaire) et ne bénéficient pas de la même légitimité que les matières « traditionnelles ». En outre, la place prépondérante accordée à la « physicalité du métier » (p. 102), qui entre en résonnance avec sa militarité, témoignent, selon lui, de la domination de l’orthodoxie professionnelle dans les enseignements prodigués.
Saisir la structure de cet espace social qu’est la formation, avec ses consensus et ses points de clivage, est une condition nécessaire mais pas suffisante selon l’auteur pour rendre compte du processus de socialisation professionnelle des nouvelles recrues. C’est pourquoi il analyse dans trois chapitres solidement étayés, par de nombreux extraits d’entretiens, les dispositions des recrues – à penser, percevoir, agir – acquises avant d’entrer dans l’école de formation de la police.
Pour rendre raison des prises de position contrastées qu’il observe, David Pichonnaz étudie les trajectoires sociales des recrues. Il montre dans le troisième chapitre que leur rapport à la population « ainsi que leur degré d’investissement politico-moral dans le métier » (p. 104) varie et dépend de ce que signifie, pour elles, l’entrée dans la profession en termes de mobilité sociale. Par exemple, les déconvenues et les formes de déclassement (perte de statut, chômage, échecs) subies avant l’entrée dans le métier disposent à adhérer à une vision orthodoxe du métier. Dans le quatrième chapitre, il souligne le rôle de la socialisation de genre dans la manière dont les recrues « se situent par rapport à ces attributs professionnels que sont le pouvoir de coercition et la violence » (p. 132). Les visions des tâches et des compétences coercitives sont différenciées: si les recrues féminines les jugent moins centrales que leurs homologues masculins, certains d’entre eux n’adhèrent pas aux définitions viriles de la masculinité et partagent une conception « sociale » du métier. Enfin, dans le cinquième chapitre, il montre que certains jugements constitutifs de la doxa policière (« pessimisme, racisme, autoritarisme » p. 161), auxquels s’opposent les recrues hétérodoxes, sont largement construits avant l’entrée dans le métier. Ils doivent notamment être rapportés à la pente de la trajectoire sociale antérieure des recrues qui souscrivent à ces schèmes de pensée.
La conclusion de l’ouvrage synthétise et organise les résultats de l’enquête. L’analyse fine des trajectoires des enquêtés permet à l’auteur de saisir les conditions dans lesquelles des habitus contrastés s’ajustent ou au contraire résistent à la doxa, mais aussi de dégager les différents éléments qui dans leurs expériences antérieures prédisposent à développer un habitus professionnel hétérodoxe ou orthodoxe. David Pichonnaz s’inscrit ensuite de manière prudente dans une perspective plus normative sur les lacunes du processus de formation, avant de suggérer d’engager « l’étude des trajectoires des policières et des policiers expérimentés, et des potentiels changements dans leurs visions et leurs pratiques du métier » (p. 220), afin de compléter et de prolonger les nombreuses pistes de réflexion offertes par ce travail de qualité.
Quelques remarques critiques, qui ne remettent pas en cause la fécondité de la démarche, peuvent permettre d’engager le débat. Il nous semble en effet, qu’en soulignant le poids de la socialisation antérieure, l’analyse proposée tend à reléguer le rôle de la formation à une part résiduelle. Pourtant elle valorise certaines dispositions et les convertit en habitus professionnel spécifique, ne serait-ce qu’en instaurant une séparation entre initiés et profanes, en inculquant les hiérarchies de prestige internes et un « esprit de corps ». Ces apprentissages sont souvent redoublés par le développement de formes de sociabilités entre les recrues, qui ne sont pas suffisamment analysées. Par ailleurs, si la formation est présentée comme ayant peu d’effets sur les habitus des recrues, l’auteur veut-il suggérer par là que les réformes sont systématiquement vouées à l’échec? Cet enjeu aurait mérité d’être discuté plus longuement en conclusion.
Au niveau méthodologique également nos propres recherches nous conduisent à soulever quelques réserves: le dispositif d’enquête saisit les visions du monde des recrues essentiellement au niveau des discours, alors que l’observation des pratiques et des investissements (matrimoniaux, amicaux, politiques et sportifs) aurait permis une appréhension plus juste des visions du monde. L’analyse des trajectoires sociales et professionnelles des réformateurs aurait également gagnée à être approfondie pour mieux cerner leur distance (distinctive?) à la doxa policière et, plus largement, la nouvelle configuration de la formation suisse, qui semble enregistrer des écarts de classe, de trajectoire et de position entre les formateurs. Mais surtout on peut regretter que l’hypothèse centrale et stimulante présentée dans l’introduction, selon laquelle les acteurs et les institutions policières constituent « une fraction partiellement autonome du champ administratif » (p. 31), ne soit finalement pas nourrie au fil de l’ouvrage, ni même reprise dans la conclusion. Elle reste ainsi à l’état de déclaration d’intention.
David Pichonnaz ne cache d’ailleurs pas le caractère partiel de certains de ses résultats. Il invite ses lecteurs à la prudence (par exemple, p. 140: « il est certes difficile de rendre compte des inclinations à l’agressivité des acteurs en se fondant uniquement sur des entretiens […]. Il aurait fallu, afin de les attester les observer au travail ») et les renvoie vers d’autres de ses publications pour compléter l’analyse. Ainsi l’honnêteté et la rigueur intellectuelles, sans oublier le souci du lecteur, manifeste entre autres dans l’usage des encadrés et le soin apporté aux conclusions de chaque chapitre, distingue cet ouvrage.
Il a également le mérite d’appréhender la socialisation professionnelle des policiers en tenant compte d’autres instances de socialisation, comme l’origine sociale ou le genre. Ce faisant, David Pichonnaz accorde une place privilégiée aux dispositions acquises en dehors de la sphère du travail, qui contribuent à façonner les visions du métier, et tente de les articuler avec les « structures objectives du sous-champ policier » (p. 20). Cette démarche féconde permet de remettre en cause les discours de sens commun homogénéisant qui présentent LE policier comme naturellement raciste ou structurellement violent, en rapportant ces cas à leurs conditions de possibilité. Plus largement, elle permet d’approcher une compréhension globale de l’entrée dans le métier, au-delà du cas étudié.
Elodie Lemaire, Sociologie [En ligne], Comptes rendus, 13 novembre 2017. URL: http://journals.openedition.org/sociologie/3332.
Dans Criminocorpus
« Je m’ennuyais terriblement. Je songeais à la morphine ou au suicide et tout à coup je me dis: je vais me faire policier1« . À quoi tient une vocation tout de même… pourrions-nous ajouter avec quelque malice. Le sociologue David Pichonnaz explore cette question délicate de la « vocation » (notion éminemment problématique) policière2 mais aussi et principalement les effets sur la carrière professionnelle des éléments biographiques antérieurs des individus, les « dispositions sociales importées », pour le citer.
Insistons d’emblée sur un intérêt scientifique qui dépasse la seule sociologie. Les historiens des forces de l’ordre contemporaines, et peut-être même modernes, auront le plus grand avantage à reprendre à leur compte les interrogations et hypothèses développées dans cet ouvrage aussi indispensable à nos yeux que le fut et le reste le livre de Dominique Monjardet, Ce que fait la police: sociologie de la force publique, paru en 1996. Rappelons à ce propos que la question de la professionnalisation a été diversement explorée par les historiens de la police3 et ceux de la gendarmerie4, voire ces deux groupes professionnels réunis et comparés5. Socialisation corporative et professionnalisation sont aussi au cœur des interrogations des politistes et des sociologues de la res militariségalement puisqu’une partie du colloque de l’Association des études sur la guerre et la stratégie (AEGES) leur était dédiée en décembre 20176.
L’étude du sociologue suisse est le fruit d’entretiens menés avec les recrues de l’Académie de police de Savatan, dans le canton de Vaud. David Pichonnaz montre qu’une réforme récente de la formation initiale des policiers suisses, désormais uniformisée à l’échelle confédérale, a produit des lignes de fractures. En effet, ce moment de reconfiguration a stimulé l’affrontement, au moins symbolique, de deux archétypes: les « orthodoxes », ainsi appelés par l’auteur, promeuvent une police principalement coercitive et répressive; les « hétérodoxes », quant à eux, sont attachés à une police de la prévention, de relations apaisées avec une population d’abord vue comme partenaire plutôt qu’adversaire, contrairement à la catégorie des « orthodoxes ». On voit qu’on pourrait facilement employer les termes de « conservateurs » et « réformateurs » comme synonymes de ces termes que l’auteur a sans doute préféré pour leur valeur a priori plus neutre. Ces débats, objets d’enjeux internes structurants, s’inscrivent sur un arrière-fond de féminisation et d’élévation du niveau de diplôme des individus recrutés, ce qui a aussi des conséquences sur les attentes et pratiques de ce groupe professionnel. À ce titre, le mode de sélection et le contenu de la formation des recrues sont des ressources stratégiques fondamentales pour qui veut conserver/changer la police par ses hommes et ses femmes.
La réflexion de l’auteur se développe sur cinq chapitres. Le premier s’attache à dévoiler les enjeux attachés à la définition du « bon » policier et donc aux pratiques qui en découlent, ces pratiques induisant elles-mêmes une relation à la population. Le deuxième volet détaille les aspects de la formation initiale des recrues, une formation durant laquelle les tenants des deux visions de la police évoquées précédemment s’affrontent. Ces mois d’inculcation de savoirs, savoir-faire et savoir-être se caractérisent par l’empreinte de la dimension militaire et du dressage des corps par les épreuves physiques. Le troisième chapitre décrit le processus par lequel les futurs policiers s’approprient les fonctions qui leur seront ensuite attribuées. En se concevant comme des gardiens de la société des « gentils » face aux « méchants » (cette dichotomie manichéenne est ainsi exprimée par les policiers), certains investissent un contenu moral que d’autres, en revanche, mettent à distance autant que faire se peut. Futurs dépositaires de la force publique, l’avant-dernier chapitre explore précisément le rapport des recrues au pouvoir de coercition qui sera ensuite le leur. Une différenciation s’opère ainsi selon le genre des policiers-ères et leur socialisation préalable. David Pichonnaz termine son ouvrage en essayant de traduire les perceptions sociales de ce groupe socioprofessionnel peut-être pas si différent du reste de la population, comme il le souligne, en dépit des représentations dominantes.
On le voit, alors qu’en France la question de la (re)création d’une police du quotidien alimente les débats depuis l’automne 2017, l’ouvrage de David Pichonnaz propose une exploration transversale qui livre des clés de compréhension non pas de ce que fait la police ou de ce qu’est la police, mais de ceux qui sont la police et lui donnent corps. En amont de l’imagination et des mises en œuvre des politiques publiques de sécurité, on peut ainsi saisir certains des éléments humains internes qui les conditionnent, en stimulent l’appropriation ou, au contraire, en favorisent le rejet par ceux-là même chargés de les appliquer. Ce constat paraît confiner au truisme, il est pourtant essentiel et pose la question fondamentale de savoir si ce sont les hommes qui font les institutions ou si celles-ci déterminent essentiellement les hommes et femmes qui les composent sans leur laisser beaucoup de latitude. Le sociologue suisse mène une enquête des plus stimulantes sur cette question philosophico-politique cardinale.
Laurent López, Criminocorpus [En ligne], 17 janvier 2018. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3681.
- Notes :
- 1. Anonyme, « Les aventures d’un détective amateur », Le Matin, 17 octobre 1908.
- 2. Mentionnons la synthèse autant que la réflexion très stimulante à ce sujet de Christian Chevandier, « Vocation professionnelle: un concept efficient pour le XXesiècle?« , Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 116-3 | 2009, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 08 janvier 2018. URL: http://journals.openedition.org/abpo/499; DOI : 10.4000/abpo.499.
- 3. Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, 1750-1850. Écriture et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Histoire, 2006, 415 p.; Quentin Deluermoz, Policiers dans la ville. La construction d’un ordre public à Paris (1854‑1914), Paris, Publication de la Sorbonne, 2012, 408 p.
- 4. Arnaud-Dominique Houte, Le métier de gendarme au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Histoire, 2010, 319 p.
- 5. Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage, La Guerre des polices n’a pas eu lieu. Gendarmes et policiers, co-acteurs de la sécurité publique sous la Troisième République (1870-1914), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. Mondes contemporains, 2014, en particulier les p. 115 à 142 qui se demandent qui devient gendarme et pourquoi plutôt que policier (municipal ou d’État), et réciproquement.
- 6. URL: http://www.aeges.fr/2017/11/21/colloque-annuel-aeges-annonce-programme/.
Dans la vraie vie, le flic est un gentil
Les policiers romands sont formés comme des Rambo, alors que leur quotidien ressemble à celui de «Joséphine, ange gardien». Et si la police se mettait à enseigner ce qu’elle est?
On l’a déjà dit, mais, vu le fantasme toujours en cours chez les aspirants, il n’est pas inutile de le répéter clairement: dans le monde réel, la plupart du temps, un policier est un type sympa et compréhensif qui aide les gens et non un justicier musclé qui chasse l’infâme, le mors aux dents. On ne parle pas du Brésil, dont les 60 000 homicides par an nécessitent sans doute de la police un rôle un peu plus violent. On parle de chez nous, paisible pays romand, qui, contrairement à l’obsession sécuritaire véhiculée par un certain M. Maudet, conseiller d’Etat de son état et aspirant conseiller fédéral, n’est pas une terre à feu à sang…
Que fait la police alors? Elle intervient dans des cas de «violence conjugale, pour déloger un SDF ou calmer une personne ivre qui embête tout un café», relève le sociologue David Pichonnaz, dans un excellent entretien qui vient de paraître dans Migros Magazine. L’essentiel de son travail est «relationnel, avec une dimension psychologique et émotionnelle».
«La force et la contrainte»
L’ennui, poursuit ce jeune chercheur qui, pour son travail de thèse, a suivi cent soixante-quatre heures de formation à l’Académie de police de Savatan et interrogé 18 policiers formés à Genève, c’est que «ces aspects n’occupent que 13% du plan d’études». Le reste de l’enseignement est fondé sur «la force et la contrainte», dans une idée (fixe) de répression et de coercition. «En endossant l’uniforme, ces jeunes gens s’attendent donc à ce que dehors, ce soit «la guerre». Or la plupart m’ont avoué leur étonnement devant une réalité professionnelle beaucoup plus calme que ce à quoi ils s’étaient préparés.»
Casser le cliché
Alléluia. On l’aime, ce David Pichonnaz. Et ce n’est pas tout. Le chercheur observe plus loin qu’aucun cours de l’école de police n’aborde le flux migratoire, alors «qu’il existe dans la police une très forte culture du soupçon à l’égard des étrangers, qui peut constituer un terreau favorable à des pratiques discriminatoires». Autrement dit, rien n’est entrepris, au contraire, pour casser le cliché qui veut que derrière chaque immigré/étranger se cache un criminel. Conséquence: une pratique policière largement décomplexée en la matière…
Il faut lire sans tarder Devenirs policiers, paru aux Editions Antipodes, et espérer que la police se mette à enseigner ce qu’elle est réellement. Mais il faut aussi entendre le message sous-jacent. Puisque le quotidien romand n’est pas un quotidien violent, nous n’avons aucune raison d’être méfiant. On peut se détendre, l’autre n’est pas un truand.
Marie-Pierre Genecand, Le Temps, 29 août 2017
« En Suisse, la formation de policier reste axée sur la violence »
Dans un livre issu de son travail de thèse, le sociologue David Pichonnaz nous plonge au sein de deux écoles de police de Suisse romande. Une centaine d’entretiens plus tard, il livre une radiographie passionnante des motivations poussant à entrer dans ce métier pas comme les autres qui cristallise tant de passions et de débats.
Pourquoi cet ouvrage et cet intérêt pour la police?
C’est un livre issu de mon travail de thèse à l’Université de Fribourg et à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris. Ce sujet m’a attiré parce que la police est à la fois un monde qui fascine, notamment les enfants, et que d’autres détestent. L’une des raisons pour lesquelles on peut rêver de revêtir l’uniforme, c’est que pour faire appliquer la loi, on a le droit de la transgresser. De faire ce que le citoyen lambda n’a pas le droit de faire.
Avez-vous le sentiment d’avoir abordé ce monde avec une représentation critique préétablie?
À l’inverse du fantasme qu’elle peut donc provoquer, d’autres gens voient la police de manière radicalement différente: comme la main droite de l’État, comme manifestation de l’autoritarisme, voire de l’arbitraire du pouvoir. Ce qui m’intéressait était d’aborder cet objet avec un regard neutre, distancié des passions que suscite cette institution. Par ailleurs, je pense que la sociologie apporte davantage lorsqu’elle s’intéresse précisément à des sujets controversés. Le regard est certes en partie critique, mais argumenté.
Comment avez-vous travaillé?
J’ai observé 164 heures de formation à Savatan, en compagnie d’une volée d’aspirants. Parmi eux, j’en ai suivi 21 durant leurs premières années de pratique, en faisant des entretiens répétés approfondis. J’ai rencontré également 18 policiers formés à Genève, à l’époque où ce canton avait son propre centre de formation. Cela fait une cinquantaine d’entretiens, auxquels s’ajoutent cinquante autres conduits avec des formateurs dans toute la Suisse romande. Ces interviews étaient anonymes, pour que les gens aient une liberté de parole aussi grande que possible. Et que leur participation à mon travail n’ait pas de répercussion sur leur avenir professionnel.
Chez ces jeunes policiers, quel type d’image de leur métier avez-vous rencontré?
Une grande diversité. Davantage que l’origine sociale, même si cette dernière a toujours une importance, c’est la trajectoire socio-professionnelle de la personne et sa socialisation de genre qui m’ont semblé jouer un rôle primordial dans leurs visions de la police.
C’est-à-dire?
Le fait de se sentir entrer dans une caste moralement supérieure, parmi les « gentils », face à une population considérée comme sujette à méfiance, est plutôt le fait de policiers qui vivent leur arrivée dans la profession comme une manière de récupérer un statut, après un déclassement social antérieur ou une période de chômage mal vécue. Par exemple un jeune avide de faire la chasse aux « méchants », selon son expression, était quelqu’un qui avait auparavant tenté en vain de ne plus avoir de patron en devenant indépendant. Dans la police, évidemment, il avait toujours des patrons, mais il acquérait un pouvoir de coercition qu’il estimait être valorisant.
Entre-t-on encore dans la police par vocation?
En sociologie, nous n’aimons pas trop ce terme. Parce qu’il existe souvent une multitude de facteurs poussant à embrasser tel ou tel univers professionnel. Je dirais par contre qu’effectivement certains y songent déjà très tôt, commençant par exemple un apprentissage en sachant à l’avance qu’ils entreront dans la police plus tard.
Avez-vous trouvé un grand écart entre l’image que ces jeunes avaient du métier de policier et la réalité qu’ils découvrent ensuite?
Clairement. D’une certaine façon la plupart des professions sont idéalisées, mais dans le cas de la police, il existe une imagerie sociale très forte. À travers des films, des séries, des reportages, l’actualité, elle est omniprésente. Et cela renforce la construction personnelle d’une certaine image, souvent centrée sur la coercition.
Qu’est-ce qui est fait pour corriger cette image?
Dans le brevet fédéral existant depuis 2003, dont le plan d’études est le même pour toutes les écoles de police, peu est réellement fait pour changer cette image: la force et la contrainte restent au centre de la formation. En endossant l’uniforme, ces jeunes gens s’attendent donc à ce que, dehors, ce soit « la guerre ». Or, la plupart m’ont avoué leur étonnement devant une réalité professionnelle finalement beaucoup plus calme que ce à quoi ils s’étaient préparés.
Une certaine désillusion, donc. C’est embêtant?
Disons que l’on sait à travers de nombreuses études que la désillusion peut mener à un certain cynisme et à renforcer le sentiment de supériorité morale par rapport à l’extérieur.
Il existe donc un écart important entre cette formation qui continue d’être essentiellement axée sur les techniques de contrôle et de contrainte avec la réalité du terrain?
Il faut bien sûr que les policiers soient formés à se défendre et à nous protéger. C’est une évidence. Mais la formation en fait un aspect central du métier. Pourtant une grande partie des tâches qui les attendent ne peuvent être accomplies avec des outils répressifs. Lorsqu’une patrouille est appelée pour de la violence conjugale, pour déloger un SDF ou calmer une personne ivre qui embête tout un café, la seule réponse coercitive est sans efficacité, voire ne fait pas sens. Une grande partie du travail de la police nécessite des compétences sociales et relationnelles. Des aspects pourtant très peu étudiés durant cette seule année de formation.
Une année, cela semble d’ailleurs peu, non?
Comparé à d’autres métiers aussi complexes, absolument. Les études le montrent: l’essentiel du travail policier est relationnel, avec une dimension psychologique et émotionnelle. Alors que ces aspects n’occupent que 13% du plan d’études. Quant aux enjeux de migration, ils sont à peine abordés. Il n’y a par exemple aucun cours sur les flux migratoires, sur pourquoi l’on migre et sur les questions d’intégration. Ce qui pourrait pourtant être utile d’autant qu’il existe une très forte culture du soupçon à l’égard des étrangers, qui peut constituer un terreau favorable à des pratiques discriminatoires.
Une particularité du policier?
Le soupçon à l’égard de l’étranger n’a pas été inventé par la police. Par contre, il est exacerbé dans ce milieu et cela pose un problème particulier, puisqu’elle dispose d’un grand pouvoir lors des contacts avec des personnes issues de la migration, qui en plus vivent souvent dans des conditions précaires. Les relations interculturelles et la lutte contre les stéréotypes pourraient donc être davantage étudiées à mon sens.
Vous signalez qu’il y a peu de femmes dans les rangs. Plusieurs campagnes de recrutement cherchent à les motiver, pourtant. Ça ne fonctionne pas?
Il n’existe pas de vraie volonté de féminiser la profession. Celle-ci reste donc très majoritairement masculine. Pour combler cet écart, il faudrait engager davantage de femmes que d’hommes pendant un certain temps.
Et pourquoi selon vous ne le veut-on pas vraiment?
Certains hommes, mais plus souvent les femmes, peuvent amener un autre regard sur le travail de policier, davantage axé sur la communication et le dialogue, par exemple. Or, actuellement, ceux que je nomme les orthodoxes, tenants d’une vision à l’ancienne axée – pour faire court – sur la répression et la contrainte, demeurent largement majoritaires. On continue donc souvent à penser que les hommes font de meilleurs policiers.
Le côté gentil et méchant, finalement, est-ce si erroné que cela?
Penser la société de manière si binaire est très réducteur… Et cela peut avoir des conséquences importantes. Par exemple cela peut justifier toutes sortes de traitements à l’égard de ceux considérés comme méchants. Secundo, avec cette vision très duale de la société, on peut considérer que les méchants ne sont pas suffisamment punis. Et être tenté de faire justice soi-même. C’est ce que montrent les travaux des chercheurs ayant suivi des policiers un peu partout dans le monde.
Mais la police n’est-elle pas tout de même amenée à intervenir auprès de ceux qui ont quelque chose à se reprocher?
Une partie de son travail est de constater et réprimer des infractions. Mais cela se fait souvent sans force, et par ailleurs la majeure partie de ses tâches est autre, d’autant que tous les corps de police disposent désormais de groupes d’intervention spécialisés. Parmi les policiers que j’ai revus, nombre d’entre eux n’avaient ainsi jamais fait usage même des menottes.
Cet amalgame n’existe-t-il pas parce que l’on nous renvoie sans cesse l’image d’une société où la violence est partout?
Sur le long terme, tout indique que la violence a énormément diminué. Par ailleurs, je n’ai jamais lu aucune étude démontrant de manière convaincante une augmentation de la violence ces dernières années. Encore une fois, si la population est considérée comme violente, c’est qu’il faut s’en méfier. Ce discours alarmiste crée un sentiment de méfiance chez des aspirants, voire le renforce pour ceux déjà prédisposés à l’éprouver. Cela donne une police distante de la population, et un terreau fertile pour d’éventuels dérapages.
Ces fameux réformateurs, qui militent pour une évolution du métier, constituent-ils un vrai mouvement de fond?
Oui, mais leur combat est difficile, notamment, car ils défendent l’idée que le rôle « social » de la police est essentiel. Certains sont des gradés, ou ont été recrutés après une carrière en dehors de la police, mais pas tous. D’autres sont entrés dans la profession à 16 ans après l’école obligatoire. Ils sont parfois membres ou anciens membres de brigades qui travaillent un peu différemment, comme celle des mineurs ou la police de proximité. Ce qui est étonnant, c’est que les nouvelles recrues qui sont sensibles aux visions du métier défendues par ces réformateurs adhèrent quand même à l’idée que la force constitue le cœur du métier.
Pourquoi selon vous?
Il faut dire que leur formation, malgré quelques discours dissonants, leur inculque cette vision. Un indice important est le fait que, à Savatan, les enseignants portent la tenue noire des unités spéciales. Alors que finalement leur rôle est celui de former des policiers, non pas des commandos militaires.
Propos recueillis par Pierre Léderrey, Migros magazine, No 33, 14 août 2017
Suisse: la formation des policiers sous la loupe d’un sociologue
David Pichonnaz s’est assis pendant un an sur les bancs de l’Académie de police de Savatan. Il y a côtoyé des recrues aux profils très divers et observé un enseignement parfois incohérent. Le programme des cours reflète des tensions non résolues entre deux approches opposées. La première se veut réformatrice et met l’accent sur la prévention et les droits humains. La seconde, plus traditionaliste, défend une culture policière basée sur l’usage de la force et l’esprit de corps.
Quelles qualités doit avoir un bon policier? Les avis sur la question divergent dans la société en général, dans le monde politique, dans la hiérarchie policière et même parmi les enseignants qui ont la responsabilité des nouvelles recrues. La mise en oeuvre dès 2003 d’une formation unifiée débouchant sur l’obtention d’un brevet fédéral de policier/policière reflète ces tensions. De nouvelles branches ont fait leur apparition dans un programme que les corps de police cantonaux tendaient à concentrer avant tout sur l’apprentissage des techniques d’enquête, de combat et de maintien de l’ordre: psychologie, police de proximité, éthique, droits humains. Mais si la moitié du temps total consacré aux examens leur est dédiée, ces dernières matières restent de fait marginales: moins d’un tiers des heures de formation leur sont affectées et elles tendent à être dévalorisées comme ne faisant pas vraiment partie des compétences de base nécessaires à l’exercice du métier.
Le prestige, en effet, est ailleurs: dans les entraînements, souvent très durs, visant à préparer les policiers aux interventions (tir, self-défense, usage des armes, moyens de contrainte) et chez les enseignants qui les dispensent, tous membres ou anciens membres d’unités d’intervention. Auréolés du lustre de l’action de terrain, ces formateurs n’hésitent pas toujours à dévaloriser certains aspects de l’enseignement comme, justement, les matières relationnelles, jugées inutiles, ou les règles d’engagement. L’interdiction de frapper un justiciable qui résiste à la tête, par exemple, est présentée par un intervenant comme une règle à retenir pour l’examen mais pas forcément pour l’exercice du métier.
Les formateurs ou formatrices qui enseignent la psychologie ou l’éthique, à l’inverse, sont rarement sortis du rang et ont rejoint la hiérarchie policière après un parcours professionnel effectué à l’extérieur, ce qui les dévalorise aux yeux des recrues. L’uniforme des enseignants – une combinaison noire comparable à celle, justement, des membres des unités d’intervention –, la pratique du garde à vous, l’usage systématique des grades confère à l’enseignement un aspect militaire qui s’oppose à l’incitation à la réflexion et à l’autonomie que ces derniers formateurs s’efforcent de promouvoir.
En clair, les apprenti.e.s policier.e.s sont confronté.e.s à des messages contradictoires, entre incitation – faible – à une approche relationnelle de leur travail et volonté – forte – de leur inculquer un esprit de corps étayé par l’exercice de la violence légale, la détection des infractions et un rapport de méfiance envers le reste de la société. Si cette deuxième approche est au bout du compte la plus influente, l’effet n’est pas le même pour tous: le parcours des recrues avant leur entrée en formation joue elle aussi un rôle important. C’est la conclusion principale de cette étude, qui ambitionne d’apporter des nuances à la description désormais classique d’une culture policière monolithique, générée par les conditions de formation et d’exercice du métier, à laquelle il serait pratiquement impossible d’échapper.
David Pichonnaz ne s’est pas contenté de suivre les cours avec les recrues. Il a soumis à toutes, en fin de formation, un questionnaire en ligne auquel elles ont été 45 à répondre sur 80. Il a en outre mené des entretiens plus approfondis avec une vingtaine d’apprenti.e.s, dont la moitié environ ont été entendus deux fois: en cours ou en fin de formation et après deux ans de pratique. Tou.te.s s’accordent pour valoriser les cours techniques et notamment la défense personnelle même si ces cours reposent sur une vision assez irréelle du métier: une fois sur le terrain, beaucoup constatent une pratique nettement moins risquée et antagoniste, où les compétences relationnelles si décriées seraient peut-être plus utiles que des prises de combat pas toujours faciles à appliquer lorsqu’une bagarre survient.
Les avis sont plus partagés sur la psychologie. Mais les différences fondamentales se marquent sur la façon de se situer par rapport aux justiciables, dans un rapport de supériorité morale ou d’égalité, de méfiance ou de bienveillance, et sur les modes d’interaction privilégiés: approche autoritaire ou écoute. Et elles départagent avant tout deux types de parcours social avant le recrutement: les attitudes les plus autoritaires se retrouvent chez des jeunes policier.e.s qui ont fait l’expérience d’une forme de déclassement (niveau de formation inférieur à celui des parents, échecs scolaires ou professionnels, chômage) face auquel l’engagement dans la police prend des allures de réhabilitation. Les policier.e.s mieux disposées envers leur clientèle ont au contraire le plus souvent connu une trajectoire sociale ascendante ou au moins plane, et présentent un niveau de formation un peu plus élevé. Enfin, de façon peu surprenante étant donné les valeurs culturelles majoritaires, les femmes se montrent plus attirées par les approches relationnelles que les hommes, plus portés sur l’affirmation de leur autorité.
Reste un domaine où les dispositions préexistantes des recrues peinent à faire la différence: le rapport aux migrants. Si quelques-unes affirment réagir aux propos racistes de collègues, presque toutes finissent par adopter une vision très pessimiste envers certaines catégories ethniques considérées comme particulièrement liées à la délinquance. A la différence de ce qui se passe, par exemple, en Grande Bretagne, l’enseignement dispensé en Suisse ne comporte aucune sensibilisation aux problèmes liés aux rapports entre policiers et minorités ethniques. Le profilage racial ne fait ainsi l’objet d’aucune remise en question; il est au contraire enseigné « comme un outil de travail légitime » et est couramment pratiqué sur le terrain.
Sylvie Arsever, Infoprisons, Bulletin électronique No 20, juillet 2017
« Les élèves policiers se croient en guerre »
Le sociologue David Pichonnaz passe au crible l’enseignement donné aux futurs agents, en ciblant Savatan. Il met en question le poids de la violence.
Pendant un an, il a suivi une volée de l’Académie de Savatan (VS), à la fin des années 2000. Là où sont formés les policiers vaudois, valaisans et aussi genevois depuis 2016. David Pichonnaz, docteur en sociologie, spécialisé dans l’étude des métiers relationnels, chercheur à la Haute Ecole de santé Vaud et chargé de cours à l’Université de Lausanne, s’est ensuite entretenu avec des policiers nouveaux dans le métier. Il a aussi interrogé des formateurs. Ces investigations ont engendré une thèse tout récemment publiée sous le titre Devenirs policiers (Editions Antipodes). L’auteur y met sur le gril la place prépondérante de la discipline militaire et de la violence dans la formation, peu compatibles avec l’idée d’une police de proximité en relation plus étroite avec la population. Est-ce défendable face au terrorisme? Il le pense et s’explique.
Vous avez été frappé par la place de la violence dans la formation policière. Qu’en disent les intéressés?
La contrainte et la violence sont centrales dans les exercices. C’est lié à l’importance que le plan d’études fédéral de la formation policière leur donne. Mais les exercices que j’ai observés à Savatan mettent en scène majoritairement les justiciables les plus dangereux. Il est indéniable que les jeunes policières et jeunes policiers doivent être préparés « au pire ». Ils estiment cependant que leur formation leur donne une image biaisée de la réalité. « On nous fait croire que, sur le terrain, c’est la guerre » est un discours récurrent de leur part. La formation a tendance à présenter la population avant tout comme une menace, dont il faut se méfier.
Mais l’actualité du terrorisme ne donne-t-elle pas raison à cette attitude?
Il serait naïf de penser que les policiers qui s’occupent de notre sécurité quotidienne sont les mieux placés pour lutter contre le terrorisme. C’est davantage une tâche de spécialistes. A ce sujet, l’importance donnée aux groupes d’interventions spéciales à Savatan contribue largement à transmettre aux recrues l’idée que le vrai métier de policier, c’est l’usage de la force. De nombreux formateurs proviennent de ces forces spéciales. Leur travail est pourtant à l’opposé du quotidien policier. La plupart des tâches policières ne nécessitent pas l’usage de la force, et pas forcément la détection d’infractions. Les policiers sont confrontés à des milieux sociaux divers, à des problèmes complexes. Ce sont par exemple des conflits domestiques ou de voisinage, des personnes en détresse psychologique ou la prise en charge de « troubles » liés à la marginalité.
Politiquement, il est actuellement difficile de prôner à fond une telle police de proximité…
Des liens forts entre police et population permettent de prendre en charge plus efficacement ces problèmes, comme le montrent de nombreuses études. Un tel rapprochement permet même de prévenir des infractions avant qu’elles ne soient commises. Ce n’est pas le paradigme adopté par les politiques policières actuelles! Il permettrait pourtant de prévenir également les phénomènes de radicalisation. Cela passerait par une meilleure collaboration entre la police et d’autres institutions, dans les domaines de la santé et du social.
Il reste que la violence est une réalité. Comment la police doit-elle faire face?
En tant que citoyens, on compte sur la police pour maîtriser la violence. Mais les policiers qui s’occupent de notre sécurité quotidienne sont épaulés par les groupes d’intervention, qui peuvent agir en quelques minutes. Tous n’ont donc pas besoin d’être des spécialistes en utilisation des outils de contrainte. En Grande-Bretagne, les policiers généralistes ne portent pas d’armes à feu. Cela n’a pas empêché les spécialistes de maîtriser les auteurs des derniers attentats de Londres en huit minutes!
Les matières relationnelles sont enseignées à Savatan. Pourquoi n’ont-elles pas davantage d’impact?
Les personnes qui enseignent ces matières ne peuvent pas compter sur la même légitimité que les autres. Elles ne proviennent pas des unités d’intervention. La psychologie est souvent présentée par des femmes dans un monde d’hommes. Certains formateurs sont de hauts gradés, parfois universitaires, jugés distants. Les matières relationnelles, dans le plan d’études fédéral, ne représentent que 13% du temps d’enseignement…
Un débat en vue d’une évolution a-t-il lieu sur le plan politique?
Cela ne semble pas être le cas: le plan d’études fédéral n’a pas été modifié depuis son introduction il y a treize ans. En l’état, la formation semble pourtant en décalage avec la complexité du métier de policier. Il requiert des compétences très variables: faire face à la violence tout en gérant son agressivité, procéder à des arrestations, négocier, jouer parfois un rôle de travailleur social… En plus de mettre l’accent sur la contrainte, la formation sépare largement les compétences relationnelles de celles relevant de la technique. Il faudrait plutôt les articuler.
Vous pointez aussi le côté militaire de la formation. Ne faut-il pas de la discipline?
Dans les moments d’urgence, il faut surtout de la coordination. L’armée, c’est la guerre. Certains formateurs, certes minoritaires, rappellent aux recrues que la population n’est pas l’adversaire de la police… L’esprit militaire inculque un respect aveugle des ordres. Il s’oppose à l’idée que les policiers doivent faire preuve de capacité de discernement face aux situations complexes qu’ils rencontrent. En outre, un esprit de corps exacerbé peut engendrer un culte du silence, avec le risque que des fautes ne soient pas dénoncées. Il est pourtant possible de s’éloigner de la référence à l’armée. La police bernoise, par exemple, a renoncé aux grades militaires, qui sont toujours en vigueur ici.
A Savatan, cette militarisation est-elle liée à la direction actuelle?
Quand j’ai suivi une volée à Savatan, c’était avant l’arrivée du directeur actuel (ndlr: le colonel Alain Bergonzoli). Il a renforcé une tendance qui existait déjà. En outre, alors qu’elle était responsable de la police, la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro me semble avoir soutenu cette orientation.
Votre position n’est-elle pas celle d’une politique de gauche?
Le livre présente les résultats d’une étude sociologique, pas des opinions politiques. La réflexion est basée sur des données solides: 164 heures de cours et exercices observés à Savatan, 50 entretiens conduits avec de jeunes recrues, 50 autres avec des formateurs dans toute la Suisse romande, de nombreux documents officiels. Mes analyses s’appuient également sur la littérature scientifique internationale consacrée à la police.
ENCADRE
Feuilleton : Des critiques déjà entendues
Les remarques formulées par David Pichonnaz à l’encontre de l’Académie de Savatan ne sont pas inédites. En février dernier, sur les ondes de La Première, de vives critiques étaient adressées à l’institution par Frédéric Maillard, analyste des pratiques policières suisses. Ce dernier parlait alors d’une détérioration, depuis 2015, des interpellations et d’une augmentation de la violence sans pouvoir toutefois le prouver par des chiffres. Surtout, il dénonçait « une sous-culture policière » née d’une trop grande militarisation de certains corps de police, en particulier latins. Frédéric Maillard qualifiait également la formation dispensée à Savatan de « menaçante » et l’Académie de « rétrograde ». Pour lui, les policiers y sont parfois infantilisés, au point de n’être plus capables de s’opposer à leur hiérarchie si besoin. A l’époque, le conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet avait immédiatement réagi au nom des trois cantons concernés. Interrogé par Le Temps, il contestait une telle dégradation des pratiques, expliquait que la police « ne peut fonctionner sur un mode participatif car elle n’est pas une coopérative » et que les aspirants eux-mêmes sont demandeurs d’une certaine autorité. Par ailleurs, l’élu PLR qualifiait Frédéric Maillard d’ »expert autoproclamé à la recherche de mandats ». De son côté, l’Académie de Savatan n’avait pas souhaité s’exprimer sur ce sujet dans 24 heures. Aujourd’hui, la parution du livre de David Pichonnaz fait écho aux dires de Frédéric Maillard, et ce dernier vient d’ailleurs de publier, sur son blog, un bref entretien avec le sociologue. Au Canton, la cheffe du Département des institutions et de la sécurité, Béatrice Métraux, indique n’avoir pas encore pris connaissance de l’ouvrage et ne souhaite donc pas s’exprimer à ce stade. R.H.
Propos recueillis par Philippe Maspoli, 24 Heures, 10 juin 2017
Devenirs policiers: un livre qui éclaire!
L’ouvrage Devenirs policiers aux éditions Antipodes du sociologue David Pichonnaz, issu de sa thèse de doctorat, apparaît comme une oasis de verdure dans le désert de la littérature policière scientifique de Suisse romande. L’auteur décrypte la formation et le parcours de celles et ceux qui rejoignent la force publique en Suisse romande. L’étude de terrain est basée sur une immersion dans une école de police et sur des entretiens approfondis menés avec des policières et des policiers fraîchement entrés dans le métier. […]
Trois questions à David Pichonnaz (Rencontre de visu effectuée en date du 1er juin 2017 à Lausanne)
1. Monsieur Pichonnaz ; comment la parution de votre livre – au titre évocateur – est-elle accueillie et perçue ?
Je me suis rendu compte que les activités policières et leurs enjeux soulevaient un intérêt important de la part du public. Mais, par ailleurs, je regrette que beaucoup d’études qui traitent des polices et de leurs activités restent confidentielles. Les chercheurs devraient davantage communiquer et diffuser plus largement leurs résultats, entre universités et institutions de police notamment.
2. Dans votre travail, vous relevez une nette différence entre les matières traditionnelles (ex. actions tactiques, maintien d’ordre, etc.) et réformatrices (ex. psychologie, éthique relationnelle, etc.). Quelle est donc cette différence ?
Les matières que j’appelle réformatrices sont moins valorisées, moins légitimées dans la formation. Leur enseignement est essentiellement assuré par des femmes, des intervenants de l’extérieur et quelques hauts gradés. Aux yeux des aspirants, ce sont les membres des unités spéciales, par exemple, qui sont la référence. Je me questionne donc sur la pertinence d’une formation qui est si éloignée de la réalité du métier, avec une place si faible allouée aux savoir-faire relationnels.
3. Vous affirmez donc que la formation du policier romand est en décalage avec la pratique du métier?
En effet, elle est très centrée sur les usages de la force et de la contrainte. Alors que les études empiriques sur le travail policier montrent que l’essentiel des tâches policières sont d’ordre relationnel. De plus, comme certains cadres policiers le défendent, on peut penser que plus on est formé à l’usage des outils coercitifs, plus on risque de s’en servir souvent. Ainsi, de nombreux outils alternatifs, comme la médiation, la négociation ou la persuasion, sont rendus peu visibles par une formation qui se concentre sur la coercition.
Propos recueillis par Frédéric Maillard, L’observatoire des polices, Le blog de Frédéric Maillard, 6 juin 2017
Les futurs policiers romands, entre assistants sociaux et dépositaires de l’autorité
Le sociologue David Pichonnaz a observé les recrues de l’Académie de police de Savatan. Son livre raconte comment les questions d’éthique ou l’apprentissage de la psychologie cohabitent avec le besoin d’ordre.
« C’est clair qu’il faut avoir une formation pour l’utilisation des armes et tout ça. Mais il faut apprendre à dialoguer aussi. » Celui que l’étude menée par le sociologue David Pichonnaz au sein de l’Académie de police de Savatan désigne par le pseudonyme de Simon Mottet fait partie de la minorité de recrues qui estime avoir bénéficié des nouveaux enseignements introduits à l’occasion de la création d’un brevet fédéral de policier/policière: psychologie, police de proximité, éthique et droits humains.
Plusieurs conceptions du métier
Si ces nouvelles branches occupent une place importante dans les examens, cet intérêt ne se retrouve ni dans l’organisation des cours, ni surtout dans l’esprit prévalant au sein de l’Académie. Le cadre militarisé, l’uniforme des enseignants, la part prépondérante accordée aux techniques d’intervention et notamment de combat, reflètent une conception du métier de policier dans laquelle ces nouvelles matières n’offrent guère d’utilité.
Les recrues adoptent en majorité cette façon de voir, même si elles sont nombreuses à constater, une fois sur le terrain, que la réalité diffère de la vision diffusée à l’école. Les interventions physiques et les bagarres y sont moins nombreuses, plus fréquentes les situations où le policier est amené à faire ce qui est souvent décrié comme « du social »: prendre en charge des victimes ou calmer un conflit conjugal.
Nature des interventions
Cette situation paradoxale découle de divergences sur la conception du métier de policier au sein de la hiérarchie policière et du corps des formateurs. En jeu: la nature de l’intervention attendue des policiers. Doivent-ils avant tout appréhender des auteurs d’infraction et faire régner l’ordre? Ou peuvent-ils être associés à la prévention, notamment par un lien renforcé avec les acteurs de la société civile et une présence sur le terrain non liée aux besoins immédiats de la répression? Pour le moment, cette dernière approche ne se voit accorder en Suisse, sous l’appellation de police de proximité, qu’une part congrue et elle est présentée comme peu prestigieuse dans la formation.
David Pichonnaz a suivi les cours de l’Académie et interrogé leurs bénéficiaires, certains une seule fois, d’autres une seconde fois après deux ans de pratique. Il présente un tableau contrasté, où les individualités se marquent par des attitudes différentes envers les justiciables et les approches à privilégier: rappel à l’ordre autoritaire ou dialogue.
Prédispositions
Deux facteurs semblent prédisposer à l’une ou à l’autre. Le genre d’abord: comme dans la société en général, les femmes favorisent une approche relationnelle, les hommes l’affirmation de leur autorité. Et le parcours social des recrues avant leur engagement: plus ce parcours a été difficile, marqué par des échecs de formation, un statut social inférieur à celui des parents ou une période de chômage, plus s’affirme la tendance à se voir, une fois sous l’uniforme, comme investi de la mission de faire régner la loi et la morale. Les recrues qui ont une expérience positive de leur formation ou de leur vie professionnelle antérieure se montrent plus portées à considérer les justiciables comme des égaux qu’il faut éviter de juger trop vite.
Sur un point toutefois, les différences s’estompent. La plupart des jeunes policiers interrogés entretiennent un rapport de méfiance avec les migrants, jugés comme particulièrement concernés par la criminalité. Il faut dire que la formation, loin de mettre en garde contre les dérives possibles du profilage racial, le présente comme un outil de travail légitime.
Sylvie Arsever, Le Temps, 28 mai 2017.