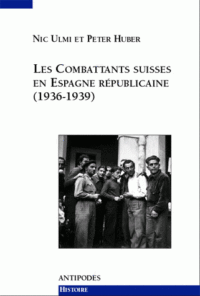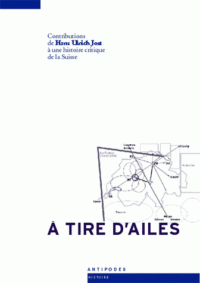Usages de la violence en politique (1950-2000)
Villiger, Carole,
2017, 296 pages, 32 CHF, 26 €, ISBN:978-2-88901-090-5
Dans nos sociétés où les conflits politiques sont censés se régler dans l’arène parlementaire et le peuple s’exprimer par les urnes, quelle est la place de la violence comme moyen de revendication? En Suisse, la démocratie directe, l’aisance économique, la sécurité, la neutralité sont supposées écarter l’utilisation de la violence. Pourtant, entre 1950 et 2000, le pays a fait face à de nombreux éclats de violence…
Description
Dans nos sociétés démocratiques où les conflits politiques sont censés se régler dans l’arène parlementaire et le peuple s’exprimer par les urnes, quelle est la place, la valeur et l’appréhension de la violence comme moyen de revendication? En Suisse, la démocratie directe, l’aisance économique, la sécurité ainsi que la neutralité sont supposées écarter toute utilisation de la violence pour appuyer une démarche protestataire.
Pourtant, entre 1950 et 2000, le pays a fait face à de nombreux éclats de violence. Tout d’abord, ceux des séparatistes et des antiséparatistes jurassiens, puis ceux de mouvements d’extrême gauche et, enfin, ceux de mouvements d’extrême droite. Durant cette période, le pays a également été marqué par les attaques provenant de mouvements armés italiens et allemands, ainsi que par les attentats meurtriers planifiés par des organisations palestiniennes et arméniennes. Ces interventions violentes dans l’espace public helvétique viennent ainsi démentir le mythe d’une Suisse paisible et pacifiée.
Fondé sur les témoignages des acteurs de l’époque et sur des documents inédits de la police fédérale, cet ouvrage apporte une réflexion sur les continuités des épisodes de violences collectives, permettant ainsi d’appréhender les événements actuels. Il s’adresse à toutes les personnes qui s’interrogent sur les récents attentats et, de manière plus large, à l’utilisation de la violence dans les conflits politiques.
Préface de Michel Wieviorka
Table des matières
Préface
Michel Wieviorka
Introduction
- Les multiples visages de la violence
Violence et mouvements sociaux
Extrémisme et violence - L’identification des actions collectives violentes en Suisse
La violence invisible
Les sources
1. Jura : le séparatisme par les armes
- L’escalade de la violence entre les séparatistes et les antiséparatistes
- Berne en embuscade dans la crise jurassienne: les émeutes de Moutier
- La fin de la lutte menée à l’explosif
Un dénouement tragique - Conclusion
2. Une extrême gauche explosive dans le carcan de la guerre froide
- Les derniers sursauts révolutionnaires
- Des anarchistes aux antinucléaires: un mouvement pluriel
Les interventions violentes des différents courants politiques - L’engrenage des actions et de la répression
La traque des anarchistes
Pas de place pour la subversion à Winterthour
L’action violente: du romantisme au « terrorisme » - Rote Gallus: acte « terroriste » ou acte rhétorique?
- L’émergence d’un nouveau thème de lutte: les antinucléaires
Une répression peu marquée - Conclusion
3. Le racisme décomplexé de l’extrême droite
- Une manifestation constante et régulière de la violence
- L’atténuation du potentiel radical et politique des actions
- Les skinheads: une violence purement expressive?
- Conclusion
4. La Suisse au carrefour des réseaux transnationaux européens
- L’évaluation des violences politiques
- Les actions violentes des organisations clandestines allemandes et italiennes
- Les solidarités avec les mouvements de lutte armée
« Je viens en vacances en Suisse et ils me font chier avec la Révolution! »
Rote Hilfe: le soutien aux prisonniers dits « politiques »
Funke: une fascination réservée pour la RAF
« Petra Krause Band »: un tigre de papier?
Les réseaux avec les mouvements italiens
L’appréhension de la répression et de ses conséquences
Les conséquences biographiques de l’activisme
L’affaire Flükiger: de simples meurtres aux allures d’actions politiques planifiées
Le poumon de l’extrême droite européenne
La construction de l’ennemi extérieur: les skinheads allemands - La réplique de la police fédérale
- Conclusion
5. Décloisonnements idéologiques et coalitions transversales autour des luttes de décolonisation et de libération
- Les interactions avec les milieux pro- et anti-indépendantistes algériens
L’embarras des autorités politiques suisses - L’entrelacement des réseaux suisses de soutien aux luttes palestiniennes
Le soutien des milieux de l’extrême droite
L’impuissance du gouvernement
Les attentats des organisations arméniennes en Suisse
L’éclatement des frontières entre l’extrême gauche et l’extrême droite
Antisémitisme et antisionisme - Conclusion
Conclusion
- Les opportunités politiques
- Le choix de l’action violente
- Le rôle de la violence
- L’appréhension de la violence par les autorités politiques
- Les réseaux transnationaux
- Faire de la menace une donnée extérieure à la Suisse
Presse
Commentaire du livre paru dans les Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier
Qu’est-ce que la violence en politique? S’est-elle exercée en Suisse, dans quels contextes et avec quels résultats? C’est à ces questions passionnantes que Carole Villiger cherche à répondre dans ce livre. Ses réponses tordent le cou à bien des préjugés, à commencer par celui d’une Suisse tranquille, épargnée des actes terroristes et de la violence d’État au XXe siècle – idées certes probablement moins répandues qu’ailleurs parmi le lectorat des Cahiers, qui en apprendra toutefois beaucoup à la lecture de sa thèse.
Deux écueils se sont d’emblée posés à la chercheuse pour cerner son objet d’étude: définir la violence et réunir un corpus de cas y répondant. Le concept de violence est en effet très discuté, notamment par les politologues, chez lesquel·le·s Carole Villiger a puisé un vaste ensemble de théories. Sans pour autant prétendre à une définition totalement satisfaisante, elle en retient une approche pragmatique: sont définies comme violentes des actions qui confrontent plusieurs parties, et durant lesquelles des biens matériels sont endommagés et/ou des personnes atteintes physiquement, en dépit d’une résistance. La recherche bute toutefois, de l’aveu même de l’historienne, sur l’appréhension de cette violence par l’État, qui en détient le monopole et est donc à même d’imposer au public sa propre perception des actions violentes. Avec honnêteté, elle n’esquive pas la question et en fait même un point central de son travail, puisque son corpus de base est constitué par une recherche des actions mentionnées dans la presse, elle-même reflet de cette appréhension subjective de la violence. Pour contrebalancer cette perception, la chercheuse a d’emblée décidé de cibler trois types de mouvances politiques qui ont utilisé la violence: l’extrême gauche (définie assez largement, cela dit), l’extrême droite, les protagonistes du conflit jurassien. Elle y a ajouté les actions violentes menées par des groupes étrangers sur territoire suisse.
[…]
Pauline Milani, Cahiers AEHMO, n°34, 2018.
Chronique dans le journal L’OURS
Cet ouvrage vient mettre à mal l’image de la Suisse comme celle d’un pays neutre et tranquille. En effet, Carole Villiger propose une lecture de la violence à travers deux grilles de lecture : les groupes terroristes présents en Suisse, d’une part, et les tentations de l’action violente, d’autre part. La neutralité du pays ne signifie pas celle de ses résidents. L’autrice esquisse en cinq chapitres les formes de la violence existantes. Elle commence par un aspect relativement marginal, les affrontements autour de l’indépendance du Jura qui entraînent en l’espace de 20 ans plus de quarante attentats. Après avoir passé en revue les actions violentes d’extrême gauche principalement contre les lieux symboliques du capitalisme, elle se penche sur celle de l’extrême droite qui s’en prend aux personnes et aux immigrés installés dans le pays.
D’un point de vue factuel, les deux derniers chapitres permettent de voir en quoi la Suisse a été au cœur des réseaux terroristes dans les années 1960 et 1970: son plurilinguisme, sa neutralité et sa position centrale en Europe lui permettait de servir de base arrière pour une partie des groupes comme les Brigades rouges ou la fraction armée rouge; mais aussi pour les groupes tiers-mondistes ou nationalistes comme le FLN algérien ou les groupes palestiniens. Les uns comme les autres pouvant recevoir des soutiens aussi divers que ceux de l’avocat Vergès ou du banquier nazi François Genoud.
Sylvain Boulouque, L’OURS (L’Office Universitaire de Recherche Socialiste), n°480, juillet-août 2018.
Carole Villiger parle de la violence politique en Suisse, dans l’émission Tribu (RTS1, 20.08.18). Ecouter l’émission
Interview de Gabriel Sidler sur le journal/blog pagesdegauche.ch
Dans la Revue suisse d’histoire
En se fondant sur un tour d’horizon des phénomènes de violence à but politique en Suisse, Carole Villiger se propose de questionner le mythe d’un pays bucolique dans l’après-guerre. L’ouvrage qui se base sur sa thèse de doctorat défendue à l’Université de Lausanne entend analyser l’importance de la violence comme forme de revendication politique dans un pays officiel et apparemment «épargné» par la violence. L’angle d’approche s’articule autour de deux axes: d’un côté, fonction et signification de la violence, de l’autre, perception et interprétation que l’État fait de cette violence. À cette fin, l’auteure recourt à un corpus de sources vaste et hétérogène comprenant les fonds des Archives Fédérales Suisses, des Sozialarchiv zurichois, du Hamburger Institut für Sozialfor-schung, la presse suisse et même l’histoire orale grâce à un nombre considérable d’entretiens avec des témoins comme Claudia Bislin, Gaston-Armand Amaudruz et Dick Marty, entre autres. Chacun des cinq chapitres se termine par une conclusion concise. Villiger traite d’abord la violence dans la lutte entre les séparatistes et les anti-séparatistes jurassiens, antagonisme articulé autour de groupes comme le Front de libération du Jura, le Rassemblement jurassien, le groupe Bélier et le groupe Sanglier, sans oublier la bienveillance des autorités bernoises et fédérales envers les anti-séparatistes. Le deuxième chapitre est consacré à l’extrême gauche suisse, englobant les mouvements et les militants anarchistes, communards, autonomes et antinucléaires. Si la société et les médias montrèrent de la bienveillance envers le groupe anarchiste Ravachol qui au début des années soixante lança des cocktails Molotov contre la façade du Consulat espagnol à Genève, la violence des années 1970 poussa les autorités policières et judiciaires suisses à répondre à la recrudescence de la violence en introduisant le terme de «terroriste» dans leur taxonomie. Puis, vient le tour des mouvements de l’extrême droite, illustrés par les skinheads et d’autres groupes racistes des années 1980 – phénomènes présents surtout dans la Suisse alémanique –, sans oublier le climat d’hostilité envers les étrangers depuis les années 1960 et le mouvement autour de James Schwarzenbach, ni le rôle du négationniste Amaudruz. L’auteure consacre le quatrième chapitre au soutien suisse aux mouvements radicaux étrangers comme la Rote Armee Fraktion ou les Brigate Rosse, mais aussi à l’extrême droite. Ces engagements englobaient des pratiques qui allaient de la mobilisation contre les conditions d’incarcération jusqu’au recel d’armes. La Suisse fut aussi un carrefour important pour les mouvements de libération et d’indépendance dans le contexte de la décolonisation. Villiger se centre sur les cas de l’Algérie, de l’Arménie et de la Palestine. Le soutien aux organisations arabes (FLN, FPLP) attira dans ces filets des militants d’extrême droite (François Genoud) et d’extrême gauche (Bruno Bréguet).
Bien que Villiger renonce à fournir une définition précise des termes «violence» ou «terrorisme», elle envisage non seulement la violence physique d’un attentat mais aussi la violence verbale de l’extrême droite, la violence invisible d’un État en proie à une paranoïa anticommuniste et celle qui stigmatise les ex-militants qui, après leur peine de prison, cherchent à se réinsérer dans la société. La structure intelligente et intelligible est cependant parfois troublée par les nombreuses parenthèses dans le fil du texte, contenant des notes biographiques ou sur des organisations, qui empêchent une lecture continuelle. L’usage de l’histoire orale qui permet de compenser les documents (toujours) inacces-sibles mais aussi d’oser une histoire plus subjective et plus vive est sans nul doute un enrichissement dans cet ouvrage. Toutefois, en recourant parfois à un contraste avec la presse, l’auteure prive l’histoire orale de son valeur. En revanche, le style plutôt journalistique et audacieux rend ce texte accessible pour tout public. D’ailleurs, il s’agit d’un livre essentiellement empirique, les aspects théoriques tenant une place mineure. Cela n’est pas forcément un désavantage si on considère la quantité exorbitante d’œuvres consacrées au sujet de la violence politique. Néanmoins, le rôle des émotions auquel Villiger attribue une certaine importance n’est traité que d’une manière très périphérique et superficielle, sans profiter des avantages de l’histoire orale, heuristiques désormais établies dans l’histoire, et sans considérer des ouvrages pertinents, par exemple, sur la peur ou la nostalgie. Parfois on constate une incohérence dans l’argumentation. Dans ce contexte, l’analogie faite entre la critique du procès de Nuremberg de la part d’Amaudruz et la défense de skinheads dans un procès judiciaire par leur avocat Pascal Junod ne convainc pas vraiment. En outre, la cohérence entre la mort du néonazi Frank Schubert en 1980 et l’attaque d’un Malien par un groupe de skinheads en 1997 semble tirée par les cheveux pour parler de «réseaux» des groupes d’extrême droite suisses avec des homolo-gues étrangers. D’ailleurs, aucune mention du volume Schweizer Terrorjahre de Marcel Gyr, paru en janvier 2016, sur un entretien secret au début des années 1970 entre des représentants du gouvernement helvétique et des membres l’Organisation de libération de la Palestine, ni du «petit éclat» parmi les historiens suisses n’est faite.
En somme, l’ouvrage de Carole Villiger prouve sans aucun doute que la Suisse ne fut aucunement un Sonderfall par rapport au terrorisme et à la violence politique. Ainsi, l’auteure rend justice à la complexité d’un sujet incontestablement actuel et, dans le cas suisse, paradoxalement peu étudié. Pour cette raison, elle incite à vouloir en savoir plus.
Moisés Prieto, Humboldt-Universität zu Berlin, SZG/RSH/RSS, 68/2, 2018, pp. 423–424
Carole Villiger parle de la violence politique en Suisse, dans Versus-penser (RTS2, 9.10.17). Ecouter l’émission
Dans H-Soz-Kult
Dans cet ouvrage, Carole Villiger s’attache à déconstruire le lieu commun d’une Suisse d’après-guerre tranquille, épargnée par les conflits violents qu’ont connu d’autres pays voisins ou lointains. Bien au-delà de cette image de quiétude, elle montre que la Suisse a été le théâtre d’actes politiques violents sur toute la deuxième moitié du 20e siècle. En s’intéressant à la violence à caractère politique, elle comble une lacune dans la recherche sur les mouvements sociaux helvétiques pendant la période de la guerre froide. L’ouvrage propose une perspective à la fois historique et sociologique, et adopte une approche centrée sur les acteurs et actrices, dans la continuité des travaux les plus récents sur les mobilisations collectives.1 Si certains actes politiques violents sont déjà bien connus dans l’historiographie suisse, l’approche, les sources et l’analyse mobilisées ici livrent des résultats nouveaux et convaincants.
Carole Villiger propose un tour d’horizon des actions politiques violentes en cinq chapitres, organisés selon l’orientation politique de leurs auteur.e.s, et leur résonnance nationale et internationale. Les nombreuses sources qu’elle a recueillies en Suisse et en Allemagne sont riches, malgré des restrictions d’accès, des archives lacunaires et de nombreux refus de participation de la part de témoins. Elle combine des coupures de presse, les archives de groupes militants, celles de la police fédérale, des témoignages publiés ainsi que des sources orales.
Le chapitre 1 est consacré au conflit jurassien entre la fin des années 1950 et le début des années 1990, à ce jour bien documenté. Carole Villiger complète ces études en analysant les ressorts de l’engagement individuel dans ce contexte social et politique particulier, à partir de l’exemple d’un militant séparatiste.
Le chapitre 2, le plus long, se penche sur l’extrême gauche des années 1960 à la fin de la guerre froide. Il est l’un des plus intéressants et novateurs du livre, en particulier lorsque l’historienne étudie l’appréhension et la réaction de la police et de la justice face aux actions violentes issues de ces milieux. Carole Villiger fait une démonstration solide et passionnante de l’intrication de plusieurs facteurs dans l’interprétation de ces actions par la police et la justice, et présente ainsi des résultats inédits quant à l’histoire des mouvements d’extrême gauche en Suisse. Si tous ces mouvements suscitent la méfiance et la surveillance de la police, elle montre que le degré de répression et de sanction est tributaire du courant d’où proviennent les actions violentes. Ainsi, les mouvements et individus qui remettent en cause l’existence de l’Etat (les anarchistes) ou ébranlent l’ordre social (les autonomes) sont davantage sanctionnés que ceux qui s’attaquent à un domaine particulier de la politique gouvernementale (les antinucléaires). Ensuite, le moment historique de la réaction des autorités a également un impact. A ce titre, sa démonstration autour de l’entrée de la catégorie « terrorisme » dans le vocable de la police fédérale dans les années 1970, pour qualifier quasi exclusivement des actions en provenance de l’extrême gauche, est remarquable. Enfin, le lieu influence aussi l’appréhension du danger et la tolérance varie selon les aires linguistiques.
Le chapitre 3, dédié à l’extrême droite, est nettement plus court que celui consacré à l’extrême gauche. Cette brièveté est le reflet de la disparité des sources entre ces deux pôles politiques, les documents autour de l’extrême droite étant lacunaires, plus difficiles ou impossibles d’accès. La disponibilité réduite des sources traduit également la surveillance moindre de l’extrême droite par la police, ainsi qu’un décalage temporel dans ses activités, qui se sont intensifiées à partir des années 1980 et n’étaient pas terminées à la fin de la période étudiée. Malgré un nombre d’actions violentes plus élevé sur une période plus courte et qui ont surtout visé des personnes, Carole Villiger montre que l’extrême droite a été moins surveillée et sanctionnée que l’extrême gauche. Sa démonstration, probante, se base sur l’analyse des discours policiers et judiciaires relatifs aux actions violentes de l’extrême droite. L’argument le plus intéressant qu’elle met en évidence consiste en une minimisation du degré de gravité et une dépolitisation des actions violentes de l’extrême droite; ce qui explique pourquoi la répression à leur encontre, tardive, a porté essentiellement sur le désordre social qu’elles entraînaient et non sur leurs motivations politiques racistes.
Le chapitre 4 s’intéresse aux réseaux transnationaux européens – principalement allemands et italiens – qui ont été actifs en Suisse. Il montre que le soutien de mouvements et d’activistes suisses a surtout été indirect, que ce soit à l’extrême gauche ou à l’extrême droite. En écho aux chapitres 2 et 3, Carole Villiger expose l’appréhension différenciée de ces réseaux par la police: considérant les réseaux d’extrême gauche comme des groupes structurés et donc dangereux pour l’Etat, elle s’est peu intéressée aux mouvements d’extrême droite avant les années 1990, minimisant leur potentiel de menace et l’extériorisant sur les pays voisins. Carole Villiger nuance toutefois cette différenciation, non opérante quand il s’est agi d’arrêter des ressortissant.e.s de pays européens militant dans des groupes armés alors qu’ils et elles transitaient par la Suisse. La police n’a dans ce cas pas fait, sauf rares exceptions, de différence entre activistes d’extrême gauche et d’extrême droite.
Le chapitre 5 est finalement consacré aux actions violentes liées aux conflits de décolonisation et de libération sur le territoire helvétique – la guerre d’Algérie à la fin des années 1950, les actions de mouvements armés palestiniens dans les années 1960 et 1970, et arméniens dans les années 1980. Carole Villiger se penche particulièrement sur la cause palestinienne, soutenue tant à l’extrême gauche qu’à l’extrême droite en Suisse, ici aussi de manière surtout indirecte. Elle met en évidence la grande difficulté des autorités helvétiques face aux actions violentes insérées dans ces luttes de décolonisation et de libération. La dimension internationale, la multiplication des niveaux, des acteurs et des actrices, et l’implication d’autres Etats – qui soutiennent et protègent des organisations armées ou participent secrètement à ces actions violentes –, ont rendu quasiment impossible un traitement judiciaire régulier de celles-ci, montrant ainsi les limites de l’entraide internationale face à la défense des intérêts nationaux.
Dans sa conclusion, Carole Villiger apporte des éléments complémentaires en lien avec le choix de l’action violente, son rôle pour les individus et les mouvements qui ont opté pour elle et les réactions de la police et de l’Etat. Après avoir déconstruit le mythe d’une Suisse exempte de violence politique dans l’après-guerre, elle appelle à penser la violence comme une « catégorie mouvante » (p. 268), fruit de multiples facteurs, et dépendante du contexte et du regard porté sur elle, à la croisée des pratiques et des représentations.
A la lecture de cet ouvrage passionnant, l’on note ci et là quelques rares coquilles (quelques dates mal reportées (pp. 67, 154 et 248) et le nom d’une activiste mal orthographié). Ce détail n’entame évidemment pas la qualité de l’ouvrage de Carole Villiger, la richesse de ses sources si difficiles à rassembler, sa maîtrise de la littérature sur les mobilisations collectives, la solidité de son argumentation et ses résultats. Sa recherche représente une nouvelle pierre importante à l’édifice de l’histoire des mouvements sociaux en Suisse au 20e siècle. Sa lecture est d’autant plus recommandée aux personnes nées après la guerre froide, qui n’ont pas connu ces années marquées par des actions violentes et s’étonneront de découvrir une Suisse passablement différente de l’image courante.
Note:
1. Eitan Y. Alimi, Chares Demetriou, Lorenzo Bosi (eds), The Dynamics of Radicalization. A Relational and Comparative Perspective, Oxford 2015; Lorenzo Bosi, Chares Demetriou, Stefan Malthaner (eds), Dynamics of Political Violence. A Process-Oriented Perspective on Radicalization and the Escalation of Political Conflict, Farnham 2014.
Niels Rebetez, H-Soz-Kult, 26.03.2018, www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-28684.
Copyright (c) 2018 by Clio-online and infoclio.ch, all rights reserved. This work may be copied for non-profit educational use if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact hsk.redaktion@geschichte.hu-berlin.de.
Dans Le mouvement social
Au commencement est le mythe tenace d’une Suisse îlot de tranquillité, épargnée par les conflits sociaux et politiques violents. Pour le déconstruire avec beaucoup d’efficacité, Carole Villiger analyse les différents usages de la violence en politique dans la Suisse des années 1960 à aujourd’hui. Son étude repose sur le dépouillement de précieux fonds d’archives dont certains étaient jusqu’alors inexplorés: archives fédérales, archives de l’Institut für Sozialkforschung de Hambourg et nombreux fonds d’organisations ou de militants. Treize entretiens menés dans une diversité de milieux sociaux et politiques concernés par son objet permettent de combiner les échelles et les approches en croisant analyses macropolitiques avec trajectoires individuelles. Ils autorisent une approche du coût individuel durable du recours à la violence, s’agissant en particuliers des condamnés à des peines de prison parfois longues.
Les trois premiers chapitres de l’ouvrage sont consacrés aux actions violentes ayant opposé séparatistes et antiséparatistes dans le canton de Berne à partir des années 1950 et durablement, à celles de l’extrême gauche à partir des années 1960 puis de l’extrême droite qui y recourt à partir du début des années 1980. Deux chapitres abordent ensuite les actions violentes menées en Suisse par les réseaux transnationaux européens entre les années 1970 et 1990 et les « coalitions transversales » qui se nouent autour des mouvements de décolonisation et de libération, avec une attention particulière pour les soutiens que des militants suisses ont apporté à l’une et l’autre. Ces études empiriques s’organisent autour d’une question centrale: pourquoi des mouvements et des individus recourent-ils à la violence? Question qui en appelle aussitôt d’autres: la violence est-elle une ressource parmi d’autres, relevant des répertoires d’action permettant de s’imposer dans l’arène politique institutionnelle, le moyen de donner plus de visibilité à une action? Résulte-t-elle d’un engrenage provoquant une escalade? Est-elle au contraire le fruit d’une démarche théorique ou stratégique qui voit en elle le meilleur moyen sinon le seul efficient? Le recours à la violence par certains mouvements antinucléaires ne contrevient-il pas aux actions menées par ceux qui combattent pour cette même cause, s’inscrivent dans une logique institutionnelle?
La Suisse doit à sa situation carrefour, à son statut et à sa culture politique de présenter certaines spécificités en matière de violence politique. Contrairement à ce que l’on pourrait spontanément penser, la démocratie directe et les instruments institutionnels qu’elle met à la disposition des citoyens n’excluent aucunement le recours à la violence. La nature fédérale de l’État est à l’origine de conflits spécifiques abordés dans le premier chapitre. Les trois ensembles linguistico-culturels qui le composent et la porosité avec les pays frontaliers génèrent des cultures politiques singulièrement disparates parmi les extrêmes gauches et, à moindre titre, les extrêmes droites, avec un répertoire d’action et des usages de la violence qui empruntent à l’Allemagne, à l’Italie ou à la France, en particulier dans les années 1970. Carole Villiger montre ainsi que 80% des actions violentes se sont déroulées en Suisse alémanique, à Zurich en premier lieu, tandis que leur usage demeurait faible en Suisse romane, en épousant là les spécificités françaises analysées par Isabelle Sommier1. La Suisse italienne, dans un entre-deux, a emprunté, pour elle, à la dimension contre-culturelle de la contestation qui s’est imposée en Italie, via les Kommune en particuliers.
La culture politique suisse qui « a privilégié tout au long du XXe siècle une vision d’un petit État entouré de voisins menaçants » répond des approches de la violence par les autorités dont l’analyse constitue un des points forts de l’ouvrage. Carole Villiger, qui s’interroge sur la question de savoir où placer le curseur entre un acte qui est violent et un autre qui ne l’est pas, montre en effet que pour les autorités ou les médias, la violence ne repose pas sur une définition objective mais sur une construction, des faits identiques pouvant être qualifiés ou non de violents par ceux-ci. Du fait de la guerre froide et de la crainte permanente du péril communiste, toute velléité provenant de la gauche est ressentie comme une menace sérieuse pour le pays, induisant là l’usage du terme « terroriste » alors que la tolérance est plus grande quand il s’agit de l’extrême droite ou de mouvements qui, tels les antinucléaires, doivent à leur cause de jouir d’une forte popularité. Ce que les autorités politiques considèrent comme violent de la part des mouvements suisses tient en effet moins à la matérialité des faits ou au degré de violence d’une action qu’à la représentation du danger qu’elles figurent pour l’adversaire, et grande est la variabilité des actions violentes selon qui l’évalue. L’indulgence et le degré de tolérance sont, en regard, d’autant plus grands que les actions violentes et leurs auteurs ne prennent pas pour cible les institutions et cet attribut de l’État qu’est la violence. Ils se réduisent à peu dans le cas contraire et face à ce qui peut être perçu comme une menace pour l’ordre établi, les valeurs traditionnelles et les remises en cause de l’organisation sociale jusque dans la sphère privée, s’agissant par exemple des Kommune. Un même attentat à l’explosif considéré comme l’œuvre d’une jeunesse idéaliste dans les années 1960 peut ainsi être analysé comme « terroriste » dans les années 1980.
La notion de « terrorisme » connaît, montre l’auteur, les mêmes variations. Les séparatistes et antiséparatistes, qui mobilisent pourtant un répertoire aussi violent que l’extrême gauche, ont rarement été considérés comme des terroristes. À partir de 1970, l’extrême gauche est au contraire systématiquement affublée de cette notion sans qu’elle ait fait l’objet de la moindre définition. Carole Villiger cite ainsi un commissaire de police écrivant en 1985: « il existe presque autant de définitions [du terrorisme] que d’auteurs. Je pars cependant du principe assez évident que nous savons de quoi nous parlons ». L’usage du terme est inexistant s’agissant de l’extrême droite.
Les actions abordées dans les chapitres 4 et 5 doivent à la richesse des fonds archivistiques qui ont été consultés d’apporter des éléments précieux à l’histoire de certains conflits externes projetés sur le sol de la Suisse. Retenons, parmi bien des exemples, les éléments apportés sur la Main rouge, cette organisation fictive créée par le SDECE au début des années 1950 pour dissimuler ses activités homicides. Le point de vue des autorités dépend là encore de la nature des auteurs plus que de la matérialité des faits qualifiés de violents, écrit Carole Villiger qui montre comment leur approche et leur traitement sont surdéterminés par les relations internationales, répondant d’une évidente indulgence quand la violence vise le consulat espagnol à l’époque franquiste, de fluctuations s’agissant d’actions violentes en lien avec la guerre d’Algérie, selon qu’on est avant ou après 1956, etc. Atteinte par les retombées de la plupart des conflits qui secouent la planète (palestiniens, arméniens…) et peinant à trouver un traitement adéquat à la diversité de ces mouvements, la Suisse adhère à un système commun européen au début des années 1980 « pour empêcher qu’elle ne devienne le refuge des terroristes européens ». Sans modification radicale de la situation.
C’est assez dire que cette analyse des cultures politiques en Suisse via la question de la violence déborde à plus d’un titre son champ d’observation. L’ouvrage de ce pays carrefour est une étude des circulations culturelles et physiques, soulignant en permanence la porosité des frontières, qu’il s’agisse des frontières internes à cet État fédéral qu’est la Suisse, de ses frontières avec les pays voisins, des frontières entre les extrêmes gauches et les extrêmes droites ou des frontières sémantiques. Il autorise et requiert en permanence une réflexion conceptuelle sur les notions de violence, de terrorisme ou d’extrémisme, dont Carole Villiger montre qu’elle varie selon les historiographies allemandes, anglo-saxonnes et françaises. Réflexion dont il est sans doute inutile de préciser ici l’urgence et l’importance.
Note : 1. La violence politique et son deuil. L’après 68 en France et en Italie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998.
Danielle Tartakowsky, Le mouvement social, 2018.
La Suisse, violente?
L’historienne Carole Villiger vient de publier un ouvrage questionnant les usages politiques de la violence en Suisse dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui évoque tant les actions violentes de mouvements d’extrême gauche que celles de groupes d’extrême droite ou encore des séparatistes jurassiens. Entretien.
Pourquoi réfléchir aux usages de la violence en politique?
Après un livre sur le mouvement de libération des femmes, j’ai voulu continuer à réfléchir à l’histoire des luttes politiques en Suisse et approfondir la question du répertoire d’action à disposition des mouvements en évoquant l’utilisation de la violence comme moyen de revendication.
Comme le discours dominant prétend qu’il n’y a pas eu de violences politiques dans l’histoire récente de la Suisse, j’ai d’abord dû me demander si c’était vraiment le cas, ou si ce n’était pas plutôt que l’histoire de cette violence n’eût jamais été faite. Après avoir constaté en dépouillant la presse de l’époque qu’il y avait bel et bien eu des violences politiques en Suisse aussi, j’ai également dû me défaire de l’idée que cette violence était uniquement liée aux mouvements d’extrême gauche, ce qui est loin d’être le cas.
Je suis donc partie d’une définition empirique assez large de la violence, pour pouvoir circonscrire les actions que j’analyserais sans a priori sur les actrices·eurs concernés, car je voulais précisément démontrer qu’il n’y a pas de définition fixe de la violence politique, mais qu’elle varie en fonction du contexte, de qui a le pouvoir de définir l’autre comme violent et des représentations que l’on s’en fait.
Comment les autorités réagissent-elles face à ces protestations violentes?
En étudiant une palette de mouvements politiques de différentes tendances, j’ai pu montrer que les autorités politiques ont eu un traitement différencié des actions
violentes: les mouvements jurassiens ou l’extrême droite n’ont ainsi jamais été qualifiés de « terroristes », terme réservé à l’extrême gauche dans le discours de la police fédérale de l’époque, et c’est donc l’extrême gauche qui a été réprimée le plus durement. Cela s’explique en grande partie par le contexte de guerre froide et
la peur que les autorités politiques avaient du communisme. Mais on remarque aussi qu’il y a parfois des différences d’appréhension au sein même de la police: dans les archives de la police fédérale, une même personne pouvait ainsi être qualifiée à Zurich de « terroriste » et à Genève de « dissident·e ».
Pourquoi l’image d’une Suisse paisible et sans violence persiste-t-elle?
La Suisse aime donner cette image de démocratie directe « modèle », de pays pacifié et non violent, alors que ça n’a jamais été le cas. Ce mythe justifie une sorte de déni, et renvoie vers l’extérieur tout ce qui le contrarie. C’est vrai pour les mouvements d’extrême gauche, longtemps perçus comme des satellites de l’URSS, mais aussi pour l’extrême droite: alors que son niveau de violence en Suisse a été comparable à celui des pays voisins, on l’évoque souvent dans les médias comme une violence importée de skinheads allemands, qu’on ramène ainsi à « l’Est », voire à des personnes qui auraient mal vécu la chute du mur et développeraient donc un extrémisme de droite…
Le fait que des mouvements en arrivent à exprimer des exigences politiques par le biais d’actions violentes questionne la réalité de cette démocratie directe qui éviterait toute violence en proposant un pouvoir proche du peuple. Cela révèle que les outils disponibles pour exprimer une revendication ne fonctionnent pas,
parce qu’une initiative populaire coûte très cher et qu’il est difficile de récolter les signatures sans l’aide d’un grand parti politique. La démocratie directe ne fonctionne que pour celles et ceux qui ont les moyens de s’en servir.
On constate dans ton livre qu’il y a eu plus d’activistes mort·e·s en prison que de personnes tuées par des groupes violents, que cela révèle-t-il de la violence d’État?
Si je me suis interrogée sur les interactions entre les mouvements politiques et l’État, c’est aussi parce que cela permettait de montrer les raisons pour lesquelles un mouvement fait le choix de l’action politique violente à un moment donné, de voir ce qu’il y avait en amont, et ainsi de questionner la violence de l’État, qui est sinon difficile à circonscrire empiriquement.
J’ai voulu m’intéresser aux militant·e·s mort·e·s en prison, mais il est difcile d’avoir des chiffres exacts et de trouver des archives. Dans une affaire que j’ai étudiée, qui voit une jeune militante détenue dans des conditions difficiles se suicider en prison, les archives ont disparu, il y a un trou…
Mais cette violence-ci de l’État est identifiable et fait partie de la pointe de l’iceberg, comme la répression des manifestations. Il ne faut pas oublier toute la violence qui est invisible, notamment la violence de la surveillance politique, qui peut empêcher celles et ceux qui y sont soumis de trouver du travail ou un appartement.
Propos recueillis par Gabriel Sidler, Pages de gauche, No 166, hiver 2017-18, p. 20.
Une Suisse loin d’être si tranquille
Dans son livre Usages de la violence en politique, Carole Villiger a répertorié et documenté les actions politiques violentes en Suisse de 1950 à 2000. Un ouvrage qui remet en question l’image d’un pays paisible et pacifié.
On connaît les Brigades rouges italiennes, la Fraction Armée Rouge allemande ou en encore l’ETA au pays Basque, mais pendant ces années, que se passait-il en Suisse, généralement présentée comme un havre de paix? C’est la question que s’est posée Carole Villiger, docteure en Histoire contemporaine, qui nous dévoile une Suisse plus agitée qu’on voudrait bien le croire.
Elle nous rappelle ainsi que rien que de 1963 à 1964, le Front de libération du Jura a planifié une dizaine d’attentats à l’explosif contre des cibles liées à des intérêts bernois. Dans les années 70, les confrontations entre séparatistes et antiséparatistes jurassiens provoquent des dizaines de blessés. À la même époque, de nombreuses altercations ont lieu entre l’extrême gauche et les forces de l’ordre, notamment dans le cadre de la revendication d’un centre autonome à Zurich (la Rote Fabrik, ouverte en 1981). Dans les années qui suivent, des cibles matérielles représentant l’État et les institutions comme des chars militaires, des wagons CFF ou encore des postes de police sont plastiqués et des locaux de partis politiques incendiés par des groupes d’extrême gauche. La maison d’un conseiller fédéral est même visée par un cocktail molotov. Dès les années 70, les mouvements antinucléaires recourent eux aussi à la violence, visant des centrales ou des pylônes électriques et générant des centaines de milliers de francs de dégâts. Des lettres contenant des explosifs sont envoyées à des parlementaires et une menace de bombe au parlement fédéral génère son évacuation. Enfin, l’extrême droite a elle aussi recours à la violence et des mouvements extérieurs (Palestiniens et Arméniens notamment) agissent sur le territoire suisse. Retour sur cette période mouvementée avec l’auteure.
La démocratie directe Suisse a parfois été présentée comme un barrage à l’utilisation de la violence politique dans notre pays. Votre ouvrage remet en question cette idée…
Carole Villiger Il existe en effet un mythe d’une Suisse qui n’aurait pas vécu de violences. Ce mythe est notamment lié à la démocratie directe. La participation qu’elle permet a sans doute un impact sur l’usage de la violence, mais ce n’est pas la solution miracle. Et puis il y a une différence entre théorie et pratique. Dans les faits, lancer une initiative ou un référendum demande beaucoup de moyens matériels et sans l’appui d’un parti politique, cela peut s’avérer très compliqué.
Comment définissez-vous une action violente?
Cette définition est subjective. En outre, la question de la légitimité de la violence se pose: l’Etat détient le monopole de la violence, mais elle n’est pas nommée comme telle. La définition d’une action violence dépend donc de qui juge, de qui parle. Pour ma part, dans un objectif empirique, j’ai étudié les actions qui ont provoqué des dégâts matériels et/ou humains en dépit d’une résistance.
Enfin, l’extrême droite a elle aussi recours à la violence et des mouvements extérieurs (Palestiniens et Arméniens notamment) agissent sur le territoire suisse. Retour sur cette période mouvementée avec l’auteure.
La démocratie directe Suisse a parfois été présentée comme un barrage à l’utilisation de la violence politique dans notre pays. Votre ouvrage remet en question cette idée…
Carole Villiger: Il existe en effet un mythe d’une Suisse qui n’aurait pas vécu de violences. Ce mythe est notamment lié à la démocratie directe. La participation qu’elle permet a sans doute un impact sur l’usage de la violence, mais ce n’est pas la solution miracle. Et puis il y a une différence entre théorie et pratique. Dans les faits, lancer une initiative ou un référendum demande beaucoup de moyens matériels et sans l’appui d’un parti politique, cela peut s’avérer très compliqué.
Comment définissez-vous une action violente?
Cette définition est subjective. En outre, la question de la légitimité de la violence se pose: l’État détient le monopole de la violence, mais elle n’est pas nommée comme telle. La définition d’une action violence dépend donc de qui juge, de qui parle. Pour ma part, dans un objectif empirique, j’ai étudié les actions qui ont provoqué des dégâts matériels et/ou humains en dépit d’une résistance.
L’utilisation de la violence est-elle la même pour tous les groupes que vous avez étudiés?
Les organisations d’extrême gauche ont été attentives à ne pas provoquer de dégâts humains. Elles ont par exemple jeté des cocktails molotov contre des prisons pour protester contre la détention de militants. Du coté des groupes d’extrême droite en revanche, ce type de réflexion est absent. La violence fait plus partie de leur identité. Ils se sont beaucoup attaqués à des immigrés, provoquant des morts notamment suite à l’incendie de centres de réfugiés ou lors de ratonnades contre des migrants sri-lankais. Dans le cadre du conflit jurassien, les séparatistes étaient aussi attentifs à éviter les dégâts humains. Lors de l’apparition du groupe sanglier (antiséparatiste), le niveau de violence a cependant augmenté. La rencontre des deux groupes a provoqué des blessés par balles, des batailles rangées, etc.
Qu’est-ce que l’utilisation de la violence a apporté à ces groupes? Pourquoi l’ont-ils utilisée?
Utiliser la violence permet d’attirer l’attention des médias et de porter ainsi ses revendications à un niveau beaucoup plus large. Cela peut permettre d’ouvrir un espace de discussion qui était fermé ou que l’on en parvenait pas à ouvrir par la voie institutionnelle. La violence peut cependant aussi jouer un rôle « interne ». Elle permet de s’imposer comme une organisation crédible parmi d’autres, ou de se rattacher à une identité internationale. Les skinheads d’extrême droite par exemple ont utilisé la violence comme symbole de rupture avec l’ordre social, se rattachant ainsi à une identité internationale. Cela leur a permis notamment de recruter.
Vous constatez également que la réponse des autorités n’est pas la même suivant le type de mouvement.
Effectivement, l’extrême gauche a été beaucoup plus surveillée et réprimée que les autres mouvements. Cela s’explique notamment par le contexte de guerre froide. Il régnait une peur de tout ce qui venait de l’est et un fort sentiment anticommuniste. Avec la multiplication d’attentats en Europe et ailleurs, les actions de l’extrême gauche ont également progressivement été vues de façon bien plus sévère par les autorités politiques.
Un exemple parlant est celui d’un article vantant les mérites du pacifisme et de l’objection de conscience, publié dans un journal étudiant de gauche. Ses auteurs ont été qualifiés de « terroristes » par la police fédérale, alors qu’ils n’avaient provoqué aucun dégât matériel ou humain ni effectivement refusé de servir dans l’armée. L’assassinat d’un réfugié par un militant d’extrême droite n’a en revanche pas été qualifié de terroriste et d’une façon générale, l’extrême droite a été beaucoup moins surveillée, malgré son usage de la violence et la dimension politique de ses activités. Les milieux antinucléaires ont également été moins sévèrement réprimés, alors qu’ils utilisaient un répertoire d’action relativement violent. Ils ne remettaient toutefois pas en cause l’autorité de l’État.
La répression ne dépend donc pas toujours du degré de violence des faits…
Effectivement, elle dépend surtout des représentations de la menace. Les autorités politiques au pouvoir définissent ce qui est estimé dangereux et ce qui ne l’est pas, sans que cela dépende forcément de faits concrets.
L’utilisation de la violence par les groupes que vous avez étudiés a aujourd’hui fortement diminué. La Suisse est-elle enfin devenue le havre de paix qu’elle prétend être?
Sans être spécialiste de la période actuelle, je dirais que les mouvements extraparlementaires de gauche se sont transformés en groupes de défense de causes précises, comme les droits des réfugiés. Les groupes autonomes sont toujours présents, notamment lors de sommets internationaux, mais ils ne planifient plus d’attentats. L’objectif de la lutte a aussi changé. Il ne s’agit plus de viser l’État centralisateur, qui n’est pas seul à détenir le pouvoir et permet aussi de défendre certains acquis sociaux, mais de créer une contre-société (squats, centres autonomes, économie participative, culture alternative, etc). Quant aux mouvements d’extrême droite, ils existent toujours mais sont plus discrets. Une partie de leurs revendications a été reprise par certains partis politiques au niveau des institutions.
Un ouvrage comme le vôtre permet-il d’éclairer l’utilisation de la violence par les mouvements djihadistes actuels?
Cela n’est pas du tout le même niveau de violence, les mêmes revendications et la même organisation, la comparaison est donc délicate. Cela dit, je constate dans mon livre que les autorités se sont toujours efforcées de présenter les menaces violentes comme venant de l’extérieur, maintenant ainsi l’illusion d’une Suisse protégée des effusions de sang. Cette volonté de dépeindre l’ennemi comme provenant de l’extérieur persiste aujourd’hui, occultant les inégalités créées par la société même. Pourtant, en France, les terroristes qui ont agi sur le territoire étaient souvent des nationaux issus de générations d’immigrés vivant dans des ghettos sans véritables perspectives d’avenir.
Propos recueillis par Juliette Müller, Gauchebdo, 4 juin 2017.