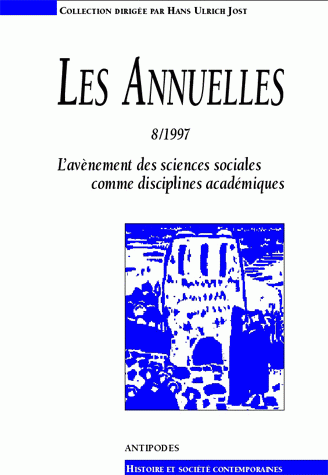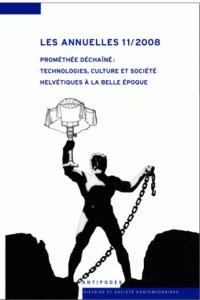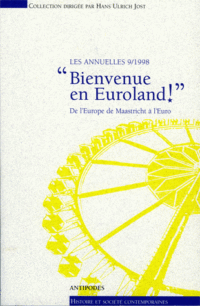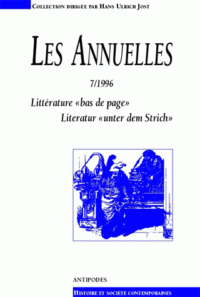Les Annuelles 8/1997,
L'avènement des sciences sociales comme disciplines académiques
Le Dinh, Diana,
1997, 237 pages, 14 €, ISBN:2-940146-06-3
Les sciences sociales, qui en sont venues à faire partie intégrante de la modernisation des sociétés occidentales, émergent, vers la fin de XIXe siècle, dans la division du travail académique en tant que champ spécifique du savoir. Cet avènement institutionnel ressortit à de nombreuses déterminations, d’ordre aussi bien politique, économique et social, que scientifique ou professionnel. Le présent numéro se propose d’explorer les dynamiques à l’oeuvre dans la constitution de ces discours, en Suisse mais aussi en France, et de mettre en évidence leur ancrage pluriel, facteur de réalités disciplinaires multiples. Face à leur complexité, il s’agit en effet d’appréhender les sciences sociales dans tous leurs avatars, en tenant compte des contours flous et mouvants qui sont les leurs, à une époque où, selon le mot d’un contemporain, elles sont encore, du moins en tant que groupe, « affectées d’une singulière impuissance à se définir elles-même ».
Description
Les sciences sociales, qui en sont venues à faire partie intégrante de la modernisation des sociétés occidentales, émergent, vers la fin de XIXe siècle, dans la division du travail académique en tant que champ spécifique du savoir. Cet avènement institutionnel ressortit à de nombreuses déterminations, d’ordre aussi bien politique, économique et social, que scientifique ou professionnel. Le présent numéro se propose d’explorer les dynamiques à l’oeuvre dans la constitution de ces discours, en Suisse mais aussi en France, et de mettre en évidence leur ancrage pluriel, facteur de réalités disciplinaires multiples. Face à leur complexité, il s’agit en effet d’appréhender les sciences sociales dans tous leurs avatars, en tenant compte des contours flous et mouvants qui sont les leurs, à une époque où, selon le mot d’un contemporain, elles sont encore, du moins en tant que groupe, « affectées d’une singulière impuissance à se définir elles-même ».
Table des matières
- Introduction: Pour une histoire sociale des sciences sociales (Diana Le Dinh)
- Mémoire disciplinaire et légitimation scientifique. La science politique en Suisse (Bernard Voutat, Pierre-Antoine Schorderet, Philippe Gottraux)
- Entre normativisme et empirisme: les sciences morales et politiques en France et leur institutionnalisation académique, XIXe-XXe siècles (Corinne Delmas)
- Sciences sociales et logiques de gestion (Diana Le Dinh)
- Pensée économique et institutions académiques en Suisse au XIXe siècle (Hans Ulrich Jost)
- La reconstruction d’une tradition oubliée: les débuts précoces de la sociologie en Suisse (Markus Zürcher)
- Les débuts de la pédagogie comme discipline universitaire. L’exemple de Genève, 1890-1916 (Rita Hofstetter, Bernard Schneuwly)
- Fenêtre: Le passé au présent. Tradition, mémoire et histoire dans les sciences sociales (Bertrand Müller)
- Document: Les premiers pas de la Société du Mont-Pèlerin ou les dessous chics du néolibéralisme (Cécile Pasche, Suzanne Peters)
Presse
Quand William E. Rappard et ses amis fondaient l’internationale néoliberale au Mont-Pèlerin
Le monde est aujourd’hui soumis à la loi du neolibéralisme. Victorieux sur tous les fronts, il a longuement mûri, il y a 50 ou 60 ans, dans les universités de Chicago, Londres et Genève. Un de ses promoteurs fut le professeur William E. Rappard. Histoire courte.
La section d’histoire contemporaine dirigée par Hans Ulrich Jost à l’Université de Lausanne publie une fois l’an « Les Annuelles », recueil de travaux récents proposés par les étudiants et les enseignants de l’institut. Chaque livraison recèle quelque article propre à stimuler la curiosité. C’est le cas, dans le dernier volume, de l’étude de Cécile Pasche et Suzanne Peters intitulée « Les premiers pas de la Société du Mont-Pèlerin ou les dessous chics du néolibéralisme ». Elle nous dévoile une étonnante page d’histoire qui s’est déroulée dans la Suisse de l’immédiat après-guerre. Une page d’histoire qui éclaire d’un jour trop vif l’actualité politique, économique et sociale d’une planète soumise à la toute-puissante hégémonie de la pensée néolibérale.
Cela se passe en avril 1947. Il n’y a même pas deux ans que la guerre mondiale est finie. L’Europe sort d’un hiver particulièrement difficile: mi-février, les Etats-Unis ont livré d’urgence 200’000 tonnes de blé à une France encore sujette à la faim. Le climat politique n’est pas bon non plus. En mars, à Moscou, les vainqueurs de Hitler ne parviennent pas à s’accorder sur le futur d’une Allémagne en ruines.
Pourtant, le ler avril, 37 personnes venues d’Europe et d’Amérique prennent à Vevey le funiculaire du Mont-Pèlerin pour gagner l’Hôtel du Parc, un palace début de siècle au confort douillet avec vue sur le Léman, les Alpes et le Jura. Le choix de cet hôtel ne doit rien au hasard: une notabilité genevoise, William E. Rappard, l’a proposé à l’organisateur de la réunion, Friedrich A. von Hayek, avec garantie de tranquillité et de discrétion.
Ces gens sont réunis pour échanger leurs idées sur la politique et l’économie. Dans leur quasi-totalité, les participants à ce colloque de dix jours sont des professeurs d’économie pratiquant à l’université de Chicago, à la London School of Economics ou à l’Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI) de Genève. Quelques philosophes – dont Bertrand de Jouvenel et Karl Popper – se sont mêlés au groupe qui -ne compte qu’une femme, une historienne britannique.
Ces personnalités sont alors des marginaux peu suivis dans leurs disciplines, mais au fil des années ils acquerront notoriété et pouvoir sanctionnés notamment par des Prix Nobel: Friedrich A. von Hayek (1974), Milton Friedman (1976), Georges J. Stigler (1982), Maurice Allais (1988).
Parmi les invités figurent les fondateurs de l’Ecole de Chicago, les maîtres de la London School of Economics et les têtes pensantes de l’IUHEI genevois dont W E. Rappard et Wilhelm Röpke, un économiste allemand antinazi réfugié à Genève. Tous partagent une foi absolue en l’idéal libéral dont la traduction en économie s’appelle libre-échangisme et en politique hantise d’une mainmise socialiste sur la société. Mais – nuance! – les « socialistes » honnis ne sont pas que les communistes en train de prendre les commandes de l’Europe de l’Est. Les hôtes de l’Hôtel du Parc vouent la même aversion aux démocrates américains qui persistent à appliquer les préceptes du New Deal rooseveltien, aux travaillistes anglais qui nationalisent à tour de bras, aux planificateurs en tous genres qui pensent que Keynes n’est pas un sot. Il est vrai que depuis le désastreux jeudi noir d’octobre 1929, le dirigisme s’est imposé en économie pour tenter d’en maîtriser les cycles cataclysmiques. Et au lendemain de la guerre mondiale, il n’est pas un gouvernement au monde qui ne se reconnaisse le droit et le devoir d’intervenir en économie.
Nous n’allons pas faire ici l’histoire de cette internationale néolibérale qui, faute de mieux, décida de s’appeler Mount-Pèlerin Society (MPS) en l’honneur de ce premier rendez-vous. Signalons simplement que son initiateur, E A. von Hayek, était désireux, selon les termes d’une lettre adressée à Rappard le 13 février 1947, d' »élaborer au moyen d’un effort continu une philosophie de la liberté qui puisse fournir une alternative aux opinions politiques actuellement dominantes Notre effort diffère d’une tâche politique en cela qu’il doit, essentiellement se concentrer sur le long terme. » Pour ce faire, il s’agit de créer un réseau de personnalités, elles-mêmes insérées dans d’autres réseaux et choisies par cooptation. Au début, la discrétion est de mise: la MPS n’apparaîtra publiquement qu’en 1959, douze ans après sa fondation. Effe tient une assemblée générale tous les deux ans et ne retournera au Mont-Pèlerin qu’en avril 1997, pour célébrer son cinquantième anniversaire. Aujourd’hui, la MPS compte quelque 500 membres qui fréquentent aussi Davos, autre symbole helvétique du libéralisme.
En 1947, Hayek prônait patience et fermeté des convictions dans un monde qu’il reconnaissait comme peu favorable à ses thèses. Sa longévité lui permit tout de même de savourer d’impressionnants succès. Après le coup d’envoi donné dès 1973 par ses Chicago Boys dans le Chifi de Pinochet, il put suivre les expériences de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de divers Etats latino-américains et enfin la conversion de l’Europe septentrionale et social-démocrate à ses thèses. Il eut encore le temps de voir, avant de mourir en 1992 à l’âge de 93 ans, la chute du système soviétique et la propagation fulgurante du néolibéralisme en Europe de l’Est.
William E. Rappard est disparu trop tôt pour éprouver ces satisfactions. D’ailleurs les eût-il éprouvées? Mort en 1958, Rappard n’a pas échappé au syndrome de la grande peur helvétique qui vit le pays et ses élites se hérissonner de manière quasi maladive contre toute pollution idéologique pouvant venir de l’Est. Au moment où il siège au Mont-Pèleri avec von Hayek et les autres, Rappard est en train d’écrire un de ses ouvrages majeurs, La Constitution fédérale de la Suisse 1848-1948 dans lequel il prend acte du rôle toujours plus important de l’Etat en soulignant que cette évolution « paraît aboutir inévitablement à la restriction de la liberté individuelle et à l’extension de ce qu’on est convenu d’appeler la sécurité sociale ».
Ce pragmatisme typique de la confusion des valeurs engendrée par la guerre froide conduit Rappard à reconnaître en la neutralité le dogme intangible qui sera à la base de la politique suisse pendant le demi-siècle à venir. Cette soumission au dogme le pousse non seulement à prôner le refus de participer à l’ONU ou à l’OTAN, mais aussi à piétiner ses convictions en conseillant, à la Suisse de se tenir à l’écart de la Communauté du charbon et de l’acier (CECA), embryon de l’Union européenne.
Or, quelques années plus tôt, il défendait des idées différentes. Ainsi, cet antinazi convaincu explique en décembre 1934 (à 51 ans, il a alors dépassé l’âge des sophismes adolescents) qu’il ne saurait mêler sa voix à ceux qui condamnent Hitler parce que « s’il plait aux Italiens ou aux Allemands de se donner ou de se laisser imposer un régime exclusif de liberté, c’est mon amour meme de la liberté qui m’empêche de faire ce qui dépend de moi pour m’y opposer ».
Professeur à l’Université de Genève depuis 1913, Rappard était un notable libéral. En pleine guerre, en 1941, il se laisse tenter par la politique active. Une élection complémentaire organisée pour repourvoir les sièges devenus vacants suite à l’exclusion des socialistes de gauche Nicole et Dicker du Conseil national donne l’occasion à Rappard de tâter du suffrage universel. Or, il choisit non pas la droite classique, mais l’Alliance des Indépendants, le parti de Gottlieb Duttweiler, fondateur de la Migros, épouvantail vivant de tout ce que la Suisse d’alors compte de politiciens ronronnants.
Les raisons de ce ralliement apparemment contre nature? « L’Alliance entend obliger le capitalisme à jouer le jeu concurrentiel dont il prétend tirer sa légitimité sociale tandis que les autres partis acceptent, en l’aidant à cet effet, qu’il annule ou réduise les risques de ce jeu pour n’en garder que les profits ou les avantages » Les principes encore, mais avec quel panache! La droite radicale et libérale fait front commun contre lui. Le Journal de Genève le traite de crypto-communiste et lui donne de « l’homme de paille distingué au service d’une épicerie confédérée ». Rappard gagne haut, la main, mais l’expérience sous la coupole fédérale sera brève. Deux ans plus tard, il se brouille avec Duttweiler et ne se représente pas.
Par son envergure intellectuelle, par le réseau étendu de ses relations, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, Rappard est un expert de politique internationale. S’on avis est fréquemment sollicité et ses jugements sont tranchés, même s’il les garde en son for intérieur – nous les connaissons aujourd’hui grâce à sa correspondance. Il ne cache pas sa méfiance envers Marcel Pilet-Golaz, chef très ‘controversé de notre diplomatie pendant la guerre. Il doute même sérieusement des capacités politiques du chef du DFAE. Son réalisme l’amène à de cruelles considérations: «N’est-il pas évident à tout esprit non prévenu, écrit-il en 1942, que la Suisse, petit pays neutre entouré en fait par un seul belligérant, et seul des pays voisins de l’Allemagne qu’elle n’ait pas occupés jusqu’ici, n’est pas en fait le maître de sa politique? La contrainte politique et stratégique qui pèse sur nous est, à vrai dire, la seule explication et la seule excuse de notre attitude. Mais l’avouer paraît à ces messieurs de Berne faire preuve d’un manque de dignité nationale. Grâce à un certain patriotisme de tir fédéral, ils aiment mieux mettre leurs abdications sur le compte du libre exercice de leur souveraineté que sur celui de leur impuissance. Il n’en résulte nullement une plus grande autonomie effective, mais au contraire une servilité d’autant moins glorieuse qu’elle se donne pour volontaire.»
L’homme, on le voit, ne manquait pas de souffle, mais comme la droite helvétique dont il fut un penseur éminent, il se laissa piéger sur le tard par un conservatisme paralysé par la peur de l’usage des libertés.
Ce conservatisme d’essence autoritaire permit aux valeurs libérales fondamentales de s’accommoder de la mise en fiche des citoyens au mépris des droits et libertés de l’individu. Les principes de l’économie de marché furent bafoués par des ententes cartellaires qui faussèrent (et, souvent, faussent encore) les règles du marché. La guerre froide terminée par désintégration du système communistete, la gauche et la droite classiques se retrouvèrent aussi démunies l’une que l’autre, pour le plus grand bonheur des adeptes de la Mount-Pèlerin Society qui peuvent ainsi occuper seuls le terrain dans le cadre d’une vaste reconquête néolibérale. Pour rétablir et défendre les valeurs libérales fondamentales et les principes de l’économie de marché? L’avenir nous le dira.
Gérard Delaloye, Le Nouveau Quotidien, 26.2.1998
Le « marché libre » est né dans un palace vaudois, en 1947
Origines du libre-échange. L’hôtel Le Mirador, ancien hôtel du Parc au Mont-pèlerin, abrita les premières amours du néolibéralisme.
Une idée fort répandue veut que le néolibéralisme économique et la libre circulation des biens sont aussi naturels que le soleil après la pluie. C’est une idée fausse: le néolibéralisme actuel a été voulu et planifié il y a plus d’un demi-siècle. Son acte de naissance à été signé en Suisse dans un hôtel du Mont-Pèlerin au-dessus de Vevey en avril 1947.
A l’époque, l’évidence économique est celle du rôle de l’Etat. Il triomphe dans le modèle communiste en URSS et dans les pays de l’Est. Il joue un rôle moteur dans les grands travaux de Roosevelt-dans l’Amérique ruinée par la dépression de 1929-et dans l’Etat providence (le Welfare State) des travaillistes anglais.
Jusqu’à Mitterand
L’Europe de l’après-guerre croit que la production doit être planifiée par les grands commis de l’Etat, qui assurent également la protection sodale des citoyens. En 1981 encore, Mitterrand devient président avec un « programme commun » de la gauche qui prévoit d’importantes nationalisations et l’intervention de l’Etat dans la relance économique.
C’est dire que le libéralisme, en 1947, n’est pas à la mode. La quarantaine d’invités bon chic, bon genre qui prennent le funiculaire du Mont-Pèlerin, le 1er avril de cette année-là, en sont conscients. Ils s’installent à l’hôtel du Parc, devenu aujourd’hui « Le Mirador », magnifique terrasse sur le Léman, les Alpes et le Jura. Un balcon sur l’Europe qui répond bien au rôle que ces hommes entendent jouer.
Le genevois Rappard
Ils viennent de Londres, Genève, Vienne et Chicago, quatre noms qui dessinent alors la carte mondiale du libéralisme. A Vienne, ce sont les enseignants de l’Institut autrichien de recherches économiques, avec son directeur Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, alors jeune chercheur. Celui-ci est invité en 1931 à Londres par la London School of Economics, deuxième forteresse libérale, qui est dirigée par Lionel Robbins. C’est un grand ami du Genevois William Rappard, directeur de l’Institut universitaire des hautes études internationales à Genève.
Quatrième pilier, l’Ecole de Chicago a été fondée dans les années 30. Elle envoie des personnalités d’avenir comme Milton Friedmann et George Joseph Stigler. Friedmann sera Prix Nobel d’économie en 1976, Stigler en 1982. Lionel Robbins l’avait déjà reçu en 1972, Hayek en 1974. C’est dire l’envergure des invités au Mont-Pèlerin: un quart de siècle plus tard, leurs théories ne sont pas seulement primées, mais les « Chicago’s boys », comme, on les appellera, vont inspirer les politiques libérales de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Juste retour des choses, le siège de l’OMC à Genève porte le nom de « Centre William Rappard »…
Une société très discrète
En 1947, rien n’est encore gagné. Les débats débouchent sur la création d’une association qui prend le nom de « Société du Mont-Pèlerin ». Pas vraiment une société secrète, mais très discrète: les membres sont choisis par cooptation, les débats ne sont pas publics, le financement non plus.
Les membres savent ce qu’ils veulent: détendre la liberté individuelle, aussi bien économique que politique. Le prestige du libéralisme doit être relancé par un gros effort intellectuel, par la création de réseaux qui diffuseront ces idées dans les universités et l’opinion publique. La Neue Zürcher Zeitung, par exemple, est représentée à Vevey par son rédacteur en chef Willy Bretscher, et elle publiera de nombreux articles signés par les membres de l’honorable société.
L’idée est de travailler sur le long terme. Comme dit Hayek: « S’agissant des affaires courantes, l’influence directe du philosophe politique peut être négligeable. Mais quand ses idées sont devenues d’usage commun grâce au travail des historiens et publicistes, des enseignants et écrivains, et des intellectuels en général, elles guident effectivement les événements ». Prophète, Hayek annonce qu’il faudra une génération pour que ses idées triomphent.
L’idéal socialiste attire
Mais ont-ils vraiment gagné? La Société du Mont-Pèlerin existe toujours, elle compte aujourd’hui 500 membres, le gratin de l’économie mondiale. Ils se sont retrouvés au Mont-Pèlerin en avril 1997, pour fêter leur cinquantième anniversaire. Il y avait là Milton Friedmann, un des rares rescapés de la première session. A en croire la NZZ du 3 mai 1997, l’ambiance était moins triomphale que critique: le socialisme a échoué sur le terrain, mais l’idéal socialiste attire toujours. Le modèle libéral, au contraire, a mauvaise presse. De même, si l’Etat a renoncé à l’économie planifiée, il est toujours aussi envahissant, en particulier dans sa volonté de taxer les revenus. Bref, d’après Friedmann, « on serait moins libre aujourd’hui qu’en 1947 »!
Patrice Favre, Le Courrier 3.12.99 – La Liberté 30.11.99