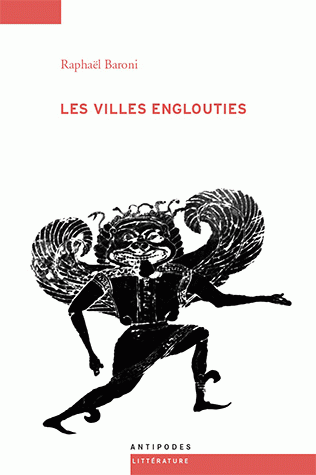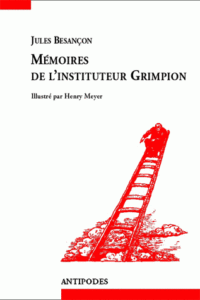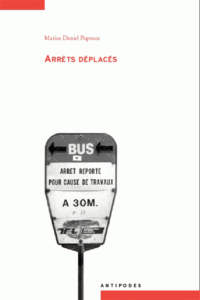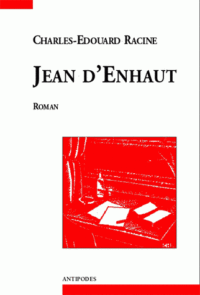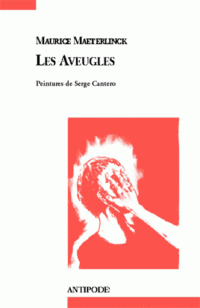Les villes englouties
Baroni, Raphaël,
2011, 195 pages, 18 €, ISBN:978-2-88901-045-5
Serions-nous encore un être moral si nous possédions un pouvoir consistant à nous faire oublier des autres et de nous-mêmes? Si nos aspirations contradictoires trouvaient leur satisfaction, serions-nous encore capables de discerner le rêve de la réalité? La lecture est-elle une contagion et partageons-nous les crimes que nous lisons? À quoi ressemblerait la mort si nous pouvions lui serrer la main? La perte du langage serait-elle un retour au Paradis, une Chute ou autre chose par-delà le bien et le mal?
Description
Serions-nous encore un être moral si nous possédions un pouvoir consistant à nous faire oublier des autres et de nous-mêmes? Si nos aspirations contradictoires trouvaient leur satisfaction, serions-nous encore capables de discerner le rêve de la réalité? La lecture est-elle une contagion et partageons-nous les crimes que nous lisons? À quoi ressemblerait la mort si nous pouvions lui serrer la main? La perte du langage serait-elle un retour au Paradis, une Chute ou autre chose par-delà le bien et le mal?
Oscillant entre essais et contes, ces récits explorent des régions inaccessibles à la raison, comme une pensée itinérante faisant glisser ses concepts, les faisant déborder le temps d’un voyage dans des villes englouties.
Presse
Le récit, forme et force
Raphaël Baroni, auteur de plusieurs volumes parus dans la prestigieuse collection « Poétique » aux éditions du Seuil (La Tension narrative, 2007; L’Œuvre du temps, 2009), est un des théoriciens du récit les plus importants d’aujourd’hui. Il s’est notamment distingué par ses lectures du « suspense » narratif et, plus généralement, du récit non pas comme structure achevée mais comme le dialogue pas à pas avec un lecteur qui ne connaît pas encore la fin de l’histoire.
À l’instar d’Umberto Eco, lui aussi séduit par la création après une longue période de réflexion théorique, Raphaël Baroni est devenu l’auteur de textes de fiction, dont un premier ensemble a été réuni dans Villes englouties (Lausanne, éd. Antipodes, 2011). On connaît les dangers auxquels s’exposent les théoriciens qui prennent la plume. Ou bien ils scindent carrément les deux pans de leurs activités, produisant des fictions qui ne sont pas à la hauteur de leurs travaux théoriques. Ou bien, ayant peur de se laisser aller et craignant de rester en deçà de leurs propres exigences, ils deviennent didactiques, n’offrant que des illustrations exsangues de leurs propres avancées en un autre domaine.
Ce double écueil, Raphaël Baroni l’évite avec brio. Il se plaît visiblement à inventer des histoires, entre lesquelles il parvient à construire de subtils échos (on ne sait pas, à la fin, si Villes englouties est un recueil de nouvelles ou une quasi-thèse de rhétorique à exemples intégrés). En même temps, ce plaisir de la fiction se voit enrichi de toutes sortes de discours d’escorte, soit au seuil des récits (Baroni a l’art de l’exergue), soit en marge (comme Borges, convoqué tout au long du livre, il aime également les postfaces), soit encore à l’intérieur des textes mêmes (les frontières se brouillent vite entre le récit commenté par le narrateur même et les gloses qui dérivent vers de nouvelles fictions).
Le lecteur, lui, gagne à tous les tableaux. Il peut s’abandonner sans scrupules aux joies de l’immersion (son plaisir serait cependant plus vif encore si l’auteur, soucieux de beau langage, acceptait de temps en temps d’écrire « moins bien » et de couper quelques adjectifs « expressifs »). Mais il peut aussi observer son propre acte de lecture, selon une trajectoire qui d’abord l’emporte, puis le prend au piège, enfin le détrompe, tout en laissant la possibilité de rivaliser avec l’auteur même et de scruter les signes d’un tournant narratif, les indices d’un guet-apens fictionnel, les jalons d’une autre voie ou voix textuelle.
Raphaël Baroni est un auteur qui joue cartes sur table et son lecteur voit comment se fabrique la fiction à laquelle pourtant il croit. Dans Villes englouties, il montre même comment les cartes sont truquées et le lecteur lui en sait gré. Mais on ne sait jamais quels tours il tient en réserve, ni quand il abattra enfin son véritable jeu. Nul lecteur ne lui en fera le reproche.
Jan Baetens, dans les Chroniques d’auteurs des éditions Les Impressions Nouvelles, 18 mai 2015
Au seuil du livre, l’écrivain
Tout voyage au cœur d’un livre commence par la contemplation de sa première de couverture, par son feuilletage et par un sentiment qui mêle doutes, interrogations et attentes. Le livre serait‑il capable de nous séduire? Serions‑nous à même d’en saisir l’essence (les sens) et la valeur? L’écrivain y a‑t‑il laissé une trace de lui‑même? Quel est le jeu qu’il joue et qu’attend‑il de son lectorat?
Au‑delà des limites matérielles imposées par les pages et par le temps humain, la magie du livre surgit, surprenante, recréée pour chaque lecteur, chaque fois que la lecture (re)commence. Si l’écrivain est un ensorceleur qui fait naître des sensations et des images inouïes, tout en se perdant dans le silence d’un espace blanc, pour se recréer à nouveau entre les lignes, avec un clin d’œil subversif, la lecture devient un exploit ludique ouvert à des expériences fécondes. Avec ses Villes englouties, Raphaël Baroni y ajoute son expérience de narratologue et une culture impressionnante qu’il infuse dans la fiction. Le résultat? Un livre engageant et inquiétant qui invite, non pas à une petite promenade superficielle, mais à une quête ludique dans un espace dédaléen, pluriel et dialogique, créé à la mesure de son maître et, pourquoi pas, de ses recréateurs.
Au seuil du livre, derrière la Gorgone de la première de couverture—masque grotesque qui semble accueillir et mettre en garde en même temps—, c’est l’écrivain qui attend, fidèle compagnon du lecteur à travers le labyrinthe qu’il a créé et dont lui seul connaît les pièges.
L’architecture des Villes englouties—un recueil de huit récits de longueur variable précédés de citations et suivis le plus souvent d’un Post‑scriptum, le tout couronné d’un court Épilogue inattendu—est un leurre subtil. Derrière cette surface paisible, c’est un univers tumultueux et fascinant qui engloutit le lecteur, le fait avancer, retourner sur ses pas, s’égarer, se retrouver et se perdre à nouveau. Le doute, le relatif et l’inquiétude s’insinuent dans son esprit. L’hybridation générique—il s’agit, à notre avis, d’une sorte de récit hybride, mélange raffiné de nouvelle, de conte et d’essai—, l’abondance des images, le mouvement dramatique intense, le balancement incessant entre le réel et l’irréel et la pensée subversive de l’écrivain, tout concourt à déboussoler le lectant picardien, à l’entraîner dans un jeu de cache‑cache où le suspense se mêle à la surprise. Les Post‑scriptum, loin de constituer une conclusion, une clôture transparente du récit, réussissent, le plus souvent, à élargir le champ interrogatif, à effacer l’effet de réel que l’écrivain s’est donné la peine de tresser, pour basculer dans l’imprévu. Les huit histoires des Villes englouties donnent au lecteur le goût doux‑amer des petites histoires de Dino Buzzati et le plongent dans le fantastique inquiétant des romans de Boileau‑Narcejac et des films d’Hitchcock.
La voix de l’écrivain se fait sentir, tout d’abord, dans le paratexte, là où les citations abondantes qui ouvrent chaque histoire préfigurent un réseau intertextuel complexe. L’aspect spatial du titre est doublé d’une vision apocalyptique, renvoyant au mythe des terres englouties par les eaux. Évocation‑piège, si l’on pense, avec l’écrivain, que « le cours d’eau, c’est la métaphore ancestrale du temps » (p.98). Soumises, tout comme nous, les mortels, à l’écoulement inexorable du temps, à un devenir héraclitéen, les villes, à coordonnées géographiques réelles, y apparaissent comme autant d’organismes vivants, respirant un air d’étrangeté et voilés de mystère.
Le jeu funambulesque de la vie
Engloutis par la fiction, les héros voyageurs de R. Baroni traversent des expériences bizarres, bouleversantes. Les voyages qu’ils entreprennent deviennent initiatiques dans la mesure où ils entraînent des changements, des drames, des métamorphoses. Pris dans le vertige de ces expériences hors du commun, ils ressemblent à des marionnettes capables de développer des idées, de construire toute une métaphysique autour de leur vie, de s’interroger, d’évoquer, de douter, mais influencés par tout ce qui les entoure et incapables de décider de leur sort. Hantés par la mort et se balançant entre un moi égaré et l’autre, devant un miroir implacable1, certains d’entre eux font l’éloge de la vie au milieu de la nature sauvage, là où ils subissent des métamorphoses spectaculaires. Au cœur d’une forêt de mélèzes, le personnage sans nom du récit Arolla (Les Mélèzes) voit dans la perte de son humanité et dans sa nouvelle condition animale— »fusion béate avec les éléments » (p.52)—non pas une chute, mais un état de perfection, une ascension. Car, au‑delà de « l’odeur écœurante » de la civilisation, tout en s’ouvrant aux espaces infinies de la liberté, le héros, amoureux du végétal, du minéral et de l’animal efface dans son âme « le souci, la solitude, l’ennui et la mort » (p.37).
Dans Païlin (La Poignée), Théodore Moore s’abandonne, lui aussi, aux sensations inouïes que la nature lui offre:
Il ne pensait à rien, tout absorbé par ses sensations: il ressentait une joie sauvage à foncer ainsi droit devant lui, comme une bête en chasse. (p.120).
Issu de l’union tellurique avec l’humain, son épanouissement voluptueux et sensuel et sa joie de vivre à échos sauvages rivalisent avec un fort sentiment de culpabilité et avec la hantise de la mort :
[…] j’ai l’impression que la mort rôde autour de moi […]. Je la sens dans mon sillage, comme une semence empoisonnée enfantant des cadavres… (pp.138‑139).
Une image métaphorique semble couronner le parcours parsemé d’expériences funestes de ce héros fantoche : les diamants de contrebande. Image‑souvenir ou trophée de la mort?
Ce souffle démoniaque s’insinue dans la même mesure dans le récit circulaire Berlin (Le Mur). Bouleversé par la fin malheureuse d’un ami dont le souvenir l’habite « comme un vampire aspirant [sa] force » (p.158), un autre héros sans nom se répète:
Je suis fort et précis, un vrai barbare traçant sa voie dans la mêlée à coups de hache. (p.157)
Car l’histoire maudite de son ami—le passage de la soif d’aimer l’éternel féminin à une inconophilie suicidaire — devient la source d’une inquiétude galopante, grandissant en lui « comme une plante vénéneuse » (p.171). Tout repère, toute évidence s’écroulent devant ce sentiment d’égarement, d’impuissance et d’incertitude que le narrateur réussit à transmettre.
Dans le récit miroitant Bangkok (Engloutie), l’histoire inédite que le narrateur découvre dans le manuscrit d’un touriste lors d’un voyage en Thaïlande et qu’il tâche de reproduire—en faisant preuve d’une pensée subtile et en recourant à un riche bagage poétique de considérations pertinentes sur le style, l’aspect temporel et la narration—donne naissance à une série de questions obsédantes:
Est‑il si facile de tracer une frontière claire et infranchissable entre le factuel et le fictif, entre la fantasmagorie et le rêveur? (p.29)
La reprise involontaire du parcours touristique fictionnel devient, pour le lecteur‑narrateur, source d’inquiétudes et de doutes. Dans une réalité où tout tourne à l’étrange, où l’angoisse, la culpabilité et la crainte font naître des monstres, toute certitude disparaît. Cette pensée d’une réalité calquée sur la fiction, d’un héros fictionnel incarné dans son créateur traverse ce récit d’un bout à l’autre :
Dans certaines circonstances obscures, au terme d’un processus d’alchimie mentale de longue haleine, la littérature peut‑elle vraiment enfanter des golems de chair et de papier mêlés? (p.29)
Ce balancement entre la certitude et l’incertitude, le réel et l’irréel, l’être et le paraître, le Même et l’Autre traverse aussi le récit métaphorique Milan‑Rome (Bilocation). Giacomo Giacometti vit une double existence. Obsédé par ses deux moi, par ce va‑et‑vient incessant entre son être romain et son être milanais (évoqués aussi dans son nom et prénom), il se renseigne sur les cas de bilocation, en tâchant d’expliquer son « improbable condition » (p.88). Les questions abondent dans son manuscrit, les doutes aussi : « Est‑il possible que des voies d’accès existent, permettant le passage d’un univers à l’autre ? » (p.108). La tentative d’aller à la rencontre de soi‑même bascule dans le fantastique et donne naissance à des expériences paranormales :
C’est alors qu’un fait me frappa : le spectacle qui se présentait à mes yeux semblait à première vue parfaitement identique, quel qu’en soit le point d’observation ; les nuages avaient les mêmes formes, les touristes […] étaient les mêmes […]. Le seul détail qui différait, c’était mon absence réciproque de chacune de ces deux scènes. (p.194)
À la recherche de lui‑même dans une forêt d’illusions miroitantes, le héros de ce beau récit disparaît mystérieusement. Existerait‑il encore, quelque part, dans un monde possible, différent du nôtre? Dans le Post‑scriptum, le narrateur prolonge le jeu du regard et de l’illusion, en nous entraînant dans le vertige de ses suppositions: et si le dédoublement transperçait la fiction, pour entrer dans la sphère du poétique ?
On pourrait m’objecter que ce manuscrit qui est entré en ma possession constitue un indice essentiel, une trace objective de son passage dans mon univers de référence; je répondrai qu’il n’est pas totalement exclu que j’en sois moi‑même l’auteur, comme nous sommes tous les auteurs des textes que nous lisons. (pp.110‑111)
Dans la clôture du Post‑scriptum, les dernières gouttes du réel s’écoulent dans les eaux inquiétantes du néant. La voix de l’écrivain que le lecteur a déjà devinée tant de fois entre les pages du livre y devient plus forte. Elle fait référence à notre existence funambulesque et à ce jeu de l’être et du paraître qui la traverse. Narré au futur, Paris (Projections), petit exercice d’imagination, de projection virtuelle d’un voyage que le personnage d’origine suisse Jean‑Michel B. envisage de faire à Paris, s’inscrit dans le même « tissu de relativités, où nous vivons2« . Le pouvoir des mots pourrait‑il influencer notre sort? Le narrateur, ami de Jean‑Michel, se plaît à projeter mentalement ce voyage, tout en prenant la liberté de brouiller les cartes, de mener le jeu comme bon lui semble, de tirer les ficelles. Avec le clin d’œil moqueur et le brin d’ironie qu’il insinue entre les lignes, il apparaît comme un petit dieu ludique, créant et recréant un réseau kaléidoscopique de circonstances, de causes et d’effets, sous l’empire de la relativité. Même si, dans le Post‑scriptum, l’écrivain transfère cet exploit dans le champ littéraire, où il devient le défi et l’enjeu d’un narratologue inspiré, toujours en quête de nouvelles expériences, le sentiment d’étrangeté y persiste.
Tout aussi étrange, mais plus spectaculaire et plus proche du monde des contes, le récit Genève (Esprit coupable) propose un héros sans nom, réduit à un tu insignifiant, subissant une série de changements, sous l’empire d’un pouvoir surnaturel. À l’aide d’une formule incantatoire rappelant le « Sésame, ouvre‑toi ! », le don funeste qu’il reçoit lui permet de s’effacer, en tant qu’individu, aux yeux et à la conscience de ceux qu’il trouve indésirables. Cette série d’effacements culmine avec son égarement total: il s’efface aussi à sa conscience, pour recevoir, ensuite, une nouvelle identité, une vie toute neuve traversée de cauchemars. Comment pourrait‑il imaginer que ses rêves cauchemardesques retracent son ancienne existence, avec tous ses pêchés et son incomplétude et qu’il a été et continue à être une marionnette? Comment ne pas penser, en tant que lecteurs, à cette perspective vertigineuse que l’écrivain nous offre, à ce démon moqueur faisant irruption dans le réel et ouvrant une « brèche où pourra courir un vent d’inquiétude et de vie3 » ? Qu’à la rigueur, il pourrait toucher n’importe qui, n’importe quand? Traversé par un sentiment profond de culpabilité aux échos calvinistes, ce récit reprend l’idée de l’engloutissement temporel, de l’écoulement inexorable du temps et de la finitude humaine :
« En longeant le cours d’eau, tu songeais au temps qui file, à la décadence irrémédiable de l’être […]. » (p.60)
Comment accéder à cette « éternité hypocrite qui nous tente et nous torture durant l’étendue négligeable de notre vie » (p.60), sinon par une quête incessante de ce quelque chose de mystérieux et d’inaccessible qui hante notre conscience ? Dans Vallorbe‑Le Pont (La Pierre du Diable), un autre héros sans nom—ce je qui nous est déjà familier et derrière lequel se dresse le profil de l’écrivain—réussit à trouver la Pierre. Cette belle histoire parabolique répand sur chaque lecteur l’ardeur nostalgique de l’enfance perdue et retrouvée dans la forêt des contes. La Pierre du Diable, « parfaitement ronde, blonde et pleine » (p.186), retrouvée par les deux amis au bout d’un long chemin et la fameuse Perle de la Mer que Stefano reçoit du monstre Colombre dans le récit éponyme de Dino Buzzati ne font qu’une seule métaphore : celle de la plénitude, de l’absolu.
L’idée qui en découle et qui traverse les Villes englouties pour s’épanouir dans l’Épilogue est celle de l’illusion, de l’essence cachée sous le voile opaque de l’apparence, du balancement dialectique entre l’être et le paraître que Platon a illustré dans la République par le truchement du mythe de la caverne.
Lucia Eniu, « Voyage au coeur des Villes englouties« , Acta Fabula, publié le 9 juillet 2012
1. « […] il y aura toujours un étranger pour nous servir de miroir, et nous nous y reconnaîtrons, le doigt pointé vers le monstre que nous sommes et nous prendrons la mesure de tout ce que nous partageons avec lui : ne serait‑ce que ce geste, cette vision qui pénètre notre rétine et s’insinue jusque dans nos rêves. », Raphaël Baroni, Les Villes englouties, op. cit., p.30.
2. Michel Tournier, Le Vent Paraclet, Paris: Gallimard, (coll. Folio), 2005, p.198.
3. Jean Starobinski, Le Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève: Skira, 1970, p 141.
Sur le site Les agents littéraires
Premier ouvrage fictionnel de cet universitaire suisse, professeur associé à l’Ecole de Français langue étrangère à Lausanne, Les Villes englouties est un recueil de huit récits somme toute assez hybrides, entre les contes, les nouvelles et les essais qui soulèvent des questions théoriques à propos de la littérature notamment sur le rôle du lecteur. Raphaël Baroni place chacun de ses récits sous l’égide de différents auteurs, très hétéroclites tels que Héraclite, Wittgenstein ou encore Houellebecq, grâce à des citations placées en exergue des textes.
Ces textes dessinent la carte d’un voyage, celui du lecteur, dans différentes villes du monde comme Bangkok, Genève, Paris ou encore Païlin. Ce périple évoque l’étranger, l’étrangeté même, l’inconnu même si certaines nouvelles se passent en Suisse romande. Le lecteur a l’impression que les villes font naître la fiction, qu’elles en sont à l’origine. Genève est ainsi la ville qui évoque la culpabilité (Calvin y est bien sûr pour beaucoup).
Narratologue, Baroni a évidemment réfléchi sur toutes les composantes du récit et sur les pouvoirs de l’imagination. Il redéfinit la fiction et en fait ce qui peut arriver voire ce qui pourrait arriver dans un futur plus ou moins proche. L’une de ses nouvelles, Paris (projections) est d’ailleurs rédigée au futur.
Le récit que j’ai préféré est incontestablement Milan-Rome (bilocation) qui réfléchit sur l’ambivalence, sur la dualité qui habite un personnage, à la fois bibliothécaire au Vatican et designer industriel, tout en étant marié et célibataire. Il se demande donc tout au long de la « nouvelle » quelle est l’existence réelle et quelle forme prend l’existence rêvée. Cela n’est bien sûr pas sans évoquer le célèbre « Je est un autre » rimbaldien.
Si je devais trouver une métaphore pour désigner cet ouvrage, j’évoquerais l’idée du labyrinthe De nombreuses fois, le lecteur se perd, croit retrouver son chemin et est nouveau perdu dans les méandres du sens recherché. Entre solitude, dualité, présence de la mort, des génocides, le récit explore cette fameuse « inquiétante étrangeté » qu’est l’altérité.
Il est évident que cet ouvrage est très bien écrit, qu’il est organisé de façon intelligente et qu’il est probablement l’aboutissement de longues recherches littéraires, mais qu’il est également destiné à des lecteurs avertis et rompus à se confronter avec des questions théoriques Les références sont nombreuses mais, il faut le reconnaître, un peu élitistes L’auteur en a conscience d’ailleurs et donne parfois la référence de façon explicite. La nouvelle Milan-Rome (bilocation) peut être lue comme une réécriture de La Modification de Michel Butor. Loin d’être un simple divertissement, il propose plutôt des pistes de réflexions sur l’être, le monde, le langage, la lecture
Mathylde, Les Agents littéraires, 9 décembre 2011