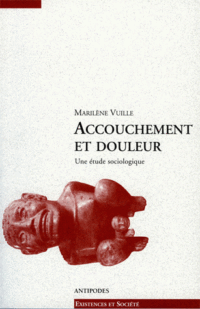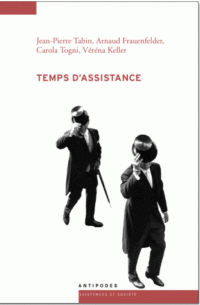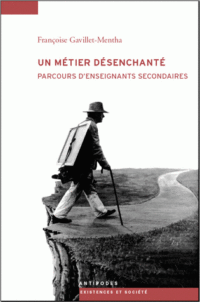Grands brûlés de la face
Épreuves et luttes pour la reconnaissance
Dubuis, Alexandre,
2014, 348 pages, 27 €, ISBN:978-2-88901-096-7
À une époque où les progrès de la médecine moderne permettent à des personnes pratiquement entièrement brûlées de survivre, il est paradoxal de constater les lacunes et le peu de littérature existant sur le sujet des grands brûlés. Ce livre aborde les aspects fondamentaux de la vie sociale et propose une réflexion sur l’importance du corps et de l’apparence dans notre société, en s’ouvrant plus largement à toute personne ou tout groupe d’individus stigmatisés dérogeant temporairement ou de manière permanente à une norme corporelle.
Description
À en croire les fictions cinématographiques et littéraires, les personnages affligés par une défiguration sont placés devant un cruel dilemme: se cacher, ou du moins dissimuler leur disgrâce, ou, plus rarement, l’afficher ostensiblement.
Or, les progrès de la médecine permettent de sauver un plus grand nombre de grands accidentés, même s’ils sont presque entièrement brûlés. On pourrait alors penser que la médecine ne se préoccupe guère de la vie posthospitalisation.
À dire vrai, on ne dispose que de peu de données sur le vécu des personnes défigurées. Ce livre comble cette lacune en laissant une large place aux propos de celles et ceux qui ont vécu une atteinte sévère de la face; il permet ainsi au lecteur « d’endosser » la perspective de qui est regardé, stigmatisé, de se placer donc en rupture avec le point de vue plus habituel et banal de celui qui regarde.
Si l’attention s’est portée sur l’expérience vécue de grands brûlés de la face, elle n’est pas « confinée » à ce groupe. Ce livre s’ouvre à toute personne, tout groupe d’individus stigmatisés dérogeant temporairement ou de manière permanente à une norme corporelle.
Table des matières
Préface de Nicolas Dodier
Introduction
I. Apports d’une sociologie de la brûlure
- La brûlure grave: aspects médicaux et psychologiques
- La brûlure grave: face à la tyrannie de l’apparence
- Une sociologie phénoménologique
II. Une épreuve de la reconnaissance de soi
- « Ça m’est arrivé »: la reconnaissance factuelle
- Une métamorphose accidentelle
- Le verdict du miroir: se reconnaître
- Une primauté du fonctionnel sur l’esthétique
III. L’apprentissage de l’interaction en situation d’inconfort
- Interagir en situation d’inconfort interactionnel
- Reconquérir l’espace public: segmentation des espaces
- Regagner la sphère professionnelle… et se confronter aux limitations fonctionnelles
IV « Lutter contre » le préjugé: se faire reconnaître à son corps défendant
- Quelle reconnaissance?
- Des dénis de reconnaissance
- Se faire reconnaître en dépit des apparences
- Aller à l’encontre des stéréotypes
V. « Lutter pour » visibiliser la souffrance vécue
- De la reconnaissance du patient brûlé à l’invisibilité de sa souffrance morale
- Renversement de situation
Conclusion
Bibliographie
Personnes interviewées
Associations francophones de soutien aux grands brûlés
Presse
Dans le Swiss Journal of Sociology
À travers ce livre, issu de sa thèse de doctorat, Alexandre Dubuis nous invite à percevoir la brûlure grave à partir d’une rélexion sociologique. En Suisse, la médiatisation de la brûlure n’est jamais axée sur le vécu des grands brûlés, mais elle se concentre davantage sur les avancées médicales en matière de soins. De ce fait, il existe peu de données sur le vécu et la qualité de vie des grands brûlés après la sortie de l’hôpital. Il a semblé nécessaire à l’auteur de ne plus considérer la brûlure grave comme une problématique spécifique à la médecine mais bien de l’amener dans le giron de la sociologie. Dans la préface, Nicolas Dodier précise que l’ouvrage vient combler un manque important (ce qui lui semble aujourd’hui indispensable) dans le champ de la sociologie de la brûlure.
L’auteur introduit son ouvrage avec des exemples tirés de fictions et de récits médiatisés. Dans les fictions, le destin des protagonistes brûlés se confond avec celui d’autres personnages atteints à la face pour cause de maladie ou de malformation.
« L’étiologie de l’atteinte importe peu, tant l’accent est mis sur la visibilité permanente des séquelles et des diformités » (p. 316). Dans les fictions ou histoires médiatisées, ces personnages sont représentés comme des monstres qui, pour « vivre en paix », ont comme unique solution soit de vivre reclus, loin de toute interaction sociale, soit de trouver le repos dans la mort ou le suicide. Une première question est posée au lecteur: comment peut-on vivre avec un visage déiguré? Tout au long de sa recherche, Alexandre Dubuis nous explique pourquoi il est aussi difficile de vivre dans la société actuelle avec une atteinte à la face. Dans les premières pages, il pose les questions auxquelles il va tenter de répondre tout au long de sa recherche: comment des personnes défigurées perçoivent-elles l’impression qu’elles produisent chez les autres? Comment l’appréhendent-elles? Et aussi, comment la gèrent-elles?
Pour répondre à ces questions, l’auteur divise son livre en cinq chapitres bien distincts, rendant ainsi la lecture agréable et fluide. Les réponses à ses questions ne sont pas un point de vue « inventé » par la théorie, mais élaboré à partir des récits de vie des grands brûlés de la face que l’auteur a essentiellement récoltés lors des dix-huit entretiens semi-directifs efectués dans le cadre de cette recherche longitudinale.
Au fil des chapitres, l’auteur nous emmène dans l’univers de la brûlure grave à travers trois périodes qui rapprochent le lecteur de ce que peut vivre un grand brûlé.
La période initiale est présentée dans le premier chapitre. Dubuis expose les aspects médicaux et psychologiques qui dominent habituellement le champ de la brûlure pour que le lecteur comprenne les répercussions physiques et identitaires d’une brûlure grave. Ceci afin de mettre en avant la légitimité d’une réflexion sociologique dans ce domaine. Le chercheur décrit clairement les étapes de la prise en charge d’un grand brûlé en initiant le lecteur profane au jargon médical utilisé. Dans cette période, le grand brûlé est plongé dans un coma artificiel durant plusieurs semaines afin d’éviter les supplices dus à la douleur des brûlures
et des soins prodigués.
La période secondaire est expliquée dans le second chapitre. Elle commence lorsque l’accidenté sort du coma et qu’il doit à nouveau exister et se découvrir. Le grand brûlé prend conscience de ce qui lui est arrivé et de sa nouvelle apparence. Il doit alors exister à nouveau et se reconnaître. Se reconnaître est une étape psychologiquement difficile et douloureuse pour l’accidenté. L’hospitalisation peut durer plus d’une année; l’hôpital devient alors un lieu sécurisé où le grand brûlé apprend à se reconnaître et à revivre. Dans ce second chapitre, l’auteur aborde « l’épreuve » ainsi vécue par le grand brûlé.
La période tertiaire, analysée dans les trois derniers chapitres, est la période sur laquelle l’auteur a choisi de centrer sa recherche. C’est le moment où le grand brûlé sort d’un lieu sécurisé (l’hôpital) pour vivre dans un lieu non sécurisé (la ville). Les interactions sont au centre du troisième chapitre. Les réactions de gêne et de malaise auxquelles sont confrontés les grands brûlés sont analysées dans la veine des travaux d’Erving Goffman à travers le concept d’ »inconfort interactionnel ». L’inconfort interactionnel fait émerger deux thématiques centrales de la recherche: celle de la visibilité et celle de la reconnaissance. L’auteur présente les divers apprentissages mis en place par les grands brûlés pour gérer ces interactions d’inconfort. Les deux derniers chapitres abordent la lutte « contre », qui est expliquée comme une lutte se vivant dans des situations concrètes de confrontation à la diférence corporelle (par exemple, lutter contre l’humiliation) et la lutte « pour », qui consiste à faire reconnaître la souffrance vécue; une souffrance morale.
En effet, une fois dehors, le grand brûlé vit l’exclusion et le rejet. Il est confronté aux regards, aux jugements et, parfois, aux insultes. Le stigmate est alors abordé en désignant les grands brûlés comme des « stigmatisés faciaux ». L’auteur emprunte à Gofman (1996 [1975]) le concept de « stigmate des monstruosités du corps » pour entamer son analyse. Il nous présente la typologie de Goffman différenciant les discrédités et les discréditables. Dubuis se demande alors si les « stigmatisés faciaux par brûlure sont contraints d’accomplir (et à faire accomplir) à leurs interlocuteurs un certain travail d’interprétation » (p. 72). Pour apporter des réponses, il emprunte une méthodologie diférente de celle de Goffman en s’appuyant sur des travaux de la sociologie de la reconnaissance (notamment Axel Honneth et Olivier Voirol).
Dans les récits de vie, la notion de l’avant et l’après-brûlure (phase post-brûlure) apparaît de manière récurrente dans chacun des chapitres. En s’appuyant sur les travaux de Ricoeur (1985; 1996 [1990]), Dubuis aborde l’importance de l’identité narrative
pour montrer que « derrière cette mise en récit se construit une identité narrative qui assure la jonction entre un avant et un après l’accident. » (p. 23). Cette jonction permet alors au grand brûlé de se reconnaître et d’être reconnu; ce qui amène l’auteur à se pencher sur l’identité. La brûlure grave du visage détruit tout signe de reconnaissance avec le visage « d’avant ». Dans certains cas, le grand brûlé est uniquement reconnu grâce à sa voix, qui souvent n’a pas changé. Il arrive régulièrement que les grands brûlés de la face doivent refaire leur carte d’identité. Les diverses amputations auxquelles l’accidenté est soumis ne lui permettent plus de reconnaître son corps. La place du corps et de la peau dans les interactions, au sein de la société d’aujourd’hui, sont deux dimensions largement étudiées dans ce livre et nourries par les travaux du psychanalyste Didier Anzieu.
L’une des particularités de cette recherche est que l’auteur a souhaité qu’elle permette au lecteur de faire un apprentissage en étant « contraint » d’endosser la perspective de celui qui est regardé en rupture soudaine avec celle, plus habituelle, de ceux qui regardent. C’est pour cela qu’il a donné une place centrale aux récits de vie. Cela explique probablement pourquoi il a fait le choix de ne pas s’intéresser davantage au vécu des proches des concernés. Une approche par l’entourage aurait toutefois permis de mettre en évidence un autre combat: celui de vivre avec un grand brûlé.
Pour conclure, ce travail met l’accent sur les habiletés interactionnelles et les compétences qui permettent au grand brûlé de ne pas être méprisé. Durant sa recherche, l’auteur s’aperçoit qu’à sa connaissance, aucun grand brûlé ne vit reclus chez lui, loin de toute interaction sociale. Ceci amène Alexandre Dubuis à avancer que chaque grand brûlé de la face vit, dans son quotidien, de nombreuses épreuves et luttes pour la reconnaissance. Il constate qu’ »avec les années, les gens trouvent des parades » (p. 89).
Cette recherche se veut militante. L’auteur milite pour un droit à la reconnaissance et un droit à la différence. Ce livre parlera ainsi non seulement aux personnes atteintes de la face et leur entourage, mais aussi à toute personne intéressée par la thématique de la reconnaissance. Dans une société qui se veut parfaite, ce livre bouscule les représentations de la normalité et de la déviance physique.
Il aurait été néanmoins intéressant d’approfondir la notion de « handicap » causé par une brûlure grave. Diférents points de vue sont proposés et appuyés par des auteurs reconnus dans ce domaine. Alexandre Dubuis choisit de retenir le concept de « handicap d’apparence » pour parler des brûlures graves de la face. Il serait intéressant d’approfondir cette notion de handicap et se demander si la brûlure est réellement un handicap ou si ce n’est pas plutôt le monde dans lequel nous vivons qui en constitue un.
Alizée Lenggenhager, Swiss Journal of Sociology, 42 (3), 2016, pp. 593–607.
Références bibliographiques
Gofman, Erving. 1996 [1975]. Stigmate. Les usages sociaux du handicap. Paris: Éditions de Minuit.
Ricoeur, Paul. 1985. Temps et récit III. Le temps raconté. Paris: Seuil.
Ricoeur, Paul. 1996 [1990]. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil.
Un film de l’Association Burns and Smiles, qui sensibilise à la question centrale du livre d’Alexandre Dubuis: quel regard porte-t-on sur les
Grands brûlés de la face? The fight of the burn victims to change other people’s look
Ecouter l’émission Babylone du 7 janvier 2015 (TSR)
Ecouter l’émission du 14 novembre 2014 (Radio Chablais)
Ecouter l’émission Atomes crochus (Rhône FM)
Les sciences sociales face au visage
Comment lire le social dans les corps des individus ? Deux ouvrages sur la défiguration permettent de poser la question, mais aussi d’en montrer les limites. Partie du corps dont les significations prolifèrent, il n’est pas évident de déconstruire l’exceptionnalité du visage et son ancrage dans les rapports corporels et sociaux. Deux ouvrages consacrés à la défiguration, publiés à quatre ans de distance, montrent l’importance de la face dans les sciences sociales. « Que fait la défiguration à l’interaction? » se demande Alexandre Dubuis dans son livre consacré aux grands brûlés. Que se produit-il quand on perd son visage, s’interrogent notamment François Delaporte, Emmanuel Fournier et Bernard Devauchelle dans un livre collectif consacré à la fabrique du visage. Le lecteur peut ainsi examiner les avantages mais aussi les limites d’un parti pris que nous persistons pourtant à considérer comme généralement heuristique: celui qui consiste à faire de la dimension physique des agents sociaux un instrument de lecture du monde social.
Des muscles du visage aux significations sociales de la face
Pour y répondre, les deux ouvrages procèdent de façons très différentes. Celui d’Alexandre Dubuis est une monographie, centrée sur une enquête menée en Suisse, par l’auteur, à l’aide d’une question précise et d’un protocole clair, auprès de 18 grands brûlés de la face, 9 femmes et 9 hommes, de tous âges et de toutes professions, plus d’un an après leur défiguration. C’est la première enquête consacrée à cet objet spécifique parmi les travaux de sociologie de la santé déjà existants sur le handicap. L’autre ouvrage est le fruit au contraire d’un travail collectif, quelque peu écartelé entre ses auteurs (un spécialiste de l’histoire des sciences, un philosophe et un médecin spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale), entre deux évènements séparés d’un siècle et demi (la publication d’un texte de Duchenne de Boulogne en 1856 sur la stimulation électrique des muscles du visage et la première greffe du visage par Bernard Devauchelle en 2005) et entre deux registres: l’un très technique – celui du médecin ou de l’historien des sciences ou de leurs associés (Sylvie Testelin, Sophie Cremades) – et l’autre plus accessible, mais éclaté dans 16 textes s’intéressant à des sujets aussi différents que la physiognomonie dans l’antiquité grecque (Simon Byl), le corps populaire au XVIIIe siècle (A. Farge), les expressions du visage du bébé à la naissance (Pierre Rousseau), les biotypologies (François Dagognet), les Gueules cassées (Sophie Delaporte, Stéphane Ragot), ou les corps sans visage dans l’art (Julie Mazaleigue). C’est que ce travail est avant tout le produit d’une rencontre (cinq de ces auteurs sur onze sont originaires de l’université ou de l’hôpital d’Amiens), de deux colloques successifs, (L’Énigme du visage et L’Impensable et l’impensé) et d’une coïncidence: la redécouverte du texte de Duchenne de Boulogne dans les archives et la première greffe totale de la face.
Ces deux évènements n’en cristallisent pas moins l’un et l’autre une rupture. Le premier, parce qu’avec l’innovation de Duchenne de Boulogne est condamnée la représentation ancienne du visage – monopole jusque-là de la physiognomonie – comme une sorte de nappe musculaire qui se restreint ou s’épanouit mais pour exprimer l’âme tout entière. Pour aller plus loin dans la décomposition de cette image, il aurait fallu un scalpel apte à ouvrir chaque muscle… mais il aurait comporté le risque d’en tuer la capacité expressive et la connaissance même. En activant un par un chaque muscle de la face avec la pile Volta, Duchenne de Boulogne invente un scalpel qui décompose sans détruire, et identifie précisément dans chaque muscle, en l’activant, des fonctions expressives bien séparées: comme le « rire faux » (produit des zygomatiques) et le « rire vrai » (permis par d’autres muscles). Il démontrait par là l’autonomie de ces expressions (même si notre perception a tendance à les unifier) et la richesse expressive du visage (François Delaporte). Quant à la greffe du visage, elle venait bousculer nos croyances en relevant le défi consistant à rétablir non seulement les fonctions mécaniques mais aussi les fonctions expressives du visage (Bernard Devauchelle).
Les deux ouvrages permettent ainsi de confirmer une importance, dans nos sociétés, du visage que Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche avaient déjà soulignée [1]. En témoignent ici de nombreux indices nouveaux. C’est, dans l’ouvrage d’Alexandre Dubuis, la puissance des réactions engendrées par la confrontation à un grand brûlé de la face: impossibilité à la fois de le regarder comme d’en détourner le regard, tendance à briser les règles normales de l’interaction (pour comprendre et conjurer cette anormalité, on rompt spontanément la distance entre inconnus en l’interrogeant sur sa vie privée), propension irrésistible et violente à l’identification (« moi je ne pourrais pas le supporter si cela m’arrivait »). C’est aussi l’incroyable énergie des luttes que les blessés de la face doivent engager, entre haine de soi et surveillance de l’autre, pour s’adapter en anticipant sans cesse le point de vue des normaux (passionnante partie du livre sur le « corps vécu »), et pour survivre psychiquement, à la faveur d’une » lutte contre » (contre la stigmatisation, contre l’isolement) et d’une « lutte pour » (pour faire reconnaître leur souffrance spécifique). Dans l’ouvrage de François Delaporte et al., l’indice majeur de l’importance et de l’intangibilité du visage dans nos sociétés réside sans doute dans l’hostilité déployée dans la presse en 2005 à l’égard de la greffe, du greffeur, voire de la receveuse (Bernard Taithe), et du malaise exprimé par certains handicapés (ceux issus du mouvement des Disabled Studies, militant souvent pour l’acceptation des différences), par le corps médical lui-même et enfin par les milieux bioéthiques qui y ont vu une atteinte spécifique à l’identité des personnes; en témoigne d’ailleurs, dès 2004, l’avis négatif rendu à l’égard de la greffe totale de visage tant par le Comité national d’éthique français que par le Royal College of Surgeons anglais.
Mais l’écueil majeur des deux ouvrages est l’importance accordée au visage par les auteurs eux-mêmes. « Inhumaine était la défiguration de la patiente mordue par son chien, transformée, l’espace d’un instant, en sujet monstrueux, cachant le trou béant de son visage derrière un masque qui attirait davantage le regard qu’il ne le détournait. Bête curieuse, dit le vocabulaire, qui donne à voir et suscite la curiosité (…) Mais à l’opposé, humaine, magnifiquement humaine cette revitalisation du transplant quand, les champs levés, il reprend couleur, volume, consistance et vie (…). Humanité restaurée quand la receveuse se regardant dans le miroir dit: « Je me ressemble ». Apparence retrouvée, corps reconnu au fil de la restauration de le sensibilité, nouveau visage capable d’inscrire dans ses traits l’émotion, le monstre a laissé place à une figure humaine » (Devauchelle, pp. 265-266): l’enthousiasme du médecin pionnier de ce type de greffe ne pouvait évidemment guère l’inciter à la distance face aux réactions habituelles sur cet objet. Mais la survalorisation de la face – ou de son absence – comme déterminante en tant que telle, sa réification, et sa construction comme surdéterminante est un problème récurrent ici. Dans l’ouvrage d’Alexandre Dubuis où la comparaison de cette atteinte corporelle avec d’autres n’est pas vraiment faite, tant son exceptionnalité paraît évidente. Or il est bien d’autres atteintes corporelles dont il semble difficile de détourner le regard – Jamel Debbouze le sait par exemple dans sa stratégie de dissimulation de son bras diminué. De multiples phénomènes viennent d’ailleurs interdire toute causalité directe entre l’atteinte à la face et les comportements. Or ils sont peu interrogés dans l’ouvrage alors que les indices en sont nombreux. L’appartenance de genre (voire de classe) des protagonistes (les femmes brûlées ne se montrent apparemment pas plus « atteintes » par la défiguration mais les spectatrices, si: elles sont plus violentes dans leurs réactions), les connotations de la blessure (co-responsabilité ou non de la victime dans l’accident, voire caractère suicidaire de celle-ci), enfin l’importance des ressources alternatives (humour et esprit) dans la gestion du stigmate: autant d’éléments qui s’avèrent changer fortement la réception de la défiguration. Loin de l’analyse d’un Goffman, attentif au contexte régnant autour du stigmate, qu’il soit ou non physique, celui-ci tend ici à être un peu à être limité à son caractère physique, à être réifié.
La même chose se produit dans certains textes de l’autre ouvrage. Exemplaire à cet égard: « Si la greffe du visage a fait couler tant d’encre, c’est qu’elle est, d’un point de vue anthropologique et au delà de toute considération technique et médicale, irréductible à toute autre transplantation. (…) La destruction du visage signe la désertion de l’individu, atteint au cœur son identité et de sa relation aux autres » trouve-t-on dans un texte par ailleurs passionnant (Julie Mazaleigue, p. 327) où il est montré avec virtuosité que la charge érotique d’un nu tend à s’accroitre quand son visage est dissimulé ou nié, que ce soit dans la peinture (Magritte), la photographie (nus masqués ou cagoulés), la sculpture (les « poupées » en forme de sexe d’Hans Bellmer) voire la littérature (Sade). Cette survalorisation du visage risque de secréter le faux sens car le lecteur ne peut s’empêcher de se demander si cet accroissement de charge érotique ne tient pas simplement au fait que rien (et notamment pas d’autres partie du corps: mains, bras, jambes) ne vient dans ces œuvres distraire le regard du sexe, devenu aussi central dans l’œuvre qu’il est caché dans le monde social – comme dans le tableau L’Origine du monde de Courbet. Le visage est par ailleurs trop souvent interprété ici avec évidence comme le lieu névralgique de l’identité (Alain Masquelet) avant qu’il soit montré que toutes les greffes ont successivement été interprétées en ces termes, critiquées au nom de la défense de l’identité, que c’est la nouveauté chaque fois de l’entame corporelle qui vient chatouiller l’inquiétude identitaire: « Mais n’est-on pas là en train de succomber à l’illusion récurrente qu’un greffon est un vecteur d’identité? » (Emmanuel Fournier, p. 250). Pourtant dans ce même texte – sans doute par un effet de corpus (les contraintes en matière de photos d’identité) – l’importance du visage tend aussi à être surévaluée comme support d’identité par rapport à d’autres, comme les empreintes digitales ou l’empreinte ADN.
Quelle exceptionnalité du visage ?
Le lecteur se trouve alors incité à s’interroger à la place des auteurs sur l’origine ou les raisons de l’importance sociale accordée à la face physique, nos deux ouvrages ne permettant que d’esquisser une réponse à cette question. Deux choses importantes d’abord se trouvent confirmées ici. Mais elles n’expliquent en rien l’importance spécifique du visage. Il s’agit de l’importance des normes corporelles en général comme tyrannie de l’apparence, idée à laquelle Alexandre Dubuis prend soin d’accorder des pages très utiles, à l’aide de la naissante « sociologie du corps ». Par ailleurs, nous dit Mary Douglas, le corps est un lieu particulièrement riche d’inscription des significations sociales, plus riche qu’un linteau de porte, nous dit-elle [2]: sans doute parce c’est une surface « décomposable », dont les éléments peuvent amplifier, atténuer, et beaucoup complexifier la puissance expressive (en jouant, par exemple, de manière contradictoire ou pas, de la voix, du geste, et de l’expression). Rien cependant ne nous dit jusqu’ici avec évidence que le visage serait à cet égard particulièrement névralgique.
Il faut alors recourir à trois explications pour l’affirmer. 1) La première nous ramène au texte de Duchenne de Boulogne et justifie alors amplement sa présence ici: il s’agit évidemment de la multiplicité des muscles permettant l’expression sur cette surface-là. Un handicapé de la face risque donc d’être particulièrement entamé dans son accès à l’expression. L’un d’entre eux, fort pertinemment cité par Alain Masquelet (p. 236), déclare ainsi dans About Face, de Jonathan Cole: « Je peux lire les visages mais je ne peux délivrer de réponse en retour ». 2) La seconde explication tient à une particularité en effet du visage… par rapport au moignon, tout aussi troublant: il est plus difficilement ou entièrement dissimulable que la main de Jamel Debbouze. Il échappe d’avantage à la maîtrise – de ce seul point de vue – et se trouve davantage incontournable dans l’interaction. 3) Enfin – mais la chose n’est curieusement jamais évoquée ici – par rapport à d’autres segments de la surface corporelle, le visage a une étonnante particularité: il concentre la plupart de nos sens, voire les cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, et même le toucher. Entamé, il risque donc d’handicaper grandement notre rapport au monde en général et à l’autre en particulier, ou de suggérer que c’est le cas. Voilà qui pourrait bien renforcer le sentiment de son caractère névralgique. Reste que nous demeurons ici dans le domaine des hypothèses explicatives, dont l’inventaire distancié méritait cependant d’être entamé, et gagnerait d’ailleurs d’être vérifié et poursuivi.
Au total, ce que ces deux ouvrages confirment aussi par leur facture, par leurs qualités et leurs défauts, c’est – et ce, quelles qu’en soient les raisons – l’importance du visage pour notre sens commun, fût-il armé de savoir, comme ici. Il apparaît comme un nouveau lieu où se cristallise l’effroi identitaire contemporain [3], où méditer sur le « nomadisme identitaire » actuel qui viendrait menacer « la conception d’un sujet basée sur l’unicité et la singularité » (Alain Masquelet, p. 233) ou au contraire (et parce qu’après tout on pourrait fort bien « imaginer une greffe qui toucherait d’encore plus près les questions d’identité »), un lieu permettant de méditer sur la malléabilité de l’expression chez l’homme et de son visage qui serait toujours à écrire (Emmanuel Fournier, p. 252 sq.). L’importance accordée au visage devient alors en soi intéressante. Le fait que celui-ci soit chargé de représentations fortes et de phantasmes puissants, bref qu’il soit un objet chargé de normativité « politique » [4] (au sens où il introduit l’inquiétude dans la cité) doit évidemment demeurer à l’horizon de l’analyse. Mais on apprend ici qu’il faut aussi s’en défendre, sous peine de réification et de mythologisation de son objet.
Dominique Memmi, La Vie des idées, 31 août 2016. ISSN: 2105-3030. URL: http://www.laviedesidees.fr/Les-sciences-sociales-face-au-visage.html
Corps et sciences sociales, 5 février 2016, La défiguration
Intervention de Marie Le Clainche – Piel
Cette discussion critique de l’ouvrage d’Alexandre Dubuis, Grands brûlés de la face. Épreuves et luttes pour la reconnaissance comprend trois temps. J’introduis d’abord la démarche de l’auteur, à travers cet ouvrage et ses précédents travaux. Je décris ensuite plus longuement trois moments de l’ouvrage et leurs apports. Je termine enfin sur une série de commentaires adressés à l’auteur, en sa présence.
I. Démarche
Les travaux d’Alexandre Dubuis s’inscrivent dans le champ des études de sciences sociales sur l’apparence des corps humains. Cette littérature très hétérogène comprend des travaux d’histoire, de sociologie et d’anthropologie sur les mécanismes de production et de diffusion de standards corporels (tels que Gilman, Kuipers, Vigarello), des travaux sur les professionnels de l’esthétique ou de la reconstruction des corps (dont Le Hénaff, Matoka, Seymour), d’autres encore sur le rôle de l’aspect matériel des corps dans les catégorisations de l’humain (à l’instar de Boetsch, Goffman, Stiker). Également au sein de ce champ, l’objet défiguration s’avère nettement moins représenté que la beauté et les pratiques d’embellissement.
C’était d’ailleurs le point d’entrée du programme de recherche d’Alexandre Dubuis, qui a publié en 2004 un ouvrage sur les marques corporelles choisies sous le titre La pratique du tatouage, un signe de distinction grégaire1. Cet ouvrage portait sur les représentations publiques du tatouage en Suisse en collaboration avec René Knüsel et à partir d’une enquête collective menée avec les étudiants de l’université de Lausanne.
Dans la suite de ce travail, avec l’ouvrage issu de sa thèse et qui nous intéresse ici, Alexandre Dubuis opère deux déplacements. Premièrement et sur un plan empirique, il porte son regard sur les marques corporelles accidentelles et non plus sur les marques choisies. Deuxièmement et sur un plan théorique, il passe d’une sociologie des représentations à une sociologie de l’expérience.
On notera dès à présent que si les sociologies de l’esthétique et des marques choisies telles que le tatouage, le piercing, ou les pratiques en matière d’épilation ou de tannage de la peau souffrent parfois d’un discrédit (similaire à celui dont souffre leur objet), l’apparence au sens de la plastique, des formes humaines, est loin d’être un objet illégitime en sciences sociales. Et pourtant peu de choses sont écrites sur les marques involontaires.
Or je ne crois pas contredire l’auteur en disant qu’aborder les atteintes corporelles non choisies déplace considérablement le type de phénomène étudié. S’il est toujours question d’apparence, il n’est plus question d’esthétique, et la défiguration sous bien des égards n’a même rien à voir avec un souci de distinction entre le beau et le laid.
L’ouvrage porte ainsi sur la défiguration dans la Suisse contemporaine observée à travers une enquête par entretien (1 à 2) auprès de 19 personnes, dont 10 femmes et 9 hommes, chacune ayant été victime d’un accident par brûlure au moins un an avant l’entretien (que ce soit à la suite d’un incendie dans un logement ou de l’explosion d’un véhicule à moteur pour donner des exemples fréquents). C’est donc une enquête historiquement et géographiquement située et qui se présente comme telle.
Ces accidents ont laissé aux enquêtés des marques au visage, les défigurant c’est-à-dire d’après la définition qu’en donne l’auteur modifiant « la fonctionnalité de leur peau et/ou la géométrie de leur visage » (p. 71). Brouillant les expressions de leur visage, la nouvelle matérialité de leur « face » perturberait la communication avec les autres.
Alexandre Dubuis montre que pour les grands brûlés de la face le souci n’est ni tout-à-fait d’ordre esthétique, ni tout-à-fait de l’ordre du sens que l’on attribue à des marques corporelles: la défiguration perturbe profondément l’existence de la personne atteinte, et l’enquête doit nous permettre justement de mieux saisir cette perturbation. Plutôt que de s’intéresser aux impacts de la défiguration sur les carrières des individus, l’auteur nous amène à nous demander: que fait la grande brûlure à l’ordre de l’interaction?
Pour y répondre, l’ouvrage contient une quantité remarquable d’extraits d’entretiens et leur exploitation constitue un fil rouge de l’ouvrage et une de ses originalités, même si les conditions de réalisation des entretiens comme les profils des enquêtés restent peu explicités. À ces derniers s’ajoute un corpus de vingt-trois pathographies publiées, c’est-à-dire des récits de vie narrés sous l’angle de l’atteinte faciale et de ses impacts, ainsi que des oeuvres de fiction et des extraits de presse. Les oeuvres de fiction sont notamment utilisées pour décrire l’époque et le climat qui encadre les expériences des personnes défigurées. L’époque actuelle serait caractérisée pour l’auteur par le poids voire la tyrannie des apparences, en référence aux perspectives offertes par David Le Breton ou Jean Claude Kaufman. Cette expression consiste à dire que « l’individu {serait} contraint de répondre à 2 impératifs » (p.51). Le premier impératif serait d’effacer ce qui attire l’attention sur des imperfections du corps, tandis que le second serait de libérer le corps et le marquer à l’envi. Dans ce contexte, les grands brûlés de la face se trouvent être des « exemples de démaîtrise » puisqu’incapables tout à la fois d’effacer la disgrâce et de mettre en valeur leur plastique.
Les personnes défigurées font office de « contre-figures corporelles » et empêcheraient « l’effacement ritualisé du corps », expression que l’auteur emprunte à Le Breton. En d’autres termes, si la santé est parfois présentée comme la vie dans le silence des organes, ici l’état normal de l’apparence consisterait à pouvoir « passer inaperçu dans une foule d’inconnus » (p.38); à permettre au corps de disparaître dans des situations d’interaction plutôt que d’attirer l’attention.
II. Résultats et apports de l’ouvrage
Si l’ouvrage est explicitement divisé en cinq chapitres, on y trouve une structuration implicite en trois temps.
Le premier temps s’intéresse au corps vécu, à l’accident et aux soins médicaux. La sociologie y est d’inspiration phénoménologique et porte ainsi sur l’expérience par les grands brûlés de leur propre corps marqué.
Le second temps est celui de la rencontre entre grands brûlés de la face et valides, « stigmatisés et normaux » pour reprendre la terminologie goffmanienne sur laquelle l’auteur s’appuie, en cherchant à mettre l’accent sur les interactions comme épreuves.
Le troisième temps de l’ouvrage, permis par les échafaudages précédents, relève d’une application des théories de la reconnaissance (en référence au philosophe Axel Honneth) au phénomène de la grande brûlure. Deux formes de luttes sont décrites, auxquelles se prêtent les personnes défigurées par la brûlure pour contrer les dénis de reconnaissance de leur pleine humanité: une lutte pour la reconnaissance de leur traumatisme d’une part, une lutte contre la stigmatisation de leur condition d’autre part.
Le corps vécu
Une dimension foncièrement originale de l’ouvrage d’Alexandre Dubuis relève de la première partie qui accorde de l’importance et qui enquête sur le corps vécu. Cette première partie consiste en une sociologie de l’expérience du corps atteint par la brûlure, du rapport de la personne brûlée à son propre corps.
On accède aux descriptions des accidents à travers les récits qu’en font les enquêtés, aux semaines à l’hôpital, du point de vue des – maintenant – grands brûlés, mais aussi à partir d’échanges avec des chirurgien-ne-s et des infirmier-e-s qui sont les premier-e-s à « apprivoiser » le corps « calciné ». Ainsi l’auteur nous donne accès à des dimensions matérielles de l’expérience rarement évoquées: le corps des grands brulés à la fois momifié et boursouflé, qui produit des odeurs, est « troué de façon répétitive par différentes perfusions, sondes, dans le but de l’oxygéner et de le nourrir » (p.37). Les enquêtés évoquent la gêne respiratoire, la torture des bains, les amputations parfois, mais aussi le coma, la perte de la notion du temps, les douleurs, et les hallucinations induites par la morphine. La sociologie de la maladie grave précède ainsi celle de la défiguration.
Au-delà de la phase des soins intensifs, l’atteinte à l’apparence fait entrer dans une nouvelle dimension en matière de rapport au corps – du corps silencieux au corps malade – et pose la question de la continuité, c’est-à-dire du caractère bifurcatoire ou non de l’événement brûlure. L’auteur parle d’ »une épreuve de reconnaissance de soi » qui semble avoir deux versants: d’abord la reconnaissance de sa continuité identitaire avec la personne avant l’accident, ensuite la reconnaissance de sa condition (physique) d’être humain. Si cette épreuve concerne aussi l’expérience non visuelle d’un corps modifié, elle est frappante dans « le verdict du miroir » (p.123). En effet, chaque enquêté se souvient avec précision de la première fois post accident où il ou elle s’est vu-e: souvent dans un miroir accompagné-e par l’équipe soignante au moment de la sortie du service des soins intensifs, parfois dans le reflet d’une vitre, voire dans les réactions d’un visiteur.
Une fois le patient au fait de son apparence le rapprochement avec la défiguration n’est pas automatique, les enquêtés insistant sur les répercussions fonctionnelles de leurs atteintes faciales. Pourtant à travers leurs récits on perçoit des résistances à leur propre catégorisation: Alexandre Dubuis parle de « saillances perceptives » pour signaler les cicatrices comme handicap d’apparence ou appuis matériels à un traitement différencié.
Le corps en interaction
Venons-en au deuxième aspect étudié, à savoir « l’apprentissage de l’interaction ». Celui-ci est moins développé que les deux autres – ce qui se justifie par son caractère certes essentiel pour la compréhension du processus, mais moins original par rapport à l’innovation empirique de la partie I et l’innovation théorique de la partie III.
Si la grande défiguration n’est pas qu’une question d’interaction avec autrui, la sortie de l’hôpital et la confrontation de plus en plus fréquente avec des « personnes ‘non accoutumées’ à voir un grand brûlé » mettent les enquêtés en situation d’ »inconforts interactionnels » (p.86-88). Inspirée de la sociologie de Goffman, cette notion signale une perturbation dans la fluidité des échanges. Alexandre Dubuis distingue alors des niveaux d’inconfort produits par les « contacts mixtes » selon deux cadres d’interaction. Les situations publiques, mais non focalisées, c’est-à-dire avec une visibilité anonyme et l’impossibilité de contrôler qui regarde, produiraient le plus haut niveau d’inconfort. Tandis que les situations de co-présence qui ne se font pas sur le mode des apparitions furtives, où l’attention est focalisée et qui permettent des contacts plus soutenus, facilitent le travail des grands brûlés pour ménager l’inconfort.
L’auteur décrit ainsi une variété de techniques dont l’objectif premier est de soutenir leurs interactants dans un travail de domestication des réactions à leur égard. Les enquêtés endossent souvent dans leurs récits le « point de vue des normaux », en cherchant à se rappeler leurs propres réactions face à des personnes marquées à la face avant l’accident. Une tactique courante consiste à avertir les personnes de leur condition avant une rencontre (p.103). Alexandre Dubuis ne manque pas d’en souligner le paradoxe puisque pour favoriser la spontanéité, les grands brûlés préparent l’interaction.
On assiste au niveau des trajectoires individuelles à un processus d’élargissement des espaces fréquentés du privé (ou fermé comme à l’hôpital) au public. Sous l’angle de la réinsertion dans l’espace public, l’auteur étudie aussi les retours dans la sphère professionnelle ou plutôt les difficultés des enquêtés à regagner un poste similaire à celui occupé avant l’accident. Il montre combien les parois sont poreuses entre les justifications de non-embauche liées aux atteintes fonctionnelles et les effets d’une apparence défigurée.
Le corps en lutte (de représentation)
Dans un troisième temps, l’auteur propose une application des théories de la reconnaissance d’Axel Honneth au cas de la défiguration par brûlure. Il s’appuie sur cette philosophie selon laquelle le bon fonctionnement de la vie sociale se base sur une reconnaissance mutuelle de chacun de ses membres; alors que les expériences d’humiliation et de mépris freinent l’intégration sociale ainsi que la bonne formation identitaire des sujets humains.
Aussi si chez le philosophe on trouve diverses sphères de reconnaissances, chez Alexandre Dubuis on trouve surtout une échelle de la reconnaissance: qui va au mieux d’une reconnaissance positive à – au pire – un déni de reconnaissance, en passant par trois degrés d’atteinte à cette reconnaissance. Un déni de reconnaissance n’atteint pas nécessairement le stade d’une remise en cause de l’appartenance au genre humain (p.232) comme pourraient le suggérer les études sur les frontières d’humanité et auxquelles l’auteur ne se réfère pas, mais plutôt un doute sur leurs qualités.
Alexandre Dubuis décrit deux luttes qui se répondent: une lutte pour (visibiliser la souffrance vécue) et une lutte contre (le préjugé).
La lutte contre est nécessaire à l’émergence d’une lutte pour et arrive donc en premier, elle consiste à s’opposer plus ou moins activement aux réactions négatives et à la stigmatisation de leur condition de grand brûlé. On y retrouve l’opposition classique entre extériorité et intériorité, apparence de l’être et profondeur de l’âme: les grands brûlés de la face se vivent en proie aux mésinterprétations. Ils cherchent à éviter l’assimilation au personnage fictionnel du grand brûlé, homogène et pessimiste puisque confiné aux rôles des méchants et des sorciers (un registre macabre dans lequel s’inscrit d’ailleurs la surprenante couverture de l’ouvrage qui n’est pas en adéquation avec le travail qu’elle contient).
Les moyens de la lutte sont toujours interactionnels puisque les dénis de reconnaissance abordés supposent la coprésence: face à des « formes de mépris » tels que des regards persistants, des moqueries, les personnes dévisagées développent des compétences à réagir (p.238). Ils vont recourir à des réprobations silencieuses (par des mimiques), plutôt que par des interventions à voix haute – ce qui est plutôt l’apanage des proches. L’évitement des situations d’interaction par la limitation des sorties semble aussi être une stratégie à laquelle recourent les personnes défigurées, mais elle n’est pas considérée comme une lutte par l’auteur.
La lutte pour peut ensuite s’arrimer à la lutte contre, elle vise la prise en compte de l’expérience de la grande brûlure et la reconnaissance de la souffrance. Dans le temps post accident la prise en compte de leur traumatisme physique et psychique est constitutive des structures de soin. Les patients trouveraient dans les relations avec les personnels médicaux la satisfaction d’être reconnus comme tels c’est-à-dire comme grands brûlés à l’histoire singulière, de la même manière que l’administration peut le faire à travers l’attribution de degrés d’invalidité et d’assurances appropriées.
Mais une fois sortis des espaces les plus familiarisés aux apparences défigurées, ils seraient en proie à une tension entre leur visibilité (présence) physique, et leur invisibilisation de l’ordre social qu’Alexandre Dubuis appelle « visibilité non visuelle ». C’est-à-dire que si les grands brûlés n’échappent pas aux regards, ils ne sont pas pour autant reconnus comme de potentiels partenaires d’interaction. Et lorsqu’ils le sont, surtout, leur expérience de la brûlure tend à faire l’objet d’une mise sous silence.
Au cours des discussions le registre lexical de la chaleur et du feu est subtilement évité, au restaurant les tartes flambées sont renvoyées en cuisine (p.285), et les questions sur les raisons de son apparence ne lui sont pas posées directement, mais à ses proches.
Aussi on voit à travers les réactions des grands brûlés à l’égard de cette « réserve morale » (p.288), ou cette minoration de leur vécu traumatique, les limites de la gestion de l’inconfort interactionnel. Pour faire basculer la situation et rendre audible leur histoire certains grands brûlés mettent en récit leur trajectoire, d’autres recourent à l’humour ou aux jeux de mots pour faire remonter l’implicite à la surface, d’autres encore usent de « provocation » c’est-à-dire qu’ils ne vont pas dissimuler leurs cicatrices voire exposer leurs saillances.
III. Commentaires
Sur ce point, on remarque que les luttes pour et contre ont en commun de se situer à un niveau individuel. Mais, alors même que des associations francophones de soutien aux grands brûlés sont référencées à la fin de l’ouvrage, on ne dispose d’aucun moyen pour saisir comment s’articulent ces luttes individuelles à des collectifs. Ces luttes existent ailleurs, comme en témoigne les activités du collectif britannique Changing Faces, qui emprunte le chemin du droit et des mobilisations collectives pour rendre visible et inacceptable les discriminations envers les personnes facialement différentes. Quid de la Suisse: l’absence de collectivisation de la lutte relève-t-elle d’un choix d’approche de l’auteur? Est-ce lié à l’apparition tardive dans le parcours des enquêtés de l’association suisse de soutien aux personnes brûlées – Flavie instituée en 2003 et dont le chercheur est membre d’honneur?
Au sujet de l’entrée dans la lutte pour: comment passe-t-on de la gestion de l’inconfort interactionnel, qui implique notamment de ne pas imposer aux personnes brûlées à la lutte pour qui implique une critique de l’évitement du sujet? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui mobilisent la critique de l’imposition et celle de l’évitement? Ou est-ce que ce n’est qu’une question de temporalité, la gestion de l’inconfort interactionnel étant davantage pertinent en amont des luttes?
Un troisième questionnement porte sur la relation entre la continuité identitaire et la modification corporelle. L’auteur pose comme hypothèse (p.255) qu’un visage qui ne ressemble plus assez à celui d’avant la brûlure perd sa capacité à être un signe d’identité: « Quand le visage ne peut plus être un signe d’identité, la voix joue un rôle de substitution (…) elle permet l’identification et surtout sa reconnaissance (…) la preuve de sa normalité, son caractère humain ». Or à travers cette démonstration deux niveaux sont mélangés: d’une part la question de l’unicité du visage tout au long de la vie, et d’autre part la question qui mériterait d’être distinguée de la spécificité du visage humain comme signe d’appartenance (à communauté sociale) et d’existence en « alter ego ».
Un quatrième étonnement porte sur la pluridisciplinarité déployée dans l’ouvrage, qui produit paradoxalement autant un effet d’ouverture que de fermeture. Ouverture d’abord puisque l’auteur ne s’arrête pas aux frontières disciplinaires et convie en plus de la sociologie, la médecine, la chirurgie, la psychologie et la psychanalyse pour décrire ce qui arrive à la personne brûlée. Mais dans le même temps, on peine parfois à en comprendre le passage, c’est-à-dire qu’il manque au lecteur ou à la lectrice un système de traduction entre les disciplines. Cela produit un effet de désociologisation renforcé dans l’écriture par la mobilisation fréquente du registre de l’évidence: certaines « vérités » médicales ou psychanalytiques appuyées de « forcément » (p.37) et autre « inévitablement » (p.22) n’en sont pas pour le lecteur ou la lectrice.
En outre, l’audace théorique de l’auteur porte le risque d’un décrochage entre l’enquête et les apports théoriques. Pour pallier à cette impression, l’auteur redouble d’efforts pour justifier régulièrement les rapprochements d’auteurs et de perspectives. Chaque chapitre contient une introduction didactique aux concepts employés: l’identité chez Paul Ricoeur, la sociologie pragmatique, celle d’Erving Goffman, ou encore la philosophie d’Axelle Honneth. Et si le rapprochement entre le cadre de l’interaction de Goffman et l’élaboration d’une théorie de la reconnaissance d’inspiration honethienne constitue un point d’arrivée de l’ouvrage stimulant, le recours au concept d’épreuve convainc moins. On sent l’analyse fluctuer entre l’épreuve dans son sens commun (un choc, une série d’événements éprouvants, un doute sur la survie du grand brûlé, c’est-à-dire des épreuves de vie ou de mort); et l’épreuve dans le sens d’une sociologie pragmatique des épreuves au sens des « situations dans lesquelles les individus déplacent et refondent l’ordre social qui les lie » (Boltanski, Chiapello, 1999, p73-80). Or les lecteurs ont peu accès à ce qui serait véritablement remis en cause au niveau de l’ordre social – puisque l’ouvrage se situe d’abord au niveau des individus et de l’ordre de l’interaction, mais donne peu d’éléments sur la structure sociale. Que serait une épreuve sans institution sociale, collectif, ou controverse?
Ce qui nous amène à une sixième et dernière remarque. La sociologie pratiquée dans l’ouvrage Grands brûlés de la face ne se veut pas explicative: il ne s’agit pas d’identifier des facteurs (tels que le genre, l’âge ou la position sociale) qui expliqueraient les manières de réagir à la grande brûlure. En dépit de l’approche théorique de l’auteur pourtant, l’absence de mobilisation du genre surprend pour deux raisons: sa présence dans les matériaux avancés d’une part, la préférence pour un d’autre part. En effet, l’auteur annonce à la faveur d’une note introductive préférer le genre masculin neutre dans l’analyse, faisant fi de la majorité de femmes parmi ses interlocuteurs (10 des 19 enquêtés sont des femmes). Il en résulte un ouvrage sur une expérience générique masculine de la grande brûlure: il n’y a pas « des grands brûlés » à part dans les premières pages, mais un être créé pour le récit et qui s’appelle « le grand brûlé ». Ce choix d’analyse pousse l’auteur à retraduire au masculin l’ensemble des extraits d’entretiens, y compris les expériences des femmes, comme ici : « (…) il hésitera à demander une réduction AI, car il a honte de sortir la carte qui atteste d’un handicap » (p. 268). Or ce mode d’écriture ne rend justice ni au terrain ni à l’approche de l’auteur, qui insiste tout au long de son ouvrage sur « le caractère individuel de l’épreuve de la brûlure » et signale le risque de réification des grands brûlés tout au long de leur trajectoire.
Tentés par une lecture au féminin neutre, les lecteurs et lectrices peuvent s’appuyer sur la profusion des entretiens pour contrer l’unification des trajectoires, auxquelles l’ouvrage nous offre un accès aussi rare que détaillé.
Intervention de Marie Le Clainche–Piel, Corps et sciences sociales, 05 février 2016, La défiguration, https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1344/
séminaires et travaux 23, Lausanne, IAS.
Dans la revue en ligne Lectures / Liens Socio
« Je suis une photo bougée qui pourrait faire penser à un visage ». Cette phrase, figurant dans le Théorème d’Almodovar d’Antoni Casas Ros, couvre à elle seule la problématique que soulève le livre d’Alexandre Dubuis. Comment s’approprier l’image de soi lorsque l’on est atteint de brûlures graves au visage? Comment apprendre à la gérer? Comment appréhender les réactions d’autrui face aux stigmates? Le visage, comme l’a montré David Le Breton1, ainsi que la voix, sont les deux éléments primordiaux constitutifs de la singularité d’un individu dans nos sociétés occidentales. En s’inscrivant dans une sociologie compréhensive de l’expérience de la brûlure grave, constituée en tant qu’analyseur, ainsi qu’avec l’apport des travaux d’Erving Goffman, Alexandre Dubuis se défait des stéréotypes pessimistes et homogènes des parcours de ces défigurés et met l’accent sur les stratégies et les ressources des grands brûlés pour engager, maintenir, ou éviter des interactions sociales, mais aussi « l’inconfort interactionnel » dans lequel ils se trouvent. Dans la lignée des travaux d’Axel Honneth notamment, l’étude de la brûlure grave de la face et de sa visibilité accrue soulève la question de la reconnaissance individuelle et mutuelle, fort bien étayée dans l’ouvrage, mettant en lumière la spécificité de la lutte menée par les grands brûlés.
Les modalités de la relation à l’autre des personnes qui présentent de séquelles irréversibles du visage sont peu abordées dans les littératures psychologique et médicale, celles-ci ayant avant tout une visée thérapeutique. Dans la littérature romanesque ou filmique, l’attitude de ces personnes est dépeinte de manière dichotomique, entre dissimulation totale et exhibitionnisme outragé des cicatrices. Une approche dans le cadre de la sociologie compréhensive, à travers des entretiens avec des grands brûlés, place en exergue la façon dont ces derniers gèrent leur stigmate dans leurs interactions, et remet en cause la vision fataliste du grand brûlé qui s’enfermerait dans un rôle de « mort-vivant », au sens d’une mort sociale, ou encore dans celui de monstre de foire2. La relation à l’autre étant le ciment de toute vie sociale, il va de soi que ce thème recouvre une importance majeure dans une telle entreprise de recherche sociologique. L’apport considérable de l’ouvrage, et qui peut être désigné dès à présent, est d’inverser la position du lecteur: de spectateur du stigmate de la brûlure, il peut se mettre à la place de celui qui est regardé, le porteur du stigmate, ou du moins, appréhender son ressenti. Cette approche qualitative permet la compréhension de la brûlure grave à un plus large public, au-delà des milieux associatifs concernés et au-delà du cadre médical. Les extraits d’entretiens qui alimentent le propos montrent au lecteur à la fois la singularité des parcours individuels et les dimensions communes, transcendant les particularités, que l’on peut retrouver à travers l’expérience de la brûlure grave de la face. En établissant un parcours idéal-typique du grand brûlé, Alexandre Dubuis souligne la rupture biographique qui découle de l’accident ainsi que la nouvelle temporalité dans laquelle le grand brûlé se retrouve plongé, en insistant par ailleurs sur le vide temporel inhérent au coma nécessaire aux premiers soins. D’autre part, la vie du grand brûlé ne s’arrêtant pas au confinement hospitalier, il lui apparait primordial d’analyser la phase post-traitement, qui était jusqu’alors peu documentée, pour rendre compte des répercussions durables de la brûlure, au cœur de la vie sociale de ces individus.
Il est facile d’imaginer la gêne et le malaise qui peuvent s’immiscer dans les relations sociales lorsqu’un des interactants présente un visage méconnaissable. Dans la lignée des travaux déjà classiques d’Erving Goffman, ce livre montre la gestion par les grands brûlés de cet « inconfort interactionnel », à travers les focales spatiale, temporelle et professionnelle. L’expérience de la brûlure grave est de nature dynamique, elle s’inscrit dans ces trois registres et évolue en fonction de ceux-ci. La découverte du visage après l’accident est une épreuve à encaisser; l’apprentissage de l’appropriation de l’image de soi est certes difficile, mais les grands brûlés disposent de marges de manœuvre, d’espaces de négociation qui leur permettent de disqualifier la vision fataliste de la vie post-brûlure. L’inconfort interactionnel et ses différents cadres normatifs varient selon les territoires, plus ou moins fermés, donc plus ou moins « sécurisés » pour les grands brûlés, par rapport aux réactions que leurs séquelles peuvent susciter: le petit commerce de proximité sera plus facilement abordable que la piscine municipale… Cette gestion de l’inconfort et des réactions est également nécessaire lors de la réinsertion professionnelle, épreuve pour le grand brûlé, mais aussi pour son employeur. L’auteur évite la représentation dichotomique, et non moins simpliste, qui placerait à un pôle les exigences du marché de l’emploi et à l’autre pôle celles des grands brûlés, systématiquement renvoyés au statut de victimes. Grâce aux entretiens, le chercheur distingue trois facteurs pouvant influencer de manière négative l’interaction sociale: la proximité physique, qui suscite de plus grandes curiosités à cause de la visibilité accrue ou « saillance perceptive » des séquelles, l’imprévisibilité des interactions dans tout espace public, qui complique l’anticipation des réactions, et enfin, la visibilité même des séquelles, dissimulables ou non, suivant les codes vestimentaires inhérents aux lieux fréquentés, et aux saisons. Ces facteurs ne sont pas déterminants, dans la mesure où le nombre d’espaces fréquentés s’accroit avec le temps et la diminution de la saillance perceptive; les interactions sociales ne sont pas non plus dénuées de spontanéité, certaines d’entre elles ne suscitant plus ou pas de justification ou de mise en récit des séquelles corporelles.
Le temps post-brûlure est loin d’être linéaire, jalonné par des opérations ou des traitements qui peuvent encore être nécessaires des années après l’accident. Le grand brûlé, toujours susceptible d’être confronté aux réactions plus ou moins péremptoires d’autrui, est inévitablement atteint dans l’image qu’il a de lui-même, voire dans son statut d’être humain. La seconde notion centrale de l’ouvrage est celle de la reconnaissance, dont Alexandre Dubuis a su tirer plusieurs apports. Il montre en effet la spécificité de la lutte pour la reconnaissance factuelle menée par le grand brûlé, qui s’exprime principalement par la justification de sa rupture biographique auprès d’autrui, afin de faciliter l’entrée en relation. Certaines réactions peuvent s’apparenter à des formes de déni de reconnaissance – qui peuvent être appréhendées, à partir des travaux d’Axel Honneth – à travers deux modalités de lutte: la « lutte pour » et la « lutte contre ». Ces luttes permettent aux grands brûlés d’abolir le caractère « figé » des cadres normatifs de l’interaction. La « lutte contre » participe à la construction d’une nouvelle normalité identitaire et physique par l’annonce de la saillance et de ses causes, pour palier à des situations d’humiliation (commentaires péremptoires, négatifs) ou de réification (l’attention de l’interactant étant tournée uniquement sur les séquelles visibles). La « lutte pour » exprime la tension entre la volonté d’être considéré comme une personne « normale » et celle de faire reconnaitre la particularité de son expérience de vie. Elle engendre donc des réactions, à l’opposé de son homologue, et permet d’édifier les cicatrices en marque de reconnaissance, en symbole de force. L’enjeu est ici de faire reconnaitre la souffrance vécue à la fois sur un plan physique et un plan moral.
La recherche sociologique d’Alexandre Dubuis rappelle l’importance de la corporéité dans la relation à soi et à autrui, ainsi que son éminente fragilité. Bien qu’elle se focalise sur la spécificité du vécu des grands brûlés, elle peut s’appliquer, dans une certaine mesure, à d’autres expériences d’atteinte de la face. Elle aide le lecteur à se défaire des préjugés sur la vie post-accident de ces personnes et à lutter contre une vision pessimiste, fataliste de celle-ci, en montrant les ressources dans lesquelles peuvent puiser les grands brûlés pour entrer en relations sociales et pérenniser ces relations. Les récits d’expérience permettent de mieux saisir la complexité d’une telle épreuve, ainsi que les échecs et les victoires qui la jalonnent.
Sarah Demichel-Basnier, Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 3 décembre 2014, URL: http://lectures.revues.org/16343
Notes:
1. David Le Breton, Éclats de voix. Une anthropologie des voix, Paris, Métailié, 2011.
2. Une analyse des remarques négatives et de la discrimination dont sont victimes « les stigmatisés faciaux » a été conduite dans l’ouvrage de Stéphane Héas et Christophe Dargère (dir.), Les porteurs de stigmates. Entre expériences intimes, contraintes institutionnelles et expression